Après Sidérations et sa narration plus simple que ce à quoi il avait habitué ses lecteurs, Richard Powers, toujours traduit par Serge Chauvin, retourne à ses premières amours et signe un roman choral sensible et ample, parfois légèrement brouillon mais traversé de fulgurances brillantes.
https://zone-critique.com/critiques/richard-powers-un-jeu-sans-fin
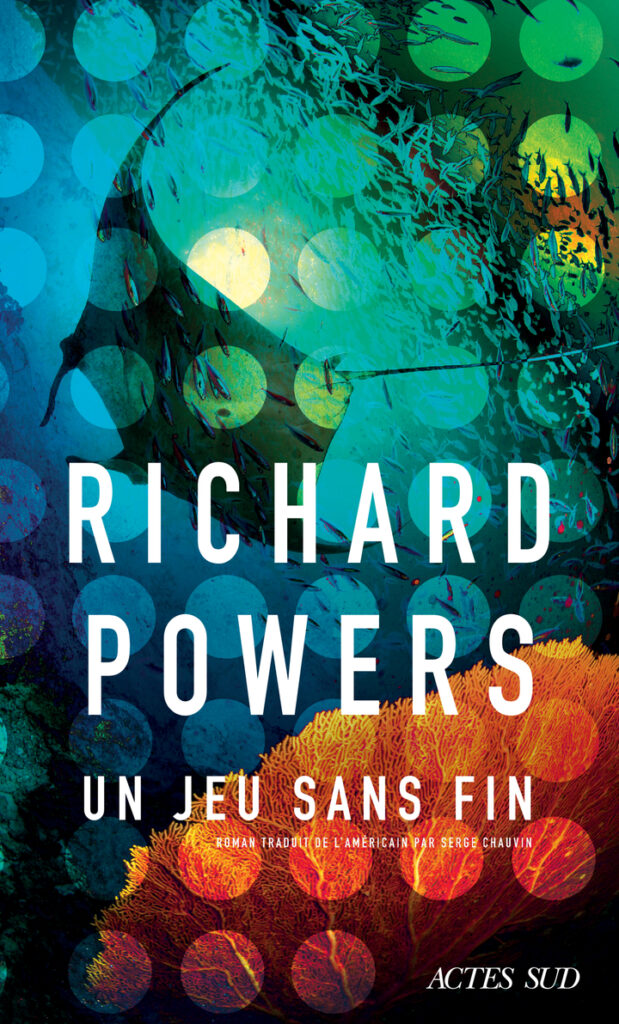
Point de bois ici, de troncs d’arbres à perte de vue et de canopées verdoyantes ou roussissant avec l’arrivée de l’automne. Ce sont des forêts de corail qui naissent des pages d’Un jeu sans fin, et autour s’étoffe bientôt tout un monde, celui que découvre Todd quand il est encore enfant, subjugué par un livre sur l’océan lui permettant d’échapper aux querelles parentales, celui que découvre Evie quand elle entre dans l’adolescence, précipitée dans une piscine par son père, alourdie d’un scaphandre prototypal. Inspirée de l’océanographe Sylvia Earle, à qui l’auteur fait d’ailleurs quelques clins d’œil, Evie grandit et plonge dans les mystères sous-marins à plusieurs reprises, fuyant ses obligations familiales et entraînant l’auteur dans son sillage. Page après page, elle s’émerveille devant les monumentales raies mantas, les couleurs éclatantes de poissons innombrables, le ballet kaléidoscopique d’un sépiide, la noirceur impénétrable des profondeurs, peuplées de créatures mystérieuses et inquiétantes – devant l’ingéniosité de tout ce macrocosme que jamais l’homme ne pourra complètement comprendre, tantôt « jardin arc-en-ciel peint par Bonnard » ou « tableau surréaliste ».
« Parfois, elle piétinait sur place, submergée par le plus délirant assortiment d’inventions dignes du Dr. Seuss : indigo, orange, argenté, toutes les couleurs du spectre depuis les nudibranches pies jusqu’à des limaces luisantes et blanches comme l’os hérissées d’une forêt d’épines. La mer la portait, avec une sensation de soie tiède sur ses membres nus. Elle flottait en suspension au milieu de récifs qui s’élevaient en pinacles, en coupoles, en tourelles et en terrasses. Elle était un ange désarmé planant au-dessus d’une métropole bâtie par des milliards d’architectes presque invisibles à l’œil nu. »
L’auteur raconte ainsi des bribes de l’existence d’Evie, déchirée entre sa famille qui ne la voit pas assez et sa famille de cœur, celle qui vit sous l’océan. Il laisse aussi régulièrement la parole à un Todd affaibli et malade qui revient sur sa jeunesse, sur l’amitié précieuse qui le liait alors à Rafi, garçon noir et cynique qui a partagé la vie de Todd comme un frère, alliés face à la négligence ou à la maltraitance de leurs parents – puis est arrivée l’université et avec elle la divergence de leurs intérêts ainsi que la fabuleuse Ina. Son présent répond à ces récits : avec Rafi, elle s’est installée à Makatea, île des Tuamotu où ils savourent la beauté des jours et apaisent la rancœur nourrie par leur âme, aimant les flots de loin, pour leur bleu profond et les mystères qu’ils renferment mais qui ne les intriguent pas plus que ça.
Destinée manifeste : détruire l’autre
Ce monde qui éblouit Evie et Todd est en danger, comme tous ceux que nous décrit Richard Powers ces derniers temps. La course au progrès menace les prodiges que recèle l’océan, comme elle menace les îles du Pacifique depuis des décennies. C’est donc Makatea que l’auteur choisit pour illustrer ce propos, paradis éventré, balafrée par « la cicatrice de l’Histoire », « grande baleine dépecée, amputée peu à peu d’un tiers de son corps ». Rafi et Ina y vivent avec leurs deux enfants, apaisés par la quiétude de l’île, véritable « monastère », et de ses habitants, par la beauté inestimable qui reprend ses droits sur les ravages causés par les colons d’hier. Mais des envahisseurs d’une autre époque s’apprêtent à s’emparer une nouvelle fois de Makatea pour y construire des « communautés flottantes à partir d’éléments modulables ». Les insulaires devront choisir entre ce que certains voient comme le progrès, allant de pair avec de nouvelles infrastructures de santé, un afflux de touristes ainsi qu’un regain d’énergie pour cette île qui se dépeuple lentement mais sûrement, et l’isolement paisible et rassurant qui fait de Makatea l’Éden que tous chérissent.
“Cette critique de la colonisation et de cette éternelle revisite de la « Destinée manifeste » apparaît également ailleurs dans Un jeu sans fin.”
Cette critique de la colonisation et de cette éternelle revisite de la « Destinée manifeste » apparaît également ailleurs dans Un jeu sans fin. Rafi naît dans des États-Unis en proie à un racisme encore plus brûlant que celui qui sévit sous Donald Trump et doit lutter face aux Blancs, tiraillé entre son amour pour certains de ses proches et ses aspirations le poussant vers une éducation prestigieuse que sa famille et ses amis ne comprennent pas et jugent inutile. Pour s’oublier, il se plonge dans des vers qui laissent Todd perplexe, lui qui sera par ailleurs son meilleur partenaire aux échecs puis au go – au-delà de la poésie, c’est dans le jeu que se réfugie Rafi. Ces deux personnages semblent d’ailleurs, au-delà de la couleur de leur peau, être les deux facettes de l’auteur qui a étudié la littérature et la physique avant de devenir programmateur informatique.
“La course au progrès va encore plus loin ici, ne mettant pas seulement en péril la faune océanique, mais aussi l’essence de l’humanité.”
Âme numérique
La course au progrès va encore plus loin ici, ne mettant pas seulement en péril la faune océanique, mais aussi l’essence de l’humanité. Dès son enfance, dès sa découverte par procuration de ce ballet magique d’un sépiide peignant une danse chatoyante, Todd voit dans les choses de la vie le code informatique qui se cache derrière, « le tout petit génie [niché] à l’intérieur » des merveilles de l’univers – quand ses parents lui offrent un jouet lumineux, il ne peut qu’y voir la magie de l’électronique, plus stupéfiante encore que celle de la nature qu’elle imite. C’est ainsi que commence l’histoire d’amour de Todd et du numérique, sa quête tendant vers l’établissement d’une intelligence qui égale l’espèce humaine et bientôt, peut-être, la dépassera – à moins que les secrets que nourrit l’humanité ne réservent encore quelques surprises, évoquées par l’auteur dans un final étonnant.
Richard Powers signe donc avec Un jeu sans fin un vaste roman engagé aux ramifications aussi longues que les tentacules des méduses qu’observe Evie, lesquelles s’emmêlent ici et là, nuisant au boléro harmonieux orchestré par l’auteur dont la grâce triomphe pourtant parfois.
- Un jeu sans fin, Richard Powers, traduit par Serge Chauvin, Actes Sud (2025)
- Crédit photo : © Jean-Luc Bertini
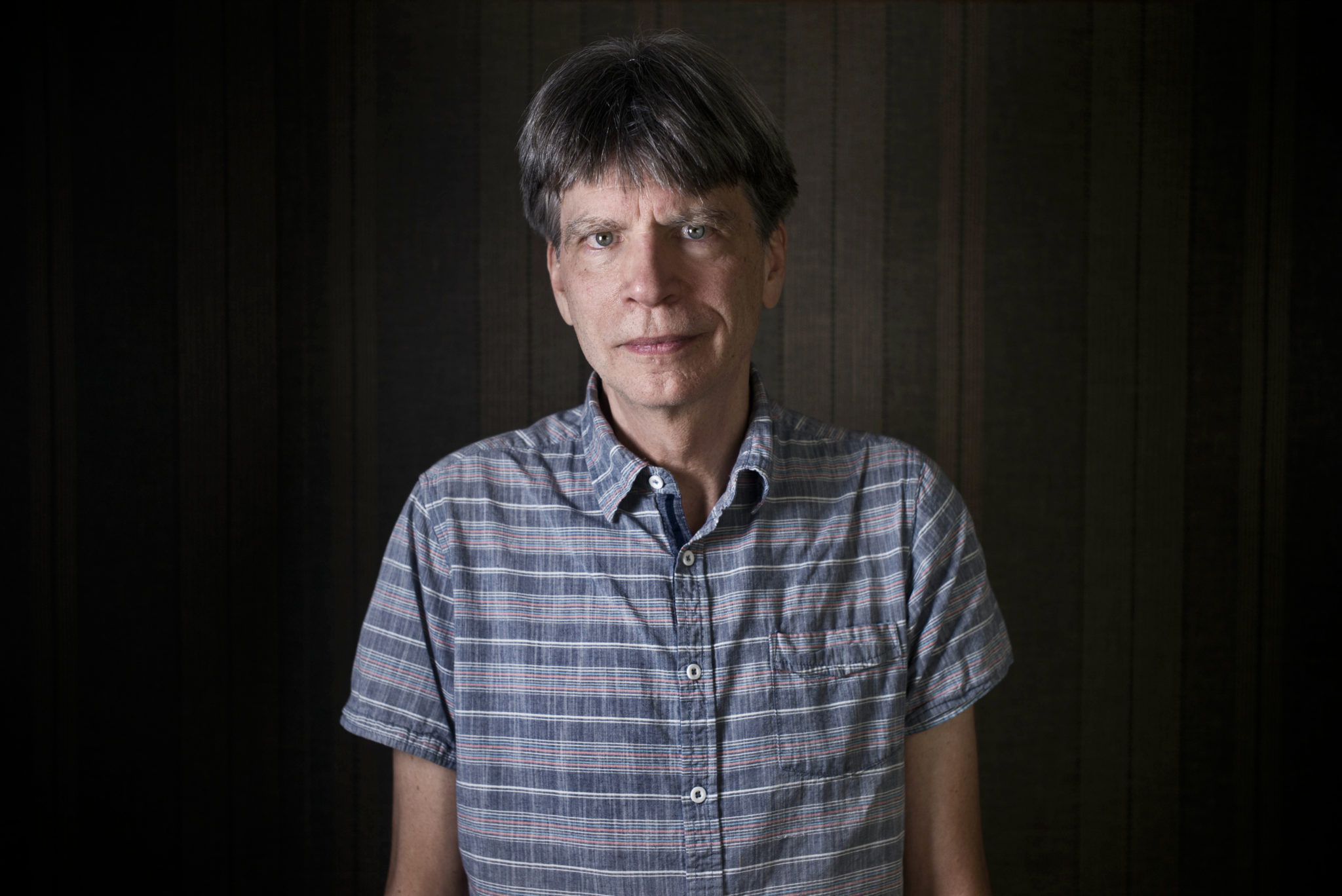
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.