La littérature peut-elle sauver les États-Unis ? À l’occasion de l’investiture de Trump, nous proposons un panorama de la littérature américaine contemporaine. Alors que le président est reconnu pour son mépris des minorités, les auteurs noirs-américains, amérindiens, d’origine asiatique, africaine ou latine occupent une grande place dans les lettres états-uniennes. De Lauren Groff à Stephen Markley, les écrivains américains leur donnent une voix et témoignent de la multiplicité de ce pays.
https://zone-critique.com/videos/lamerique-par-la-litterature/
Traduit avec force talent et courage par Charles Recoursé, Le déluge de Stephen Markley, est un roman-fleuve qui prépare ses lecteurs au pire, sans leur permettre d’oublier ce qu’ils ont lu une fois le livre refermé.
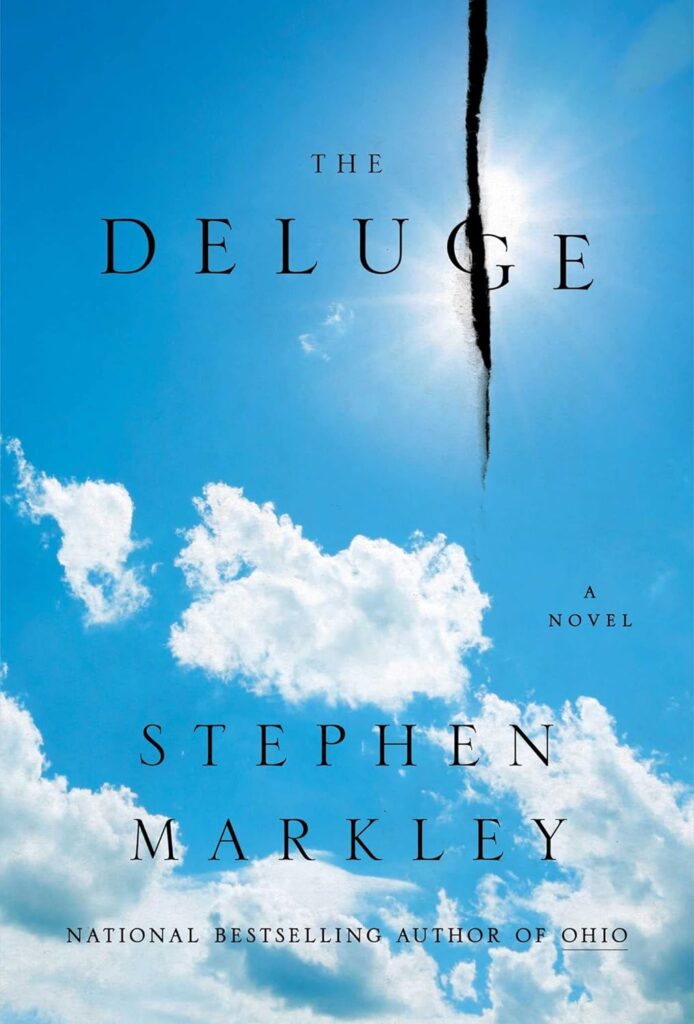
Dans Le déluge, Stephen Markley donne à lire un futur vraisemblable qui n’en est que plus glaçant. Ce roman choral est composé des voix d’un océanographe dépassé, d’une publicitaire détestable, d’un autiste aussi brillant que déterminé, d’une écoterroriste qui sillonne le pays, sa fille dans les bras, d’un écologiste convaincu qui n’était au départ qu’un jeune homme éperdument amoureux, et d’un drogué volontiers violeur puis bientôt père prêt à tout. Beaucoup sont issus de minorités – l’une a des origines jamaïcaines et navajos, un autre est homosexuel et fils d’immigrés indiens musulmans, une troisième est Latina tandis que des personnages secondaires sont asiatiques, non-binaires ou métisses.
À la première, deuxième ou troisième personne, l’auteur raconte ces six protagonistes, mais il se sert surtout d’eux pour donner à voir le monde en son entier. Ils réfractent la lumière à la manière d’un prisme et les rayons qu’ils renvoient reforment la Terre dans l’œil du lecteur. Ainsi, le regard biaisé de chacun se combine et offre une vision multi-dimensionnelle de ce qui les entoure, de la crise protéiforme qui s’annonce, dans dix ans à peine si on l’en croit ce qui est relaté ici. Leurs narrations imparfaites sont par ailleurs enrichies de rapports très précis confinant à l’analyse documentaire, d’articles de journaux et de pages de titre, autres témoignages de ce futur alternatif qui traduisent la tendance de la littérature américaine à la narration omnipotente plus encore qu’omnisciente – l’auteur sait tout et il est compétent dans tous les domaines, de l’océanographie à l’organisation d’attentats, de l’élaborations de plans et de stratégies politiques à la science du feu, ce savoir encyclopédique laissant parfois échapper une étincelle de poésie.
« Les braises étaient semblables à des lucioles, la fumée et les flocons de cendres formaient une brume de soie. »
Qu’en sera-t-il quand l’IA aura remplacé les écrivains comme elle commence déjà à le faire dans ce livre ?
La rébellion de notre Terre
L’extrême-droite qu’imagine l’auteur ici ferait presque passer Donald Trump pour un bouffon peroxydé et inoffensif.
Notre maison brûle, mais elle prend aussi l’eau, elle est fouettée par des vents d’une violence encore inégalée et par des tempêtes de sable, elle fond sous l’assaut d’un soleil sans pitié.
« “La vraie question, c’est pourquoi tout le monde n’est pas ici”, répondit l’adolescent. Un masque à gaz pendait à sa hanche. Son T-shirt proclamait riposte. “Je suis venu parce qu’on n’a plus rien à perdre. Ou bien on gagne maintenant, ou bien on crève.” »
Au-delà de notre planète bleue qui se rebelle et qui répond au centuple à ce que l’Homme lui inflige depuis des siècles, s’ébrouant pour semble-t-il, se débarrasser de lui, il faut aussi compter avec cette espèce aveugle et assoiffée qu’est la nôtre – de quoi donner raison aux survivalistes les plus excessifs. L’extrême-droite qu’imagine l’auteur ici ferait presque passer Donald Trump pour un bouffon peroxydé et inoffensif. Enfermés ici comme dans un asile, un gouverneur fait sécession, un Pasteur tout puissant excite les foules et s’apprête à ramener ses ouailles à l’âge de pierre à coup de discours d’une haine insoutenable, des milices armées torturent et assassinent ceux qu’ils voient comme des communistes, le gouvernement – pourtant apparemment démocrate – tue plusieurs milliers de manifestants écologistes pacifiques, des polices privées emprisonnent sans preuve, sans procès et pour plusieurs mois sans rien divulguer des disparitions dont elles sont à l’origine. Un certain sadisme se dégage ainsi de plusieurs scènes que l’auteur aurait pu épargner au lecteur, cette tendance étant d’ailleurs déjà sous-jacente dans Ohio, son premier roman. Le cynisme absolu de certaines répliques vient en outre soutenir cet appétit pour le sang.
« Lorsque la culture populaire décrit des génocides, elle recourt à une conception caricaturale du mal, de sorte que le spectateur – ou la spectatrice – ne puisse s’identifier aux participants. C’est un mauvais service à leur rendre, car au fond, le génocide ne vise rien d’autres que l’élimination d’une population concurrente, dans l’intérêt de ses propres enfants. Désirant continuer à consommer comme jamais dans l’histoire, l’élite mondiale estime qu’elle doit en priver les autres. »
https://zone-critique.com/critiques/la-fileuse-tracy-chevalier/
Grâce à son panel très large de personnages, l’auteur ne se contente pas de brosser le portrait de suprémacistes qui seraient une sorte de mélange entre des nazis, des tortionnaires et des ogres lobotomisés. En effet, la gauche qu’il dépeint n’est pas non plus exempte de reproches : bientôt déboussolés, incapables de faire changer les choses, les démocrates les plus radicaux versent le sang eux aussi, tandis que ceux qui le sont moins ont tendance à faire preuve d’une complaisance qui n’est plus de mise à l’aube de l’apocalypse. Entre égoïsme et prise de conscience, il faut choisir.
Politique-fiction
Stephen Markley déploie un véritable paysage politique, sa fresque prenant pour repères des événements traumatiques pour certains encore très frais dans les mémoires – les manifestations de la place de Tian’anmen, les actions des Weathermen dans les années 1980, la pandémie de Covid, l’assaut du Capitole de janvier 2021, les attentats racistes, les meurtres perpétrés par des policiers. Il évoque Joe Biden, Barack Obama et d’autres figures incontournables de la scène politique américaine, extrapole les conséquences de certaines de leurs actions ou de leur inaction et imagine leurs héritiers ou ceux qu’ils auront malgré eux contribué à propulser dans les hautes sphères du pouvoir.
Le temps est accéléré ici, près de vingt ans se déroulant entre la couverture et la quatrième, cette chronologie aussi élastique que suffocante représentant le temps politique, si court et si long – deux ans pour préparer les élections de mi-mandat, puis deux ans pour préparer les élections présidentielles avec dans l’intervalle si peu l’occasion d’agir.
La construction du Déluge est donc remarquable tant les recoupements et les liens sont subtilement amenés, évidents pour certains, beaucoup moins pour d’autres. C’est donc cette toile d’araignée tissée avec maestria qui donne peu à peu naissance à un futur que nous préférerions ne pas connaître ; pour cette raison, nous sommes en droit d’en vouloir à Stephen Markley. Qui est-il pour nous plonger de force dans un cauchemar qui, espérons-le, n’aura jamais cette noirceur ? Il fait naître une terreur primitive et incontrôlable, déversant sa colère et ses propres craintes sur des pions qui ne peuvent pas faire grand-chose de cet effroi à leur petite échelle, dépeignant des rouages qui avalent et écrasent même ceux qui sont au sommet de l’État. Le déluge a un ciel bleu pour couverture mais il ne renferme que si peu d’espoir, l’humanité vacillante dont fait preuve l’auteur bientôt balayée par ce qui nous attend. C’est un roman dont il n’est pas possible de se remettre.
© Stephan Amico
- Stephen Markley, Le déluge, Albin Michel, 21 août 2024


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.