Pour son deuxième opus, La Longe, l’autrice suisse Sarah Jollien-Fardel cueille la douloureuse histoire d’une mère, Rose, en deuil de sa fille Anna, renversée par une camionnette. Comment survivre à la mort de sa fille ? Comment vivre après que son enfant a été fauché, à l’orée de sa jeunesse ? Cela n’est pas possible. Invivable. Il n’existe pas de nom spécifique pour ce type de deuil, les parents se retrouvent orphelins de leur propre enfant, comme s’ils étaient de nouveau placés dans une position infantile, abandonnés à l’abjecte solitude de voir morte celle à qui ils ont donné la vie. Ainsi rétrogradés, les parents sont aussi démis de leur fonction que démunis.
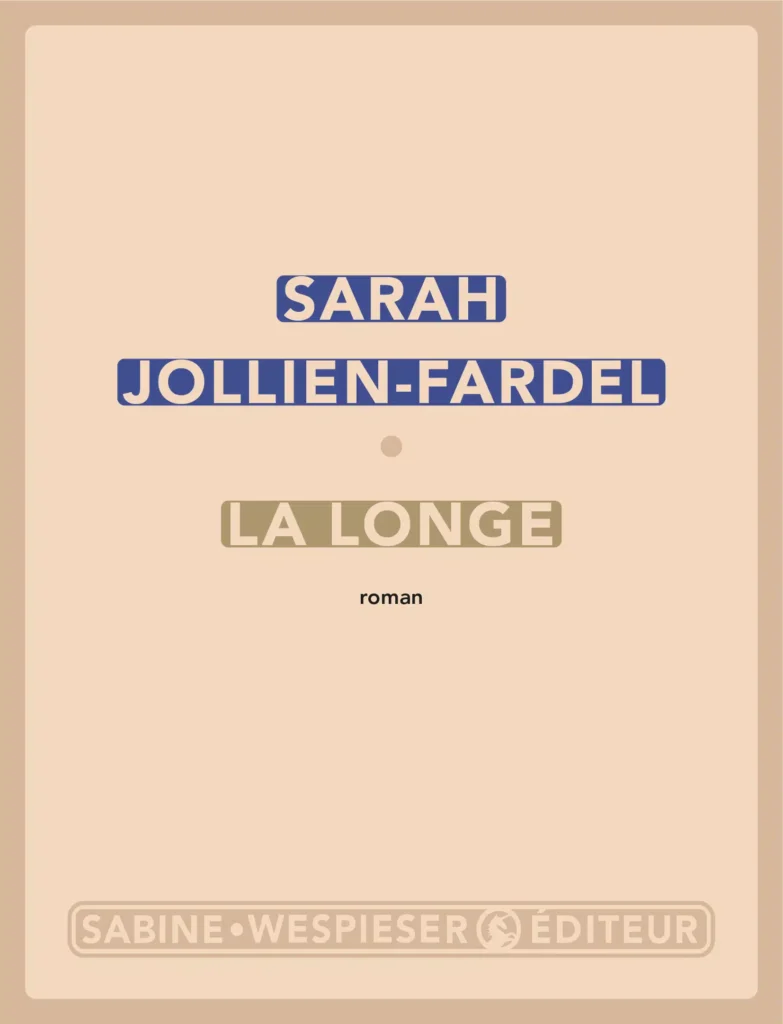
Depuis l’arrivée des policiers et l’annonce de la mort d’Anna, Rose ne vit plus qu’à moitié. Et encore. Elle s’engouffre dans une dépression, dans une crevasse si profonde qu’elle y perd pied. Cette ostéopathe, qui aimait tant apporter du soin à ses patients, ne parvient plus à assurer ses séances. Rose est devenue une capitale de la douleur. Elle mange en s’abrutissant devant la télévision, sans voir les images, ni entendre les commentaires, repassant en boucle dans sa tête la scène, apparemment accidentelle, de la mort de sa fille. Comment ces micro secondes ont-elles pu l’assassiner ? Camil, son compagnon de toujours, son amour de jeunesse et le papa d’Anna, n’a d’autre choix que de tenir. Il continue de travailler dans son cabinet d’architecture, dessine des plans et envisage le futur. Il tient à bout de bras sa bien-aimée. Spectateur impuissant de sa disparition, il essaie de relier les fils qui maintiennent Rose dans le monde. Mais elle les coupe, les uns après les autres, un jour après l’autre.
La brider, comme une bête, justement pour la sauver des bêtes qui peuplent sa tête.
Alors quand il est question d’enfermer Rose dans un hôpital psychiatrique, Camil ne l’accepte pas. L’enfermement se fera cependant, mais de ses propres mains. Le voilà réduit à faire l’insoutenable : attacher sa femme – qu’il aime, « Je le sais qu’il m’aime » explique Rose – à une longe. La brider, comme une bête, justement pour la sauver des bêtes qui peuplent sa tête. Ces fameuses bêtes qui attaquaient jadis la mère de Rose, Marie, et que rien ni personne n’avait pu maîtriser. Marie, figure maternelle s’il en est, est autant au centre de ce roman qu’Anna. Elles sont toutes les deux liées : la grand-mère et la petite fille. Elles ne se sont pourtant jamais rencontrées, toutes deux parties prématurément. Et la mort d’Anna se fait l’écho sanglant de celle de Marie. Elles hantent Rose, qui, esseulée, devient la gardienne de souvenirs trop lourds à porter : il y a ceux de sa mère, qui gravitent dans sa mémoire de fille, et il y a ceux de sa fille, qui inondent sa mémoire de mère.
« Si j’étais un oiseau »
C’est donc à travers un dispositif de contrainte forcée, un mari enchaînant sa femme à une longe dans une maison située en face de la montagne de son enfance, que la narratrice rassemble ces souvenirs. C’est dans cet immobilisme dont Rose est victime, dans ce grand noir qui l’ensevelit, qu’un chemin lumineux se dessine pourtant. Au départ, c’est une voix de femme qui lui parvient. Une voix basse qui murmure un extrait d’un roman de Marguerite Duras : « Les livres, le père les trouvait dans les trains de banlieue. Il les trouvait aussi séparés des poubelles, comme offerts, après les décès ou les déménagements. » Pour Rose, rien d’anormal : « Pour moi, à cet instant-là, coupée du monde depuis plusieurs semaines, dans les abîmes du tourment depuis bientôt trois ans, cloîtrée dans une chambre boisée, aucune distraction que la divagation de mon esprit, que l’observation du changement de lumière ou de la météo, la voix à travers la porte se glisse en moi. »
Rose devient la gardienne de souvenirs trop lourds à porter : il y a ceux de sa mère, qui gravitent dans sa mémoire de fille, et il y a ceux de sa fille, qui inondent sa mémoire de mère.
Rose, prostrée dans sa douleur, rassemble sa mémoire fragmentée pour interroger son passé. En tentant d’élucider les circonstances du drame, elle revient à ses souvenirs de jeunesse, les rituels qui la réunissaient avec sa mère et sa grand-mère lorsqu’elles descendaient de leur montagne pour gagner la ville, la toute première fois qu’elle a vu Camil, à 6 ans, entrant dans le bistrot de sa famille, le jour de sa première communion quand elle croyait à une aura mystérieuse… Pourquoi a-t-elle l’impression que la mort d’Anna était déjà là ? Un secret logé, silencieusement, dans le creux de ces jours, dans ses réactions violentes durant sa grossesse, et même dans la phrase que sa grand-mère avait inscrite au couteau sur une poutre de leur bistrot : « Tu es d’une espèce qui aime la lumière et déteste la nuit et les ténèbres. »
L’écriture de Sarah Jollien-Fardel est souple, élastique et permet à la douleur de survenir dans sa plus grande justesse sans que cela ne terrasse tout. Elle la contient, sans la brider. Ce qui laisse advenir tous les sentiments : de la plus insupportable souffrance au timide apaisement qui clôt, en nous soulevant le cœur, le roman. Car la vie résiste à la mort, la plus terrible soit-elle. Il est possible de survivre à la mort de son enfant, avec ce que cette réalité contient de terrible. Et de beau, aussi. La mort et la vie auront toujours les pieds et les poings liés.
- La Longe, Sarah Jollien-Fardel, Éditions Sabine Wespieser, janvier 2025.
- Crédit photo : © JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.