Une disparition peut en cacher une autre. Dans Safari, le nouveau roman de Sabri Louatah, l’auteur poursuit son œuvre dystopique. Plus près de la réalité, et donc plus cruel, le romancier du thriller politique à succès Les Sauvages nous emporte cette fois dans une fable où vie et mort se côtoient, un purgatoire, qui fait se réunir absences et apparitions, représentations et hallucinations. Qui est le narrateur ? De quoi a-t-il peur ?
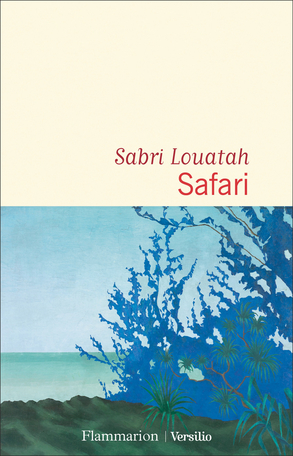
Vous êtes-vous déjà retrouvé seul, au milieu de la jungle, au cœur d’un environnement hostile, totalement isolé, en proie au doute tandis que vous réfléchissiez à votre situation de proie ? Perdu dans la savane, l’Homme voit sa supériorité s’amenuiser face aux lions et autres carnivores aux gueules proéminentes. Pas besoin d’être en Afrique au cœur d’une steppe aride pour ressentir cette peur bleue ; la « serre tropicale de Lincoln Park, à Chicago », suffit amplement.
En effet, sans se trouver dans un vrai safari, le narrateur du nouveau roman de Sabri Louatah, dont on ne connaît pas le nom, est immergé au cœur d’une vaste course-poursuite. Une partie de « cache-cache » défile entre les pages. Sans arme ni coup de fusil, mais avec force et mélancolie, l’histoire débute dans l’un des grands espaces verts de la ville américaine de Chicago où l’on fait la connaissance de ce narrateur énigmatique tirant par la main son fils, Eliott.
Hanté par la disparition de son père, ce personnage sans nom est guidé par une seule et unique volonté : le retrouver. Il touche du doigt ce rêve en faisant la connaissance fortuite d’un homme, Gabriel, avec « exactement la voix de (son) père ». Le Safari géant débute alors et le lecteur plonge dans un clair-obscur, sorte de chassé-croisé entre la vie et la mort.
En Gabriel, le narrateur semble retrouver la figure paternelle disparue. Mais plus le récit avance, plus l’assurance du narrateur disparaît. Paradoxalement, à la recherche d’un être disparu, il se sent peu à peu poursuivi. Chasseur ou proie ? Les rôles ne sont pas figés ; la vie ne tient qu’à un fil.
Le narrateur tente de soigner le mal par le mal en se confrontant au chagrin des autres pour mieux dissiper le sien.
Comment reprendre contact avec une personne disparue ? Est-elle seulement vivante ? Alors que la famille du narrateur s’est, au fil de ces années d’attente, résolue à faire rimer disparition avec mort, l’énigmatique personnage de Sabri Louatah perçoit les choses autrement. Ce dernier n’accepte pas l’omerta et souhaite se confronter à ses peurs. Gabriel est-il l’émanation de cet enfer pavé de bonnes intentions ou préfigure-t-il le Message divin lui intimant de continuer sa quête ?
L’esprit embrumé, partiellement malvoyant ; aveuglé par ses songes, possédé par une vie intérieure et antérieure dévorante, le narrateur se convainc lui-même. Tel un nouveau prophète, il se sent même investi d’une mission : réhabiliter les morts parmi les vivants. L’attente, le purgatoire, ne sont que des étapes. La révélation se trouve au bout du tunnel.
Louatah lie alors la profession de son personnage à sa quête. Ce dernier devient plus qu’un banal romancier : ses écrits « safaris » comme il les appelle, se veulent être des récits de réenchantements. Le narrateur se fait « nécromancien », écrivain de la dernière heure, mage noir aux procédés incantatoires.
Des mots pour panser des maux
Le narrateur tente de soigner le mal par le mal en se confrontant au chagrin des autres pour mieux dissiper le sien. Mais le procédé ne fonctionne pas et très vite le piège se referme : « mes lecteurs et moi (avons) glissé dans une faille métaphysique ». C’est cette nouvelle dimension où les morts semblent renaître, où la vie se conjugue à la fois au présent mais aussi au passé, que tente de décrire Sabri Louatah.
Artificiel, ce nouvel univers est aussi cruel. Passés les quelques moments de rêveries doucereuses, l’âpreté du dehors, au-delà des récits fictionnels qui font office de thérapie, se fait ressentir. Comment lutter contre une disparition ? Où voir la lumière lorsque l’ombre de celui que l’on recherche s’est effacée dans les brumes opaques de nos destinées funestes ? La désertion d’une figure appelle souvent chez l’Homme un besoin d’identification ou de reconnaissance.
Sabri Louatah livre une histoire originale sur la question de la mort et les blessures béantes qu’elle administre à ceux qui restent.
Le narrateur, accompagné de son seul stylo, entouré des morts qu’il ressuscite sur commande, souhaite trouver la vie ; un nouveau souffle sur une existence mortifère, telle cette Ombre du vent décrite par Carlos Luis Zafón qui fait ressusciter les damnés enterrés grâce à la lecture des vivants.
Dans cette confrontation avec la fin pour arriver à ses fins, le narrateur n’a cependant pas recours aux livres comme dans l’œuvre de l’Espagnol, mais à la peinture. Sabri Louatah présente ainsi son personnage en proie à une « obsession » pour Omid Safari, peintre imaginaire. On sait peu de choses sur cet artiste disparu au début du XXIe siècle. Cette opacité renforce la curiosité du narrateur qui y voit un « artiste de la disparition ». Aux travers des toiles, une relation intime, interartisitique, se crée.
Duel avec la mort
Sur ces tableaux, aucun humain ; seulement des paysages, des « forêts californiennes » mais aussi des animaux, des “Chiens enragés aboyant sur des hommes à la peau brune”. Pourtant, ce dernier a une peur irrationnelle de ces meilleurs amis de l’Homme ; comme s’ils représentaient une menace imminente, que leurs passages annonçaient la fin de quelque chose, sinon le début d’une nouvelle ère.
Cette confrontation avec ce qui l’effraie et le rend nerveux, semble libérer quelque peu le poids que porte le personnage. Mais le répit est de courte durée et plus le récit avance, plus le narrateur semble s’emprisonner.
Dans un dernier espoir naïf, il se dresse pour renoncer à acter la mort de son père ; « la mort n’était jamais qu’une hypothèse ». À l’instar de ses écrits « safaris », le narrateur veut se persuader qu’il est encore maître de ses choix, que la ligne d’après n’est pas encore écrite ; que le temps de la « résurrection » est encore possible.
https://zone-critique.com/critiques/jangot-critique/
Au fil de cette destinée tragique, le Safari, ce duel annoncé entre l’Homme et l’animal, se décompose, se complexifie, jusqu’à donner son verdict : « C’était moi le chien méchant » ! Le narrateur ne lutte en réalité contre aucune bête enragée. Seul face à ses écrits, il lutte pour sa survie contre lui-même, tout à la fois chasseur et chassé.
À travers ce combat acharné, Sabri Louatah livre une histoire originale sur la question de la mort et les blessures béantes qu’elle administre à ceux qui restent. Un Homme peut-il affronter seul un deuil ? Peut-on tirer un trait sur quelque chose d’irrésolu ?
Tous ces questionnements acculent le personnage qui ne semble plus, au fil des pages, être maître de lui-même. Le cours de l’histoire finit par lui échapper. On ne peut indéfiniment lutter contre ce qui est intangible et tout à la fois prégnant : l’absence. Et, dans son sillage, la solitude arrive alors bien vite. Parfois, même cent ans ne suffisent pas pour s’en défaire.
- Safari, Sabri Louatah, Éditions Flammarion/Versilio, janvier 2025, 21 euros.
- Crédits photo : ©Niko Rodamel.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.