Isabelle Sorente poursuit son œuvre d’écrivaine-alchimiste avec son nouveau roman Medusa, en lice pour le prix Renaudot, un récit mythologique et mystique où elle interroge l’histoire des femmes à travers la notion de douleur. Accompagnée par la figure de Méduse, elle revient sur l’histoire de Marianne, morte à vingt ans entre les mains de son petit ami. Dans ce roman enraciné dans les terres escarpées de La Ciotat, baigné par la lumière de la Méditerranée, Isabelle Sorente tente un geste alchimiste en essayant de transformer l’ancienne douleur des femmes.
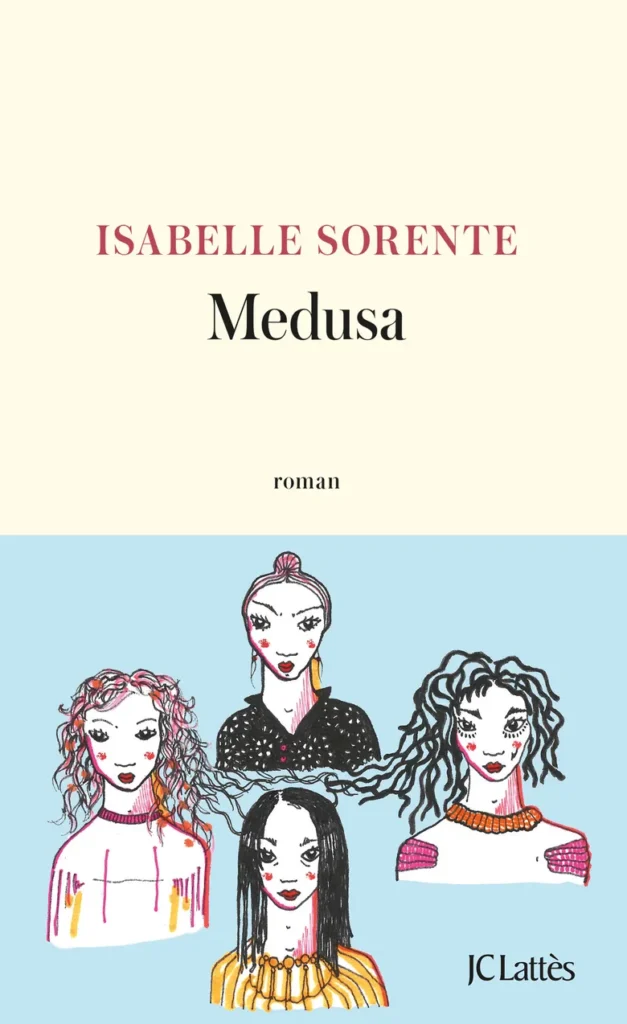
Une femme est morte
Le roman s’ouvre sur une scène inaugurale qui pourrait être un fait divers récent : « Ses paumes sont tournées vers le plafond. Le bracelet en perles de bois est le seul bijou que porte Marianne. À part le collier. Un collier beaucoup trop serré. Un collier fait de deux mains qui la tiennent par le cou. Et qui serrent ». Il pourrait s’agir d’un féminicide, mais on apprend rapidement que Marianne est morte par accident. L’innocence du petit ami, Édouard Lemée, a été incontestablement écartée par le médecin légiste et le juge. La qualification d’homicide involontaire n’a pas été retenue. Pourtant, le malaise persiste, car la disparition de Marianne est marquée par la strangulation, une scène archétypale qui rappelle des souvenirs insupportables. Les conditions de sa mort sont un écho inévitable de l’histoire des féminicides. Même si la culpabilité d’Édouard Lemée n’est pas engagée, la mort de Marianne réveille une ancienne mémoire indissociable de l’événement.
Après la mort de Marianne, son frère Liam est hanté par une intuition. Il est certain que la toute dernière pensée de sa sœur a influencé le cours des événements et le monde dans lequel il vit désormais. Béatrix, la meilleure amie de Marianne en est également convaincue. Elle confie à Liam : « […] moi aussi, je suis hantée par la dernière pensée […]. Je crois que tu as raison. Elle a forcément influencé nos vies ». Derrière la quête de la dernière pensée, qui n’est pour Liam et Béatrix qu’une intuition, se cache une interrogation implicite : Marianne sait-elle comment elle est morte ? A-t-elle quitté le monde avec le souvenir d’un féminicide ou d’un accident ? En quels termes faudra-t-il se souvenir de sa mort ? Ces interrogations sont d’autant plus importantes que, dans le roman, les réseaux sociaux et la presse imposent d’emblée leur interprétation de l’événement : « ELLE TROUVE LA MORT DANS UN JEU SEXUEL, par Adolfo Chamaille. Mona* et son petit ami voulaient essayer des jeux de domination pour pimenter leur relation » relate un magazine masculin. Un site féministe publie un article intitulé : « CENT-CINQUIÈME FÉMINICIDE DE L’ANNÉE. M., vingt ans, étudiante, étranglée par son petit ami ».
En choisissant de raconter un cas limite, Isabelle Sorente ouvre une réflexion sur la zone grise, ce fameux espace d’indétermination censé s’éclaircir par la magie du mot consentement.
En choisissant de raconter un cas limite, Isabelle Sorente ouvre une réflexion sur la zone grise, ce fameux espace d’indétermination censé s’éclaircir par la magie du mot consentement. La mort de Marianne et ses circonstances particulières suggèrent qu’il ne suffit pas d’avoir consenti pour que le trouble se dissipe. Marianne était consentante, mais le fantasme de strangulation fait obligatoirement de sa mort un accident du patriarcat.
Une mémoire mythologique
La persistance du trouble vient de ce que le fantasme de strangulation peut difficilement être réduit à un simple jeu sexuel. Il charrie inéluctablement des images d’agressions et de viols. Marianne n’a pas échappé au male gaze, ce regard masculin qui érotise la violence et l’anéantissement du corps des femmes. Le temps d’un fantasme, cette fille grande à la mâchoire carrée, qui « ne s’est jamais trouvée belle », et qui a été insultée de « travelo », voulait devenir la fille fragile et correspondre à l’image qui excite le désir masculin. Adolescente, une amie l’avait prévenue, « une vraie fille […] est censée être fragile […] Tu es peut-être fragile intérieurement. Mais physiquement, ce n’est pas l’impression que tu donnes. Or, ça compte l’impression que tu donnes. Une fille doit inspirer l’envie de la protéger ». À l’inverse, le personnage de Béatrix ne supporte pas sa beauté exceptionnelle. Pour échapper au regard des hommes, elle se donne l’image d’une fille sévère et inatteignable en portant systématiquement un « chignon d’impératrice ». Soit qu’il faille se rendre plus vulnérables ou moins attirantes, les femmes doivent constamment s’adapter et transformer leur apparence. C’est la lecture que propose Isabelle Sorente du mythe de Méduse, personnage éponyme du roman.
https://zone-critique.com/critiques/caroline-ducey-la-predation
Dans la mythologie grecque, Méduse est violée par Poséidon dans le temple d’Athéna. Pour se venger de la violation de son temple, Athéna condamne Méduse et la transforme en monstre. Ses cheveux deviennent des serpents. Deux longues canines semblables à celles d’un sanglier lui poussent entre les dents, et bien sûr, son regard a désormais le pouvoir de pétrifier quiconque le croise. Comme elle l’explique au micro de Christine Gonzalez dans le podcast Question Genre, Isabelle Sorente avait été choquée lors de sa première lecture du mythe. Méduse est punie alors que Poséidon est coupable. Elle doit changer d’apparence pour ne plus éveiller le désir masculin. Méduse, la jeune fille dont « rien n’était plus remarquable que sa chevelure » devient un monstre. Isabelle Sorente voit dans le mythe de Méduse un cas exemplaire de ce qu’elle nomme l’ancienne douleur des femmes. Le personnage de Marianne affirme ainsi « Nous sommes toutes les filles d’une femme changée en monstre ».
Il existe donc une filiation entre la mort de Marianne et le mythe de Méduse. Isabelle Sorente articule ces deux histoires à travers un dialogue que la narratrice entretient avec une mystérieuse Muse venue lui demander de changer le cours de l’histoire. Cette mémoire ancestrale, inscrite au plus profond de nos imaginaires par l’intermédiaire de la mythologie, a peut-être la possibilité d’être transformée par l’écriture.
L’écriture alchimique
Marianne meurt au moment où elle avait fait le choix de devenir écrivaine. Elle veut se consacrer à l’écriture, car elle la pratique comme un art de la métamorphose depuis son enfance. À onze ans, elle participe à un concours de nouvelles pour lequel elle écrit un texte intitulé Je préfère les monstres aux princesses. Elle vient de subir une agression sexuelle et elle raconte : « Je crois que les contes ne nous disent pas toute la vérité ». À propos du baiser qui change le crapaud en prince, elle explique : « Si le monstre se transforme en prince, ça n’est pas parce qu’il aime la princesse. C’est parce qu’il se débarrasse de sa monstruosité grâce à elle. C’est elle le monstre désormais, c’est elle qui porte pour deux l’anormalité, la honte, les secrets ». Plus tard, elle prend l’habitude de modifier la fin des contes avec son amie Béatrix. Elle imagine que la petite sirène tue le prince et que le petit chaperon rouge déclenche un AVC chez le loup. Devenue étudiante en lettres, elle confie à Édouard au sujet de sa vocation d’écrivaine : « Ce sont les monstres femmes qui m’intéressent […] Car cette mutilation psychique dont tu parles, l’impossibilité de dire ce qu’on nous fait, les adjectifs étroits comme des camisoles ou durs comme des muselières, les émotions inavouables, les cicatrices inexplicables, c’est le sort de toutes les femmes dans toutes les langues du monde » avant de conclure « Nous sommes toutes des monstres à la recherche d’un mot perdu ». Face à l’absence de certains mots essentiels pour nommer l’expérience des femmes, Marianne choisit de réécrire les mythes, les contes et les légendes. Le désir d’écriture de Marianne est intimement lié à la nécessité qu’elle éprouve de transformer les mémoires laissées en héritage aux femmes.
Face à l’absence de certains mots essentiels pour nommer l’expérience des femmes, Marianne choisit de réécrire les mythes
Ce désir de transformer la mémoire par l’écriture est également celui du double littéraire de l’autrice dans le roman. Il s’agit d’une question que se pose Isabelle Sorente à travers la voix de la Muse qui demande à la narratrice : « Que faire de la douleur des femmes, que faire de la douleur des monstres ? Que faire de la douleur transmise de mère en fille ? Si nous lui restons fidèles, rien ne change ? Si nous la trahissons, elle nous rattrape. Alors que faire ? ». À plusieurs reprises, la Muse interrompt le récit de cette façon pour questionner la narratrice. Ces passages métadiscursifs sont l’occasion pour l’autrice de faire apparaître, au sein même du roman, ses propres interrogations quant à sa pratique de l’écriture et à sa fonction d’écrivaine. Quelle est sa responsabilité en tant que femme et en tant que romancière ? Ce dispositif narratif original permet à Isabelle Sorente de prolonger une réflexion sur la transmission et la souffrance engagée depuis Le complexe de la sorcière où elle expliquait : « Nous héritons tous d’une terre. Une terre noire et profonde […] Que pouvons-nous faire à part la cultiver ? Nous pouvons aimer notre mémoire, l’aimer comme une vie plus forte et plus vieille que la nôtre, l’aimer comme un monde, comme un écosystème, ne pas l’empoisonner avec de vieilles rancœurs, puisque la terre est commune, puisque toute frontière n’est jamais qu’une barrière fragile, aléatoire, franchissable. En dessous, tout communique ». Pour l’autrice, la réécriture du mythe de Méduse n’est pas qu’un geste littéraire. Il s’agit également d’un geste mystique par lequel elle espère métamorphoser les mémoires souterraines qui nous relient tous.
Avec Medusa, Isabelle Sorente confirme son double attrait pour la littérature et la spiritualité. Elle y affirme avec force sa croyance dans la vie spirituelle des textes et nous rappelle qu’il faut les prendre suffisamment au sérieux, car ils agissent toujours sur nous au-delà des frontières du temps et des langues.
- Medusa, Isabelle Sorente, JC Lattès, 2024.
- Crédit photo : © Patrice Normand

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.