Louis Vendel a vingt-neuf ans. Il a fondé plusieurs médias littéraires, dont La Lettre Zola. Accompagné de l’écrivain Victor Dumiot, il revient sur son premier roman : Solal ou la Chute des corps, un vibrant récit inspiré de son ami souffrant de troubles bipolaires, publié aux éditions du Seuil collection « Cadre rouge », en janvier 2024.
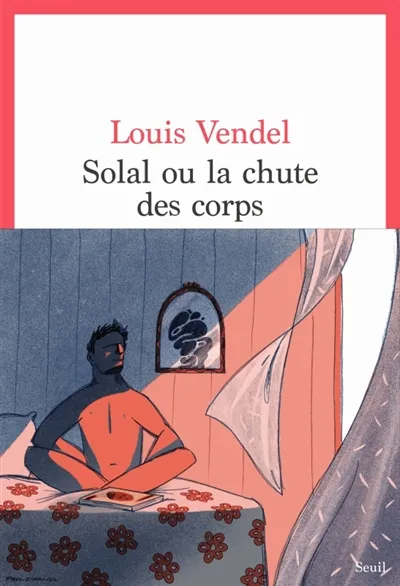
Victor Dumiot : Pourrais-tu commencer par détailler ton parcours ? Comment es-tu arrivé dans l’écriture, comment l’écriture est-elle arrivée jusqu’à toi ?
Louis Vendel : Je n’ai jamais vraiment fait autre chose qu’éditer des textes. J’ai eu l’immense chance de fonder puis diriger des médias que j’avais créés. Mon premier média un peu sérieux, remonte à mes 20 ans – j’étais encore étudiant à l’époque, et l’avais construit avec quelques amis sous la forme d’une association qui s’appelait : « Unsighted ».
Plus tard, et toujours avec le même ami et associé, m’est venue l’idée de créer une structure, qui aurait cette fois les caractéristiques d’une maison d’édition. De là est née l’idée de La Lettre Zola.
En ce qui concerne mon rapport personnel à l’écriture, cette envie a toujours été présente, mais s’est renforcée au fil des années.
V.D. : Tu « rentres en littérature » avec ce premier roman, Solal ou la chute des corps (Seuil, janvier 2024), comment est-ce que tu présenterais aux lecteurs ton livre ?
L.V. : Solal ou la Chute des corps, est un livre assez délicat à classer, comme j’ai pu le découvrir à la suite de sa promotion. Or un positionnement hybride, ici en l’occurence, entre fiction et réel, n’est pas une chose si commune, malgré un essor important de la « littérature du réel ». Ce livre est un récit, puisqu’il s’agit d’une histoire vraie. Pourtant, il est écrit comme un roman et publié dans la collection littéraire « Cadre rouge » du Seuil. Ce n’est donc pas seulement de la « non-fiction » ou du « journalisme littéraire », c’est un « roman vrai ». Et ça, je ne sais pas si c’est tout à fait lisible pour le grand public et la critique…
Pour décrire mon objet, je dirais qu’il s’agit avant tout d’une histoire « vraie », retranscrite quasiment en tout point sous la forme d’un roman. C’est ainsi que j’ai pu approfondir le langage littéraire, et y trouver une originalité…
V.D. : Par la forme, donc ?
L.V. : Oui, surtout au niveau de la forme, puisque mon personnage, Solal, est aussi mon ami dans la vraie vie. Donc, comme j’étais désireux de proposer une matière littéraire exigeante, mais que je devais aussi être à l’écoute de mon ami, j’ai coupé certains passages qui allaient un peu trop dans le lyrisme, voire amendé mon texte lorsqu’il trouvait que les états d’âme du personnage, c’est-à-dire ses propres émotions, n’étaient pas assez bien retranscrites.
Tout cela m’a permis d’ancrer le roman dans un processus d’écriture original, où le personnage principal est aussi le premier lecteur.
V.D. : La dimension littéraire est en effet très présente dans ton livre. Or c’est un exercice difficile que d’orchestrer son écriture, pour à la fois s’emparer du réel, chercher la vérité, et tout simplement écrire, avec ce que cela suppose de débordements, de dépassements, voire de falsification. N’as-tu pas eu l’impression de te heurter, constamment, à deux vérités ? La tienne, celle de l’écriture, et celle de ton ami ? Et question complémentaire, peux-tu revenir sur la genèse de votre amitié, laquelle est, d’une certaine façon, aussi la genèse de ce livre ?
L.V. : J’ai rencontré Solal au début de ma vingtaine, c’était alors un camarade de promotion et nous sommes très vite devenus amis. J’ai tout de suite remarqué en lui quelque chose d’hors du commun. Et j’ai découvert plus tard que, ce que je prenais pour un grain de folie, une originalité, était en réalité les symptômes de ses phases hautes et basses. Pour moi, Solal c’était d’abord un personnage romanesque, et jamais je n’aurais imaginé, à cette époque, qu’il puisse avoir une maladie quelconque. C’est seulement plus tard, lorsque le diagnostic de bipolarité est tombé, que j’ai compris.
Ensuite, la question de faire de Solal le sujet de mon roman m’a traversé un jour comme une épiphanie. Il effectuait alors son tour du monde à pied, projet complètement fou, en passant par les Balkans. Je me souviens avoir trouvé cette entreprise de tour du monde elle-même très romanesque, et dans une sorte d’excitation, je lui ai proposé, à quatre heures du matin, de devenir le personnage de mon roman.
V.D. : Au fond, entre son entreprise personnelle, un peu folle, celle de parcourir le monde sur une sorte de coup de tête, et la tienne, écrire sur Solal, il y a un lien évident. C’est une manière de poursuivre l’amitié à distance, non ?
L.V. : L’écriture de ce livre s’est déroulée de façon « naturelle ». Aucun « obstacle » n’est venu se poser dans la récolte de la matière première que constitue la vie de Solal, aucune résistance non plus dans ma manière d’écrire sur lui « au fil de l’eau », malgré son regard et ses remarques sur mon texte.
Je ne sais pas vraiment si Solal ou la Chute des corps, s’est conçu comme un moyen de poursuivre notre amitié, mais, après deux ans et demi à faire des allers-retours sur le texte, ou réfléchir à ses perspectives d’amélioration, tout cela l’a de toute évidence renforcée.
C’était drôle, Solal trouvait toujours le temps de me répondre, alors même qu’il se trouvait parfois à douze mille kilomètre, au Cambodge, ou qu’il traversait les Balkans en hiver.
V.D. : Est-ce que l’on passe un pacte, avec soi, avec son ami, lorsque l’on écrit ainsi sur de la matière vivante ? De surcroît t’es-tu posé certaines limites dans cette quête du « réel », comme des clauses à respecter ?
L.V. : C’est difficile à dire. Le pacte vis-à-vis de Solal, c’était, je crois, de me permettre de m’exprimer sur ses agissements, d’avoir la liberté de décrire son « être » dans toute sa subjectivité. Il aurait pu s’opposer à l’utilisation de son image, chercher à contrôler le texte, car par moment, malgré toute sa bienveillance, je porte aussi un regard assez critique sur ses agissements. Mais Solal a reçu tout cela avec une intelligence qui a dépassé mes espérances.
Lorsque des auteurs tels que Florence Aubenas, Emmanuel Carrère, ou même Mathieu Palain dans Ne t’arrête pas de courir, écrivent sur les autres avec l’idée de retranscrire le réel, cette notion de « pacte » avec son sujet devient nécessaire. Chez d’autres écrivains, cette notion d’accord tacite va même très loin, dans la mesure où le sujet se trouve enlevé de son droit de relire. C’est une position assez journalistique, interprétative finalement. Essayer de raconter « le vrai » dans toute sa subjectivité, en prenant en compte que les souvenirs peuvent parfois s’altérer. Avec Solal cette forme de rigueur s’est tout de suite imposée.
https://zone-critique.com/critiques/grandes-figures-de-la-litterature-contemporaine/
V.D. : Ce que l’on ressent à la lecture de ton livre, le pacte véritable, c’est peut-être la profonde tendresse (amicale) envers ton sujet. C’est quelque chose d’assez rare, cette question de l’amitié, dans la littérature française. On y pense peu, non ? Est-ce que tu as eu peur de blesser Solal, parfois, en l’écrivant ?
L.V. : À vrai dire, la question de la réception de son image ne s’est jamais totalement posée car Solal est totalement ouvert à l’idée de partager son histoire. Ce n’est pas un homme pudique. En revanche le renvoi à ses souffrances, à ses moments de doute, ou à d’anciens épisodes traumatiques – comme sa chute du balcon –, lui ont évidemment serré le coeur à la relecture. Aussi, la description de ses phases basses, apathiques, ont pu aussi le renvoyer à des moments plus sombres de son existence, mais cela n’a jamais impacté l’objet et son sujet.
V.D. : Ce qui m’interpelle le plus, dans ton roman, c’est que vous avez tous les deux des dynamiques contraires, mais complémentaires. Solal est une « force qui va », pour reprendre la formule de Hugo, c’est un homme qui avance tout droit, qui n’a pas de passé, presque. Tandis que toi, ton mouvement est inverse, par l’écriture tu viens chercher les racines, tu enracines Solal à son passé, lui offrant une épaisseur nouvelle, qui peut être désagréable. Ce double mouvement dans le récit est-il volontaire ?
L.V. : C’est une belle façon de présenter le sujet de mon livre, que d’appréhender cette notion de double mouvement : Solal qui va vers l’avant, en pensées, d’une manière pragmatique, et moi, à l’inverse, fouillant dans ses souvenirs et son passé, le ramenant à un mouvement « arrière ». Je précise d’ailleurs que, pour ce livre, Solal refuse catégoriquement les appellations de : « narration de résilience » ou de « narration thérapeutique ». Pour autant, à certains moments, ce livre l’y confronte, le pousse dans ses retranchements, presque comme une forme d’introspection.
V.D. : Deux grandes tendances dominent actuellement la littérature. La première, celle du récit de soi, la deuxième, celle l’écriture du réel. Qu’est-ce que cette quête de réalisme, de réalité, ou de volonté de transparence dit de notre époque ?
L.V : Mon interprétation, très subjective, est que l’on arrive dans un monde dénué de repères, où la société organisée selon la matrice judéo-chrétienne tend à se déliter. À une époque où les repères s’étiolent, où l’incertitude s’installe, je pense qu’il est d’une certaine manière « normal » de se concentrer sur un sujet que l’on connaît et que l’on explore tous les jours, ce qui fait sens et induit cette notion d’écriture de soi. Le fait d’entreprendre une démarche auto-fictive peut être un excellent moyen de sonder les états d’âme des autres, même si j’essaye de me sortir de certains écueils nombrilistes que cela pourrait présenter.
V.D. : On dit beaucoup que la poésie a disparu. Mais n’est-ce pas plutôt que de sa démarche, à savoir, quitter les archétypes pour se concentrer sur le plus singulier, l’émotion d’une tomate cerise dégustée lors d’un barbecue le dimanche, en famille, à Cambrai, afin de toucher à l’universel. Du petit au grand récit… Quel est ton rapport à la fiction ? A l’imagination… Car à t’entendre, on pourrait penser que tu as déclaré la guerre à l’imagination.
L.V : Je ne m’inscris pas du contre cette démarche de fiction ou d’imagination, au contraire. Le projet de La Lettre Zola est de retranscrire des histoires vraies, qui racontent le réel, mais avec tous les outils de la fiction. Et je pense par ailleurs que toute fiction est un prétexte pour raconter le réel.
https://zone-critique.com/critiques/francois-begaudeau-entretien/
Un ouvrage fictionnalise toujours le réel, et même quand il semble très éloigné de notre réalité, il demeure parsemé de questionnements qui traversent la société, l’époque. Si j’écris un deuxième livre, je me sens aujourd’hui beaucoup plus armé à toucher à la fiction, car c’est un excellent moyen de toucher au réel pour le dépasser.
V.D. : Est-ce que tu dirais que nous vivons aujourd’hui une « crise » de la fiction ? Je prends pour exemple les procès en illégitimité, faits à certains auteurs qui sont aujourd’hui légion. Car la fiction inquiète d’une certaine manière. On reproche aux écrivains d’avoir les mains sales et de salir leur sujet à cause de leur méconnaissance des choses. Or ce procès, je peux le comprendre en sociologie, je peux le comprendre en ethnologie, mais en littérature… Comment imaginer une littérature sans aucune confrontation avec l’altérité ? Même une littérature expurgée d’une forme d’injustesse, c’est le rêve d’une littérature éthérée, donc molle, plate, passe-partout, non ? La littérature se trompe, et c’est en cela qu’elle a raison.
L.V : Je manque d’exemples, afin de contextualiser ce propos. À première vue, il me semble que le renforcement du poids de l’auto-fiction dans le paysage littéraire français se comprend et s’inscrit dans l’époque. C’est la conséquence de nombreux combats sociaux qui nous traversent et nous bousculent : le consentement, les violences conjugales, jusqu’à des regards historiques sur la Shoah ou les génocides… Je ne crois pas à la disparition de la fiction car les écrivains restent en première ligne de la transcription du monde.
https://zone-critique.com/critiques/victor-dumiot-il-faut-destabiliser-le-lecteur/
V.D. : Pourrais-tu revenir sur le projet de La Lettre Zola, autre moyen d’éclairer ton oeuvre ? Quels principes as-tu voulu porter à travers ce média ?
L.V. : De la même manière que Solal ou la chute des corps, La Lettre Zola vise à dire le monde selon un prisme réaliste mais en investissant les mêmes procédés d’écriture que la fiction… Le principe de La Lettre Zola est de faire écrire les jeunes romanciers et romancières sur la société française à travers un format que nous jugeons original, poétique, et cohérent avec la crise actuelle du livre. Il invite en quelque sorte la littérature dans la boîte aux lettres de nos lecteurs, puisqu’il s’agit d’une publication par abonnement et par voie postale. Chaque mois, nos abonnés reçoivent un texte inédit d’une cinquantaine de pages dans un « livre-enveloppe », une histoire vraie écrite par une (et une seule) jeune plumé primée, sur un (et un seul) sujet de société. Ce n’est pas une revue, ce n’est pas une collection d’articles, mais un petit livre mensuel. Il y a évidemment une ressemblance évidente entre le format de mon livre et celui de La Lettre Zola dans la transcription du plaisir de la lecture, une grille de lecture différente par son approche littéraire du réel.
V.D. : C’est une composante essentielle qui peut aussi se voir dans ton livre Solal ou la chute des corps : l’importance de la langue littéraire laissant place au surgissement de la fiction.
L.V. : Dans le journalisme, comme dans la littérature, il s’agit pour moi du même phénomène : « figer le réel », afin de mieux l’interpréter. Une fois que ce réel est fixé sur papier, comme une photographie de son époque, la question du médium reste importante. Il y a des avantages très concrets dans cette ambivalence des formes : le plaisir que l’on donne à lire aux abonnés, en ne s’éloignant pas du renforcement de la compréhension du monde.
- Louis Vendel, Solal ou la Chute des corps, éditions du Seuil, janvier 2024.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.