Dans un petit village du sud-est de la France, deux couples de vignerons tentent de maintenir leur exploitation malgré les caprices du temps et les difficultés financières. Pour son deuxième roman, Seules les vignes, Lolita Sene tente de rendre hommage à son métier de paysan vigneron en nous racontant l’âpreté de la vie agricole et la beauté des coteaux. Mais ce qui s’annonce comme une ode à la vigne se révèle être une longue complainte, dont ressort, non sans surprise, un désamour du métier.
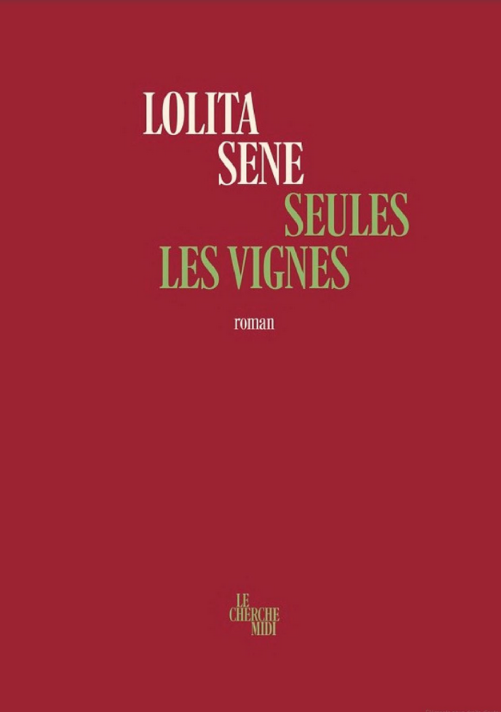
Lolita Sene nous livre une description fidèle et vivante de son métier. Tout au long du texte, elle parvient à nous faire ressentir l’angoisse et l’épuisement de ses personnages viticulteurs, Arnaud, Nathalie, et Le Jeune, allégorie de tous les jeunes paysans, enthousiastes, mais déjà accablés. Arnaud redoute la pluie, l’orage et la grêle. Il passe son temps à humer l’air et à décrypter le moindre froissement des feuilles. Nathalie, sa compagne, s’inquiète de l’acidité du raisin, qu’elle consigne chaque jour dans un carnet, et prie pour que la fermentation réussisse. Le Jeune doute de ses assemblages et craint de produire un mauvais millésime.
Ces détails ont toute leur importance. Une récolte peut être balayée d’un revers de main par un épisode cévenol ou le mildiou. L’extrême dépendance aux conditions météorologiques donne d’ailleurs de très beaux passages, où les effets de rythme racontent autant l’instabilité du climat méditerranéen que le quotidien des personnages : « Pourtant, quelques heures plus tard, le ciel vire au céruléen, une mer sans nuages, le soleil chauffe les feuilles, aspire les gouttelettes, assèche la brume. Plus tard encore, la grêle tombe en trombe. Plus tard encore, il pleut. »
Les pages consacrées aux gestes du métier sont parcourues par la même recherche de rythme. À plusieurs reprises, Lolita Sene dresse des listes d’infinitifs pour condenser en quelques lignes tout le travail d’une journée. L’effet est réussi, on ressent la pression, l’enchaînement des corvées et l’accumulation des tâches qui n’attendront pas le lendemain. Il est parfois poétique, comme cette longue liste de choses à faire qui se conclut par « Contempler le ciel au crépuscule, ses liserés orange et rose contre les nuages. Faire la sieste, faire la fête. Dormir ».
L’émotion poétique est malgré tout assez rare. Dans la description des gestes et des grands rituels du métier, dominent principalement l’agacement et l’usure des personnages. Nathalie ne supporte plus d’accueillir chaque saison les vendangeurs dont l’arrivée est décrite dans les termes d’un « envahissement » et d’une « propagation ». Le Jeune déteste tous les à-côtés du métier, les salons et les rencontres avec les sommeliers et les journalistes. Il devient excessivement aigri et se reclut dans la position de l’homme incompris.
On ressent la pression, l’enchaînement des corvées et l’accumulation des tâches qui n’attendront pas le lendemain.
À force d’insister sur la dureté du métier, ce qui passait pour une recherche de vraisemblance se transforme progressivement en une longue complainte. Les vignes, pourtant annoncées comme le sujet principal du roman, se trouvent reléguées au second plan.
Seules les vignes manquent…
Il n’aurait dû être question que d’elles, de ces vignes très joliment décrites, avec leurs « billes noires juteuses et pleines » et leurs pieds « généreux, éclatants, robustes », mais elles peinent à exister comme un personnage à part entière. Preuve en est la nécessité qu’a éprouvée l’autrice de dédier le dernier chapitre, « Hiver », à la vigne, en la faisant s’exprimer à la première personne. Dans ce court chapitre – une dizaine de pages – la plante jusque-là silencieuse raconte l’histoire des hommes qui l’ont cultivée depuis sa mise en terre un siècle plus tôt, en 1901.
Malheureusement, dans ce bref historique, il est davantage question du désintérêt des humains pour la vigne, des enfants qui « trouvent que les herbes piquent les mollets », des jeunes qui « n’aiment pas le paysage », que de la vigne elle-même, dont le sort est d’être dénudée de ses feuilles par « une équipe d’hommes taciturnes et silencieux ». On finit donc par se demander qui apprécie véritablement la vigne et ses coteaux, d’autant que tous les personnages et le texte lui-même sont irrésistiblement attirés par les îles et les lagons bleus.
Des vignes et des vagues
Le personnage d’Arnaud « rêve de plages couleur azur, d’eau de noix de coco fraîchement tranchée ». Quand il songe à ce que deviendra son exploitation dans vingt ans, le texte nous indique qu’il « se voit déjà sur une plage sans coquillage, face à un lagon transparent, le sel qui recouvre sa peau et ses cheveux ». Plus tard, on apprend que le père du Jeune, ancien paysan, a quitté femme et enfants pour rejoindre « une île au fond du Pacifique ». Même la vigne est comparée à « une île au milieu du bitume et de la pierre », avec sa « mer de galets jaunes et ronds » et ses « restes de coquillages ».
Le fantasme de l’isolement insulaire est une façon d’insister sur le labeur du métier et sa dimension presque sacerdotale, mais on le comprend surtout comme le symptôme d’un sentiment de ras-le-bol général. Rien ne vient en effet contrebalancer l’envie pressante de tout quitter. Au lieu d’un hommage, Seules les vignes semble donc raconter l’histoire d’une déception.
https://zone-critique.com/critiques/oh-canada/
L’art de la complainte
Si Arnaud et Nathalie ont choisi de devenir vignerons, ils ne semblent pas très satisfaits de leur décision. Arnaud ne songe qu’à partir. À l’aube d’une nouvelle journée de vendange, Nathalie se demande « pourquoi elle se sent si proche et si loin de ce qu’elle fait » comme si elle était absente à elle-même ou peut-être n’aime-t-elle tout simplement pas son métier. Le Jeune quant à lui est devenu vigneron « un peu par dépit, un peu avec tristesse ». Il finit par rêver de passage à l’acte au milieu de ses cuves : « Parfois, il voudrait tout envoyer valdinguer, tirer sur la vanne et contempler les hectolitres de rouge se déverser dans la cour, au caniveau, sans rien ressentir ». Dans ces conditions, on voit mal ce qui les retient tous puisque ce n’est visiblement pas l’amour de la vigne.
C’est pourtant dans l’expression de la frustration que Lolita Sene livre ses portraits les plus délectables. Le moment des vendanges est ainsi l’occasion d’une liste des « profils auxquels on ne peut échapper » comme « Ceux qui sont de passage dans cette vie, qu’on ne verra plus jamais, mais qui ont pourtant tant d’avis à donner. Celui qui étudie la viticulture et veut tout savoir, tout comprendre, qui pose trop de questions et rend fou à la longue. Celui qui a soixante ans passés, bronzé, tout sourire et dents blanches, en forme olympique, qui n’est là que pour draguer. Ou qui est trop jeune dans sa tête et son corps et qui ne passera jamais la semaine ».
Plus loin, l’autrice en profite pour tacler les journalistes en se moquant des mots qu’ils utilisent pour parler du vin « ils emploient des adjectifs rares pour le décrire, disent que c’est sans contemption, absolument jubilatoire, expansif, pas du tout putassier ».
Lolita Sene semble donc régler ses comptes avec tout ce qu’elle déteste dans son métier, les contraintes, la météo, la fatigue, les difficultés financières, et tous les acteurs qui le composent. Rien ni personne n’en sort vraiment épargné… Restent cette langue pittoresque et cet art du portrait qui font de Seules les vignes un roman savoureux.
- Seules les vignes, Lolita Sene, Éditions Le Cherche midi, 2025.
- Crédits photo : © Olivier Roller / Le Cherche Midi.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.