Le texte Le cœur quand il explose se déploie en un souffle ininterrompu, mêlant absence, révolte et mémoire, poussées jusqu’à l’effondrement par une syntaxe éclatée. Les phrases, sous pulsion poétique, prolongent un élan désespéré, chaque mot cherchant à retenir ce qui glisse pourtant inévitablement vers l’oubli. L’écriture refuse la ponctuation forte, évacue les arrêts, construisant une langue qui ne respire plus, qui court en avant pour ne pas sombrer.
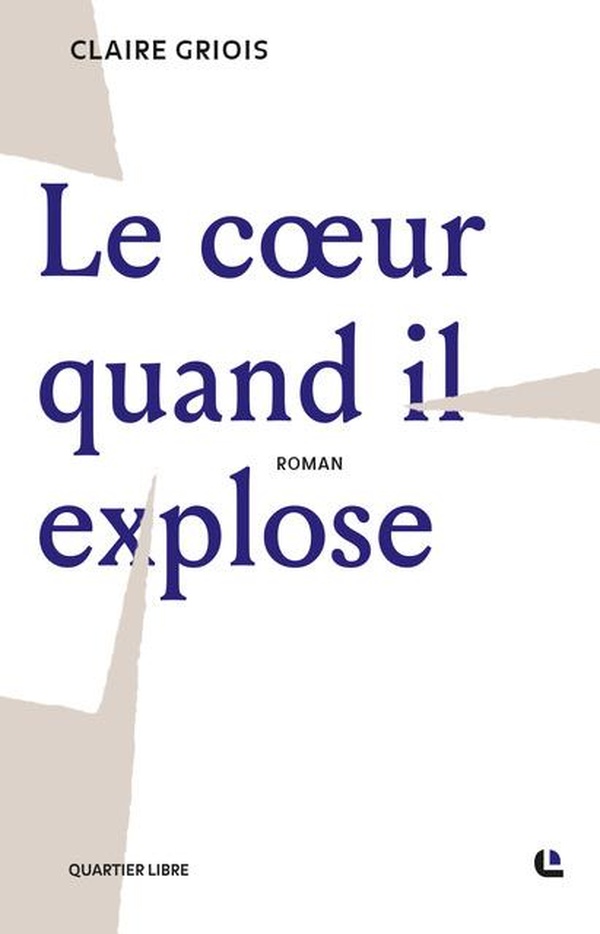
Le cœur quand il explose de Claire Griois est en effet un long cri d’amour et de révolte, une lettre jetée dans l’urgence depuis Skopelos, en Grèce : la narratrice tente de survivre à une absence qui l’engloutit, celui de l’être aimé tué dans des manifestations. Porté par une syntaxe haletante et une phrase qui refuse la ponctuation forte, le texte oscille entre le deuil d’un amour perdu et la violence d’un monde en lutte. Le souvenir d’un être aimé, insaisissable et fiévreux, se superpose aux images de manifestations, de corps brisés par la répression, de nuits de musique et d’errance en Grèce. La narratrice marche sans fin, cherche une chapelle sous la pluie, fuit et revient, hantée par la mémoire d’un visage qui se brouille. Entre colère et vertige, entre explosion et silence, le texte capture l’urgence d’aimer, de hurler, de ne pas disparaître.
La phrase interminable de l’absence
La phrase ne s’interrompt jamais, comme si s’arrêter revenait à céder au vide. Cette continuité impose une tension permanente, où le lecteur est pris dans une course sans fin. L’écriture traduit ici l’impossibilité de fixer ce qui échappe : « Le manque, c’est comme une photo ; c’est quand il reste quelque chose qu’on ne peut pas palper, c’est l’absence de la voix, et même quand on regarde les vidéos, on ne peut plus savoir, on ne peut plus sentir qui est à côté de soi. »
Porté par une syntaxe haletante, le texte oscille entre le deuil d’un amour perdu et la violence d’un monde en lutte.
Le manque ne laisse que des traces déformées, des images statiques incapables de contenir ce qui a été perdu. La mémoire elle-même vacille, se fragmente, se contredit. L’oubli est en marche et le texte lutte contre cette disparition annoncée. « Je voudrais te parler de toi, pour que tu ne t’oublies pas, enfermé dans le silence. » Cette lutte contre l’oubli semble s’adresser à nous également du fait de l’ancrage politique de l’œuvre : les souvenirs se confondent avec les manifestations, les corps amoureux avec ceux qui tombent sous les coups.
L’errance et l’éclatement du temps
Le récit refuse une chronologie linéaire. Le présent est envahi par le passé, le futur est déjà en ruine. Les lieux du pays grec mentionnés sont finalement remplacés par une géographie intime, celle des souvenirs qui se substituent au réel immédiat « Ici, à Skopelos, au pied des oliviers, c’est ton salon que je vois, c’est ton salon, et – merde ! il y a beaucoup trop de meubles. » Le salon, lieu de l’intimité et du quotidien, se projette sur un paysage grec où tout est trop vaste : l’ailleurs n’éloigne pas, il ramène sans cesse au même point : celui de la perte, inchangeable et pérenne.
La marche devient alors un motif central, non comme un déplacement vers une résolution, mais comme un mouvement qui ne sait plus où aller. « Je ne fais que marcher, complètement à l’aveugle, je ne peux plus m’asseoir. » Le corps est pris dans une fuite qui n’aboutit jamais, ne peut ni s’ancrer ni fuir complètement car la route est un espace vide, une ligne qui ne mène qu’à elle-même.
Les corps broyés par la répression et ceux qui se délitent dans l’absence subissent une même brutalité, une même dépossession.
(é)cri(t) contre la violence politique
L’écriture ne s’arrête pas à la douleur intime, elles’ouvre sur un monde détruit par l’injustice et la répression qui s’abattent avec la même brutalité que la perte. La sidération du deuil devient celle du politique : « Ils nous font croire qu’on a le droit de s’aimer, les droits des hommes, tu sais, et puis ils nous séparent, à grands coups de matraques, à tirs de LBD, à – paf ! paf ! paf ! les grenades. »
Les explosions rythment le texte, saturent l’espace, renversent la douceur des souvenirs. La mémoire d’un amour perdu se mêle alors à celle d’une ville, Paris, assiégée par les forces de l’ordre. L’histoire individuelle ne peut se détacher du contexte collectif. « On jette des comètes à travers le ciel gris, qui s’écrasent sur le sol, place de la République ou place de la Nation. » Les lieux de la révolte parisienne deviennent des points de chute, des tombes où la colère et la tristesse se confondent. L’écriture dissout ici toute frontière entre l’intime et le politique : les corps broyés par la répression et ceux qui se délitent dans l’absence subissent une même brutalité, une même dépossession. Ce refus de distinction découle d’une intrusion du trivial sous le masque du politique : la détention du pouvoir politique et répressif sert d’écran à des violences qui s’exercent indistinctement sur l’espace public et les chairs aimées.
L’amour comme affrontement et vertige
La relation qui traverse le texte n’a rien d’apaisé. Elle est faite de heurts, de silences brisés, de tensions irrésolues, faite de vie en somme. L’amour y est donc à la fois absolu et impossible, un attachement qui consume, une présence qui s’efface même avant d’avoir disparu. « On s’est fâchés, toi et moi de temps en temps, c’était un vrai bazar, on ne se comprenait pas, et ça faisait tellement mal, de s’envoyer toute cette violence-là à travers la pièce et au-dessus du trottoir avec tous ses bris de verre. »
https://zone-critique.com/critiques/sarah-jollien-fardel-la-longe/
L’amour devient alors un champ de bataille, un espace où tendresse et brutalité s’entrechoquent : l’autre n’est jamais totalement accessible, jamais totalement retenu. « Je voudrais te parler de toi, pour que tu ne t’oublies pas, enfermé dans le silence. » Ce dernier apparaît comme l’ennemi ultime du fait de sa puissance à marquer la fin de tout, l’instant où plus rien ne résonne, où plus aucune voix ne porte. Cependant, l’écriture fait rempart contre cet effacement.
La mer et la dissolution du soi
La mer apparaît à plusieurs reprises, tantôt comme un espace de refuge, tantôt comme une menace. Elle incarne la possibilité de se perdre entièrement, d’être englouti : « Tu sais, il faut que je te dise que la mer coupe la vue. » Elle se fait ligne de séparation, mur liquide où tout s’achève, où tout peut être noyé. L’eau efface les traces, absorbe les cris. Pourtant, la mer est aussi un lieu de possible renaissance : « Je pourrais continuer, je suis déjà trempée, je pourrais entrer dans la flotte pour te retrouver tout de suite. » L’eau devient alors une alternative : sombrer ou renaître, disparaître ou se fondre dans un mouvement plus vaste.
La route, de son côté, est une ligne qui ne mène nulle part. Elle est l’inverse de la mer : un espace où l’on marche sans jamais parvenir à une issue : « La route en lacets mal serrés qui font trébucher le cœur. » C’est l’image d’un monde disloqué : aucun repère, tout vacille, à l’image de la grammaticalité du texte lui-même.
Entre colère et vertige, entre explosion et silence, le texte capture l’urgence d’aimer, de hurler, de ne pas disparaître.
La musique comme dernier cri
Face à l’absence, face à la dissolution du temps et des corps, il reste la musique, dernière chose qui résonne, seul battement qui persiste : « La musique, la musique !, et là, dans le ciel, les mouettes !, même les mouettes, revenues, qui gueulent, qui gueulent, qui gueulent ! » La musique est donc un cri, un refus du silence, une manière d’occuper l’espace même quand tout semble s’effondrer. Elle est une forme de résistance, un moyen de continuer à exister dans le vacarme du monde : « Et tous les éclopés, et tous les éborgnés, et tous les mutilés, tous les gens qui brandissent des morceaux de justice dans les manifs, aux fenêtres, dans les livres, dans les films, toute leur musique s’envole depuis la mer Égée. »
L’écriture métamorphose la perte en soulèvement, en une résistance acharnée à l’effacement : l’accumulation des phrases érige un rempart contre la dissolution, tente de peupler le vide, d’en faire un lieu habité. En ce sens, le texte s’achève sur une injonction, un cri qui défie l’extinction : « Yamas ! ». Le mot supplante la fin, affirmant que tout continue, que la voix persiste, que la musique, irréductible, ne s’éteindra pas. L’absence et la mort échouent à triompher tant que l’existence et les souvenirs résonnent dans le langage et la mémoire.
- Le cœur quand il explose, Claire Griois, Éditions Quartier Libre, janvier 2025.
- Crédit photo : ©Pierre Bonte-Joseph.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.