Illustration par Julia Reynaud
Le parcours de François Bégaudeau est marqué par la littérature et la politique. L’auteur d’Entre les murs évite toute univocité idéologique et cherche à trouver une forme romanesque à même de dire la complexité du monde social. Son roman En guerre s’attache à penser le conditionnement auquel personne n’échappe, bourgeois ou ouvrier. De même, Histoire de ta bêtise, réinvestit une forme littéraire, celle du pamphlet, pour fustiger l’arrogance morale de la bourgeoisie.
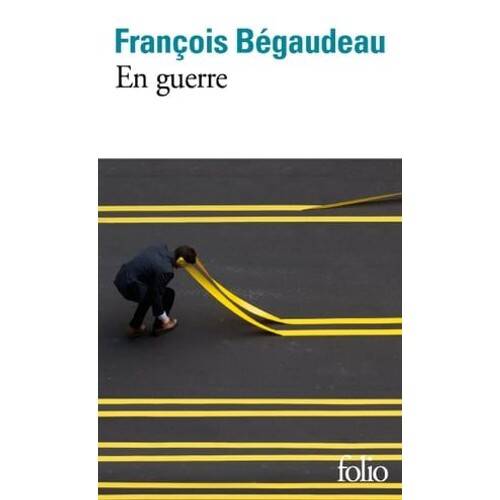
La neutralité est le lieu même de l’art.
Zone Critique : Bonjour François Bégaudeau. Tout d’abord, pourquoi avoir choisi le roman, notamment dans En guerre, pour décrire le quotidien des plus défavorisés ? Qu’est-ce que le roman apporte de plus que l’enquête journalistique ?
François Bégaudeau : C’est une question centrale depuis toujours, mais elle se pose avec plus d’acuité depuis dix ou vingt ans et la domination éditoriale de la non-fiction — y compris pour le meilleur, par exemple les succès d’auteurs comme Éric Vuillard, Patrick Deville, ou encore Emmanuel Carrère depuis qu’il a renoncé à la fiction. Un romancier contemporain ne peut pas s’épargner de se demander : « mais en fait pourquoi passer par la fiction ? Quelle est sa valeur ajoutée quand parfois raconter le réel suffit à faire un livre ? ».
D’abord, la réponse la plus simple et peut-être la moins intéressante, c’est que j’aime bien fictionner. J’aime inventer des personnages, des situations, élaborer des scénarios, etc. Ensuite, dans le cas d’En guerre, j’avais envie d’expérimenter la rencontre entre deux milieux opposés : je pars d’un personnage qui est un ouvrier, pour ensuite faire émerger deux autres personnages, la compagne de l’ouvrier et puis Romain, petit bourgeois qui va devenir son amant. Comment, malgré des conditionnements de classe, un Romain et une Louisa parviennent à se rencontrer ? Il faut bien que j’invente les conditions aléatoires et incertaines d’une rencontre qui n’advient jamais dans la vie : Romain se fait agresser, du coup, sa trajectoire de vie est court-circuitée. Il se retrouve ainsi dans une boîte de nuit dans laquelle il n’aurait pas dû se retrouver, et que Louisa fréquente. Là, la rencontre devient possible : elle est rendue possible par la fiction et sa latitude à tordre l’ordinaire, à bifurquer de la probabilité. Et la fiction inflige aussi à Louisa des faits exceptionnels qui la rendent plus aventurière sentimentalement qu’à l’habitude, et donc disponible à cette rencontre. Ainsi grâce à la fiction l’expérience peut commencer : une relation interclasse, ça donne quoi ?
Z-C. : Vous faites le choix d’une objectivité du narrateur, qui se garde bien d’indiquer au lecteur ce qu’il doit penser. Mais en décrivant avec précision des situations concrètes de l’existence vous faites apparaître l’injustice sociale. Pour vous, cette neutralité du narrateur permet-elle une meilleure efficacité de la dénonciation politique ?
F.B : Il faudrait nuancer ce terme, mais pour moi cette neutralité est le lieu même de l’art. Même si on n’arrive jamais neutre devant l’écriture, il faut éviter que les situations fassent démonstration d’idées préalables. Ce que j’appelais mettre « les compteurs à zéro » à l’époque d’Entre les murs, c’est de systématiquement voir la complexité d’une situation et d’éviter l’univocité idéologique. Pour cela, vous prenez un personnage qui a priori vous serait antipathique sociologiquement ou politiquement dans la vie, et vous essayez de saisir sa machine intérieure. Mon questionnement devant un personnage n’est jamais : est-il bon ou méchant ? Mais toujours : quelle est sa mécanique affective et sociale au sein d’une situation ? Bien que je me sente une certaine fraternité avec Ken Loach, ce qui me tient à l’écart de ses films, c’est que je ne comprends pas pourquoi systématiquement ses « prolos » sont gentils. Je pense que c’est une erreur majeure. D’abord c’est une erreur contre la vérité : ce n’est pas parce que vous souffrez et que vous êtes une victime sociale, que vous êtes quelqu’un de bien. Par exemple mon Cristiano, le mari de Louisa, j’ai plutôt de l’empathie pour lui, mais il est irrégulièrement digne de cette empathie. Il est à la fois con et sublime, immoral et vertueux ; d’une scène à l’autre il est modulable et n’a pas les mêmes affects : il peut très bien être violent avec sa copine et la scène d’après être un compagnon en or. Pour moi, un romancier ou un artiste doit avoir pour religion le réel, la justesse et la complexité. Pour finir et être tout à fait complet, bien sûr que je ne suis pas neutre : je suis particulièrement marqué politiquement et, évidemment, ça se ressent partout dans ce livre qui finit par faire démonstration de quelque chose. Toute l’alchimie est d’arriver à faire en sorte que ce qui est démontré semble se démontrer tout seul : voilà mon absolu artistique, les choses s’animent d‘elles-mêmes et non par l’action d’un grand démiurge politisé et idéologisé. En cinéma, j’aime que le réel parle de lui-même. En littérature il s’agirait plutôt de faire en sorte que les mots parlent d’eux-mêmes, sans qu’on ait l’air de les tordre.
Z-C. : C’est ce qui peut frapper à la lecture d’En guerre : tous vos personnages sont attendrissants, on a envie de croire à la relation entre Romain et Louisa, même s’il est lâche ou hypocrite, et Cristiano lui aussi a ses défauts, etc. La manière avec laquelle vous abordez les personnages fait naître de l’empathie chez le lecteur.
F.B : J’aborde un point important dans Une certaine inquiétude qui retrace ma correspondance avec un chrétien. Même si je suis non croyant, ce que je peux aimer dans le christianisme est sa capacité à ne pas juger. Ce n’est pas vrai dans toutes les branches du christianisme, mais je crois que tout être humain, tout être vivant même, mérite compassion, dans la mesure élémentaire où il est mû par des forces dont il n’a pas le contrôle. Dans En guerre, je fais dire au personnage de Paul Kremer, le grand patron bourgeois, qu’il est victime de sa propriété, un poids, une responsabilité testamentaire ingérable psychologiquement. Alors que si on le regarde uniquement de l’extérieur, comme patron, il ne mériterait que l’anathème, parce qu’il pérennise des injustices et bricole dans des business assez toxiques.
NOUS SOMMES DES ÊTRES PARLÉS PAR NOTRE CLASSE SOCIALE
Z.C. : Dans En guerre, l’utilisation du discours indirect libre sert-il à décrire le fossé qui sépare la classe moyenne de Romain et la classe défavorisée de Louisa ? Ne permet-il pas aussi de pointer la manière dont le langage conditionne les rapports de force ?
F.B : Oui, à condition qu’on entende aussi par langage celui qui traverse notre esprit. Ce qui est intéressant dans le style indirect libre, c’est qu’il permet de mettre sur le même plan les paroles prononcées et la petite moulinette de paroles qu’on a tous en tête. Nous sommes en permanence saturés d’énoncés. En guerre est un livre presque exclusivement en style indirect libre, où les paroles directes et le monologue intérieur sont mis sur le même plan. On est des êtres parlés, et d’abord des êtres parlés par notre classe sociale. C’est ce que je dis au début d’Histoire de ta bêtise : « tu es parlé, tu es pensé ». En gros : « toi le bourgeois ne te crois pas jugé dans ce que je vais te dire, parce que tu es parlé : des mots passent à travers toi, qui sont les mots de ta classe, les mots de ton époque ».
Z.C. : Par ailleurs, dans votre travail d’écriture, vous avez une manière particulièrement marquante de parler des conditions de travail. Dans En guerre, vous décrivez avec finesse, et humour, les paris en ligne de Cristiano, de même pour l’entrepôt Amazon de Louisa. Comment organisez-vous votre travail préparatoire pour parvenir à décrire aussi précisément ces conditions de travail?
F.B : Il y a deux manières de documenter un roman, tout d’abord ce que j’appellerais la documentation spontanée : c’est toutes les informations qu’on accumule sans faire l’effort de les accumuler (par exemple un reportage que j’ai vu à la télé ou au cinéma, une personne rencontrée…), par le seul fait d’une sorte de curiosité mécanique, en l’espèce celle que je porte à la chose sociale, et notamment à la vie des « prolos » , à la fois par tempérament et par méthode — je trouve qu’on comprend toujours mieux une société, ses contradictions, ses impasses, quand on la regarde du point de vue des classes populaires. Ensuite, il y a toute la documentation active : je lis des livres, des articles et je regarde beaucoup de documentaires qui viennent nourrir mon sujet. Pendant la période qui a précédé l’écriture d’En guerre, qui a duré 4 ou 5 mois, je me suis ainsi retrouvé à lire un livre sur un journaliste qui s’était inséré dans les entrepôts Amazon, à la fois pour comprendre le fonctionnement de ces monstres de tôle, et aussi pour étoffer mon récit de détails. Ce que j’appelle le détail qui tue.
Z.C. : Pour revenir à votre manière de superposer le discours et la réalité, il y a ce personnage de Romain qui se prétend féministe mais qui dans le fond ne refuse pas des relations de dominations sexuelles…
F.B : Votre remarque me fournit un exemple de ce que j’appelle l’esprit chrétien du romancier : Romain est habitué à avoir un rapport tout à fait égalitaire avec les femmes en raison de son conditionnement culturel et familial. Puis, dans le cadre de cette relation avec Louisa, il se voit traversé par des affects de domination, il est très séduit, elle l’appelle « Maître » par texto, ça l’émoustille. Qu’est-ce qu’on va conclure de ça ? On va dire : « ah là là quel imposteur ce Romain : dans les mots il est féministe et en fait dans les affects il est machiste ». Ben non ! Il est les deux en même temps. Et l’un n’invalide pas l’autre. Je pense qu’on se décontracte beaucoup moralement quand on commence à établir que, chez les humains, il n’y a pas de contradictions, mais des ambivalences ou des alternances, il y a des courants alternatifs. Et je pense que le roman peut être considéré comme le lieu du courant alternatif. Ainsi, Romain essaiera vraiment d’entendre la parole des femmes dans une réunion, il n’est pas insincère, mais il est aussi absolument sincère quand il découvre ce qu’il peut y avoir de sexy et d’excitant dans la domination. Pour moi, cela ne vaut pas condamnation du personnage, c’est simplement le restituer au sein de sa complexité. Il y a une disposition du romancier à faire accueil à toutes les modalités d’un individu, faire accueil, y compris à des choses que dans la vie on pourrait détester. J’ai souvent jubilé d’écrire des scènes qui, à vivre, m’avaient plutôt peiné. Et je me vois, comme romancier, capable d’une plus grande tolérance et d’une plus grande compréhension que je n’en ai dans la vie, où je peux être parfois très dogmatique, comme tout le monde. On n’arrête pas de juger, mais comme romancier, je pense qu’on peut arriver à ne pas juger.
https://zone-critique.com/critiques/lamour-de-francois-begaudeau/
Z.C. : Vos personnages, toutes catégories sociales confondues, sont pris dans des conditionnements qu’ils ignorent, et que vous vous amusez à dévoiler. Leur dévoilement est-il l’une des priorités que vous assignez à votre travail romanesque ? Et de quels outils dispose le romancier pour parvenir à cet objectif ?
Je voudrais préciser ce qu’a été mon parcours de romancier, car en réalité certains de mes écrits, romans ou pièces, sont beaucoup moins marqués par cette analyse du conditionnement social. Une amie m’en faisait récemment la remarque concernant mon roman Vers la douceur, paru en 2009 : « toi que je connaissais très sociologique et social, tu caractérises très peu tes personnages dans ce livre ». C’est aussi le cas dans la pièce Le Lien qui a été jouée cette année, où je mets plutôt la focale sur ce que j’appellerais les « affects purs », il est question de la filiation entre une mère et son fils, la donnée sociologique est là très mineure. En revanche, c’est vrai que depuis quelques années a monté en moi une colère devant la minoration des conditionnements sociaux présente dans certains discours anti-sociologiques d’intellectuels ou d’artistes. Les conditionnements sociaux sont mal traités ou sous traités, et ça fait revenir en moi des réflexes bourdieusiens, marxistes : En guerre est né de là, d’une envie de faire une sociologie complexe et fine des conditionnements. Contrairement à une vision grossière du conditionnement des ennemis de la sociologie fine : « tu es pauvre, donc tu deviens délinquant », c’est « tu es un grand patron, alors tu es conditionné à trouver légitime la propriété ou l’héritage ».
En fait, nous sommes tous conditionnés, il n’y a pas que les pauvres qui le sont. Et puis surtout, on est conditionné par des affects qui sont au croisement du social et du psychologique. Mon lieu c’est la psychosociologie : par où la psyché est empreinte de social, et par où le social devient de la psyché. C’est ça qui fait un roman je pense. Par exemple, si vous prenez le rapport de Louisa à sa mère, qui n’est pas énormément traité dans En guerre, mais qui l’est de façon intermittente, c’est de la psychosociologie.
Parce que c’est sa mère, leur rapport est très affectif, sanguin, filial. Louisa voit sa mère se tuer le dos à faire des ménages pendant vingt ans. Ça conditionne en elle un affect social puissant qui est : « j’accepterai tous les boulots sauf celui d’employée de ménage », on voit bien que dans cet affect-là il y a beaucoup de choses : il y a l’amour de sa mère, et en même temps du mépris, il y a les deux. Ce micmac affectivo-social, voilà la chair du roman ! C’est mon lieu.
En fait le conditionnement m’intéresse si on le voit comme un écheveau indémêlable de stimulations sociales. Par exemple, dans Histoire de ta bêtise, j’ai mis au jour un conditionnement psycho-social dont on ne parle jamais je crois, qui est : « qu’est-ce que ça veut dire être fils de fonctionnaire ? ». En hypokhâgne, ce qui caractérisait énormément ma bande – qui est restée ma bande d’amis – c’est qu’on était à peu près tous fils de profs, en tout cas, tous fils de fonctionnaires. Et ça nous déterminait énormément : à faire du rock, à être de gauche, à être en hypokhâgne, à épouser des filières plus ou moins sous-valorisées, comme la psychologie, la philosophie, l’histoire, etc. Ce n’est que récemment que j’ai mesuré que cet atavisme fonctionnaire avait des conséquences bien plus profondes. Ce n’est pas un conditionnement du genre « je suis fils de fonctionnaire, donc j’ai de la sympathie pour la fonction publique », non : ça inscrit en vous, profondément, des raisonnements non marchands, ce qui évidemment façonne un paysage idéologique, fait d’adhésions (à l’autonomie) et de refus (d’être marchandisé à son tour).
On est un écrivain social, non pas parce qu’on fait des livres sur le prolétariat ou qu’on s’intéresse à une thématique sociale, mais lorsqu’on pense puissamment que le corps d’un personnage est largement façonné par le corps social.
LE MONDE SOCIAL EST UN VECTEUR DE PUISSANCE ROMANESQUE
Z.C : Pensez-vous que, pour écrire un bon roman, l’art romanesque doive s’assujettir à un engagement social ? Certains écrivains vont placer la littérature au-dessus même de toute ambition sociale, où vous placez-vous ?
F.B : Tout d’abord, je pense qu’il y a des romans qui s’assujettissent eux-mêmes à une cause politique, et qui ne sont alors pas de bons romans, et Dieu m’en préserve. Quand un romancier écrit, s’il se place sous tutelle d’une cause, forcément il restreint son champ d’écriture, et corsète son talent. En revanche, s’il se donne comme Dieu, la complexité, l’intensité, l’intérêt, la puissance, alors quelque chose peut se déployer. Il ne faut pas se verrouiller. En fait, je préfère un roman qui tourne sur lui-même et qui devient une hypothèse formelle, plutôt qu’un roman dont je sens qu’il est à toutes les lignes sous tutelle politique, ou, pire, sous tutelle morale (beaucoup qualifient de « politique » des œuvres qui ne font qu’édicter une morale). Alors évidemment, les grands romans ils font les deux. Flaubert dit qu’il écrit des livres sur rien, sauf qu’il écrit des livres sur quelque chose. Il écrit sur quelque chose et rien à la fois. Il a ce génie absolu de faire une phrase qui tient toute seule, indépendamment de ce qu’elle raconte, et en même temps, il charrie du réel, il charrie le XIXe siècle, il charrie une figure féminine qui est depuis devenue un nom commun. Et je pense que c’est ce qu’on trouvera chez tous les grands romanciers.
Inversement, un écrivain qui dirait : « non, je n’ai pas envie de parler du réel social, ce n’est pas mon truc », je lui dirais de ne pas se forcer, que chacun à son tempérament, mais qu’il se prive tout de même d’un sacré matériau. Et en ce qui me concerne, franchement, je ne me sens pas enjoint moralement de mettre du réel dans mon livre, et je pense qu’un livre n’a aucun devoir de rendre compte du réel social, aucun. En revanche, je sais à quel point c’est un vecteur de puissance : penchez-vous sur la vie des « prolos », c’est passionnant, elle est constamment soumise à un système de contraintes. La vie de Cristiano est bien plus passionnante à écrire que pourrait l’être ma propre vie. Pour la mienne, il y aurait des situations, j’en ai même tiré un roman qui s’appelle La Politesse, mais comme j’évolue dans une relative distance avec le corps social, on en ferait vite le tour. Donc, ce n’est pas tant qu’il y aurait une prescription morale et politique à parler des vies populaires, c’est qu’il y a un grand intérêt pour la littérature à se pencher sur ces vies, et à en faire la chair du roman. Je crois qu’En guerre est, de mes romans, mon préféré, et une des raisons pour lesquelles je l’aime bien, est que je le trouve vraiment vivant, et la vie lui vient très largement du périmètre prolétaire dans lequel il déambule.
Z.C : Dans Histoire de ta bêtise vous revendiquez une position d’intellectuel, avec tout le cortège d’images sartriennes que peut véhiculer ce mot. Quelle tâche assignez-vous à l’intellectuel face à la crise sociale ?
F.B : Alors, j’ai de l’ambivalence sur la position de l’intellectuel, déjà je n’aime pas le mot et je résiste beaucoup à m’étiqueter comme ça. Si l’intellectuel, qu’il soit philosophe, penseur ou même écrivain ou artiste, est cette catégorie dont on dit qu’elle est née avec l’affaire Dreyfus, et se définit par ses interventions sur la place publique pour défendre des causes, alors je me garde bien d’être ça. Alors parfois, il se trouve qu’on m’a amené à l’être, par exemple Histoire de ta bêtise est sorti pendant le mouvement des Gilets jaunes, donc presqu’à chaque fois que je vais à la télé, à la radio, j’ai le droit à une question à ce propos. En somme on m’accule à intervenir sur l’actualité…
Bon, je joue le jeu et je réponds, ne serait-ce que parce que je suis sympathisant de ce mouvement, auquel j’ai un peu participé, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je vais à la radio. Donc on se retrouve souvent malgré-soi mis en demeure d’avoir une opinion sur tout. Il y en a qui font ça allègrement, on sait bien que certains auteurs ou pseudo-philosophes n’ont que ça à vendre : des opinions sur tout… En revanche si on considère l’intellectuel comme une notion sociologique, je suis un intellectuel. Je gagne ma vie en bricolant des phrases et non du mortier, cela fait de moi un intellectuel.
https://zone-critique.com/critiques/francois-begaudeau-lepoque-ca-nexiste-pas/
Après pour revenir sur l’action politique, je trouve qu’il n’y a aucun devoir pour quiconque d’intervenir dans l’espace public, je n’aime pas cette pression morale qu’on fait parfois peser sur les intellectuels (le fameux « silence des intellectuels ? » etc.). Le monde de la culture, c’est-à-dire le monde du théâtre et du cinéma, a été pas mal incriminé à une période du mouvement des Gilets jaunes : « où sont-ils ? ». Comme s’il était presque de leur devoir d’intervenir, mais en réalité, s’ils ne sont pas intervenus, ce n’est pas parce que ce sont des gens immoraux qui manquent à leur devoir de citoyenneté, mais simplement parce qu’ils ont une antipathie pour ce mouvement. La question n’est pas morale. C’est une question de classe, ou une question sociale, une question de conflictualité politique. Je connais bien le milieu de la culture, le milieu théâtral notamment, je sais qu’il est gorgé de macroniens, de bourgeois de gauche, c’est-à-dire de gens structurellement conservateurs et progressistes pour faire genre. Ces gens-là étaient programmés pour développer une répulsion presque physique à l’endroit des Gilets jaunes. On voit bien que la question n’est plus de savoir si un intellectuel a le devoir ou pas d’intervenir, c’est : « En a-t-il envie ? Est-ce que son tempérament le porte à intervenir ? À soutenir un mouvement, une grève, etc. ». En fait, dans ce cas d’espèce comme en général, personne n’obéit à une prescription morale, chacun suit sa pente, et pour ma part, comme souvent mes affects sont politisés, alors j’agis. Quand l’éditeur de François Ruffin me demande de faire un texte pour soutenir sa publication, eh bien je suis content de le faire, parce que je me sens une fraternité avec Ruffin, et parce que j’aime bien ce livre.
LE MONDE EST TRAGIQUE, SAUVAGE ET BRUTAL,
MAIS IL EST DRÔLE
Z.C : Dans Deux singes ou ma vie politique vous abordez les relations entre la politique et le corps. Pouvez-vous développer cette idée-là ?
F.B : Là encore, nous sommes dans de la psychosociologie, au croisement de l’intime et du social, de la famille et de la classe, de la psyché et des idées. Je m’oppose à l’hypothèse morale sur ce qui peut impulser un engagement à gauche, de type : « je suis une cellule neutre, je constate l’injustice et donc je deviens de gauche ». Pour moi, ce n’est pas comme ça que ça se passe : les idées de gauche sont des projections d’une sorte de tempérament de gauche qui s’est façonné de mille manières depuis des siècles, et qui construit un certain rapport au monde. Les premières injonctions ont toujours à voir avec le corps. Par exemple une question que je me pose dans Deux singes ou ma vie politique, c’est : « pourquoi ne suis-je pas devenu un stalinien pur jus alors que j’étais conditionné à le devenir ? » Eh bien, parce que se sont mises en place chez moi des particules anarchistes, des particules libertaires, qui sont apparues dans des sphères très affectives, comme dans mon rapport à ma mère par exemple. À un moment je parle des grimaces de ma mère, elle est très grimaçante dès qu’elle a un peu bu, dès qu’elle s’amuse avec ses copines. J’ai vu, toute mon enfance, ma mère faire l’andouille (et peut-être ai-je aimé les grimaces parce que j’aimais ma mère, le vieux coup de la poule et de l’œuf). Mon frère aussi faisait souvent le con.
Sous leur influence, sous celle de mes amis, des programmes comiques à la télé, puis du rock et du punk – qui sont des courants où la potacherie compte ; j’ai développé un goût pour la clownerie qui fait que mon corps, très clairement, ne pouvait pas occuper une verticalité stalinienne que je décris dans le livre et qui, pourtant, me fascinait beaucoup. Je raconte dans Deux singes que j’étais fasciné par le film L’armée des ombres. Pour moi ce film montrait vraiment le côté très droit, très viril, très masculin des résistants. C’était ça pour moi le corps communiste : un corps droit, dressé, un corps viril qui ne rigole pas, qui porte la violence du monde et l’urgence de sa cause sur les épaules, qui est prêt à un certain nombre de violences pour la cause. Sauf que si moi je commençais à prendre ces postures-là, au bout d’une minute ça ne tenait pas, mon corps se lassait déjà parce que mon corps avait envie de faire des grimaces, de faire l’idiot, de faire le singe. Je n’ai jamais pu occuper le sérieux militant. Par contre je pourrais dire ce qu’est un tempérament anarchiste, un corps anarchiste ou un système de sensation anarchiste. Il s’incarne dans l’idée que quand je vois des dominants, quand je vois des gens de pouvoir, je ne suis pas en colère contre eux, ma première impulsion à leur égard n’est pas de les contester, ou de les renverser, c’est que je les trouve ridicules, je les trouve grotesques. Ce n’est pas du tout la même chose que quelqu’un qui dirait : « je n’aime pas François Hollande parce qu’il a fait une politique libérale », c’est là que je ne suis pas un mec sérieux, je suis un littéraire, on me demande de parler d’anarchisme et je vais très vite parler de choses très existentielles, subjectives, c’est là que je ne suis définitivement pas un philosophe.
Z.C : D’ailleurs, votre livre La blessure, la vraie s’ouvre par un éclat de rire, par quelqu’un qui ne peut plus s’arrêter de rire, puis s’achève, comme par une boucle, par une autre scène de rires. Est-ce qu’il y a une intentionnalité à votre rire, est-ce que c’est un recours, une arme, quelque chose que vous pouvez employer face à la crise sociale ?
F.B : Déjà, il faut savoir qu’avant de les écrire, je n’avais pas prémédité de rendre mes livres drôles, j’ai juste vu arriver des scènes, des traits, et des tournures comiques sous mes mains, sur le clavier. C’est moins une option esthétique concertée qu’une affaire de tempérament : dans la vie comme à l’écrit, il me vient assez spontanément un angle humoristique sur une situation, même dramatique. Les situations peuvent être éclairées de mille façons, c’est aussi cela écrire : vous avez une scène, vous pouvez y jeter un jour atmosphérique très variable, vous prenez une décision dans votre angle de vue.
Plus précisément, et plus sobrement, je parlerais de point d’ironie. Il y a en toute chose, un point d’ironie. Il m’arrive assez souvent de repérer ce point et de construire ma phrase autour. Bon, par ailleurs, je place l’humour très haut, je pense que c’est une des plus hautes modalités de l’intelligence, et il y a certains comiques qui sont des artistes majeurs. Certains énoncés de Judor, Gardin, Barré, atteignent un niveau de densité et de compression du sens qui n’est pas sans rapport avec mon absolu stylistique en littérature (Racine, Flaubert).
Je reviens au point d’ironie : il y a une grande justesse de l’appréhension comique du monde, parce que la vérité du monde est son dysfonctionnement, son non-sens, et donc ce que j’appelle son ironie intrinsèque. Le monde, est tragique, déprimant, brutal, ET drôle — et il est drôle parce qu’il est tout ça.
Dans le début d’En guerre, il y a un affrontement entre CRS et grévistes, c’est absolument désespérant, c’est l’énergie du désespoir, on pourrait faire un truc sentimental ampoulé là-dessus : la mort de la classe ouvrière, « ah là là, ces gens expropriés de leur force de travail par le grand capital ! ». C’est bien ce qui arrive à la classe ouvrière depuis quelques décennies, et c’est absolument dégueulasse. Donc je prends en charge cette colère, mais je pointe aussi la dimension presque burlesque de la situation. On peut jouer les deux, et parfois dans une même phrase. Il y a un burlesque de l’affrontement entre les CRS et les grévistes, ne serait-ce que parce que les uns et les autres savent très bien que ça n’ira nulle part, et les grévistes qui ne sont pas cons le savent puissamment, ils font un peu le coup de poing parce que ça va bien les défouler mais ils se savent perdants. Donc oui, il y a l’énergie du désespoir mais il y a aussi le côté « joyeuse castagne », quoi. Or il y a quelque chose d’éminemment drôle et ridicule dans toute baston : parce que ce sont des chaises qui volent, des coups qu’on porte et qu’on ne porte pas, des gens qui se planquent, d’autres qui séparent deux teigneux et s’en prennent une… En fait, je me méfie beaucoup en général des registres univoques, je vois très peu de situations dans la vie qui ne puissent pas être traitées en faisant jouer des humeurs diverses. La condition humaine, ce n’est pas : « je vais mourir, donc je suis piégé et c’est déprimant », c’est « je vais mourir et donc je suis piégé, et en même temps je ne cesse d’être affecté par des choses dérisoires ». Je suis voué à retourner au néant et pour autant je gémis parce qu’une réunion me privera d’un quart de finale de coupe de France. Tous les grands écrivains ont des particules comiques qui traînent dans leur texte : Flaubert, Gombrowicz, Beckett, ou même Kafka, dont Deleuze a très bien analysé la base (ou la basse) comique.
Z.C : Dans vos romans, les situations comiques peuvent naître d’un décalage, l’exemple du pari sportif dans En guerre est pour cela édifiant, c’est drôle et désespérant.
F.B : Tout à fait, cette fuite en avant dans le pari est effrayante, elle est une étape vers le désastre mais il y a quand même quelque chose de drôle dans un type qui parie sur des courses de kangourous ou des concours de « air sex ».
Z.C. : Dans En guerre personne ne s’intéresse à la grève des ouvriers d’Ecolex à cause des attentats. Qu’avez-vous voulu montrer en pointant ce phénomène ?
F.B : En guerre c’est une prise de position. Comment un romancier peut faire valoir un imaginaire politique ? C’est dans les découpes qu’il fait du réel. Vous avez une somme de faits qui se passent, et vous allez choisir de mettre la focale là et pas ailleurs. C’est cette découpe qui vous situe politiquement. Depuis cinq ou six ans, il y a une focale excessive sur le phénomène du terrorisme, à proportion du petit nombre de corps qu’il a vraiment affectés — avec toute la compassion que j’ai pour ceux qui se sont trouvés sous les balles, évidemment, je ne devrais même pas à avoir à préciser cela…
Dans En guerre ou dans Histoire de ta bêtise, je propose une focale qui me paraît plus juste. En France, les corps ne sont pas quotidiennement affectés par le terrorisme, mais par le fait de devoir aller au boulot le matin, par le fait de ne pas en avoir et d’en chercher, par les conditions dans lesquelles les métiers sont exercées, par l’habitat qui nous est échu, etc. Les employées de ménage qui prennent chaque matin à 5h le RER depuis Bondy ou La Courneuve pour aller nettoyer les bureaux du centre-ville, elles n’ont pas affaire à des djihadistes, elles ont affaire au fait que le RER est bondé, elles ont affaire à leur fatigue, à leur mal de dos, à la toxicité des détergents, etc. La première option de ce livre était de remettre le social au centre, ce qui me paraît d’ailleurs l’opération nodale de la gauche. Il est évident que si dans le corps social ou dans le champ des discours dominent les questions identitaires, culturelles et par exemple la question terroriste, cela entraîne une droitisation mécanique de la société. C’est bien ce qu’il se passe depuis trente ans. Quand la question sociale était au centre des discours, la gauche dominait. C’était les années 1950, 60, 70, qui correspondent aussi à un certain âge d’or de la pensée française.
Z.C. : Vous abordez la question du déclassement dans En guerre : pourriez-vous développer cette notion ? Par ailleurs, dans Histoire de ta bêtise, vous tournez en dérision l’admiration du bourgeois pour le transfuge de classe. Pourquoi ?
F.B : Le déclassement est un motif d’étude sociologique et romanesque très répandu, parce que c’est un fait objectif. Il y a un déclassement général des classes moyennes et des classes populaires en France, tout comme il y a un déclassement de gens issus de la petite bourgeoisie – par exemple ceux avec qui j’ai grandi, fils de profs ou de fonctionnaires, qui à 40 ans gagnent moins que ce que leurs parents gagnaient au même âge. Ce déclassement est le fait social majeur des sociétés occidentales, Marx a comme d’habitude vu juste en annonçant que toute la société allait se prolétariser, que c’était le destin de tous les travailleurs, y compris de ceux qui a priori se vivent comme à l’abri de cette déconvenue (voyez ce qui arrive aux avocats par exemple). Un roman qui veut rendre compte de la situation sociale ne peut faire l’impasse sur ce mouvement général qui n’est pas près de cesser.
Quant au transfuge de classe… Pourquoi le bourgeois adore le transfuge de classe ascensionnel ? Vous avez dit qu’il « l’admirait », je ne crois pas le terme exact, je pense plutôt que son existence le réjouit, parce que ce qu’elle le conforte dans sa position sociale. Brandissant un « prolo » ayant accédé à un niveau social supérieur, le bourgeois peut alors clamer que les conditionnements sociaux ne sont pas si impérieux, et ainsi faire la nique, croit-il, à sa grande ennemie, la sociologie.
L’arabe entré à Sciences Po’ accrédite l’idéologie du libre arbitre, l’individualisme bourgeois, l’individualisme libéral. Il peut alors dire : « il y a des conditionnements, oui c’est vrai, mais quand on veut on peut ». Donc le transfuge de classe est la parfaite bête de foire pour l’idéologie méritocratique. Bon, la sociologie a fourni depuis bien longtemps des réponses à cette pseudo-objection : la première est qu’une exception n’a jamais dénaturé une règle, ce n’est pas parce qu’un Noir devient président des États-Unis que ça amoindrit en quelque manière les statistiques hallucinantes sur la proportion d’hommes noirs dans les prisons américaines. Deuxièmement, et là j’insiste beaucoup dessus, un transfuge de classe n’échappe pas aux conditionnements sociaux : il a simplement été conditionné à être transfuge et il faut étudier cet autre conditionnement en faisant une micro-analyse sociale, familiale, etc. En résumé le transfuge ne sort pas du déterminisme, il passe d’une détermination à une autre.
https://zone-critique.com/creations/on-ne-fait-pas-domelette/
Après il y aurait une dernière chose à dire, que je décris beaucoup dans Histoire de ma bêtise, c’est que la bourgeoisie est dotée d’une pulsion assimilationniste. Elle pense toujours que sauver un pauvre consiste à le rendre bourgeois (mais moins bourgeois que lui, car le bourgeois tient à sa distinction). Elle considère son mode de vie, son mode de pensée, son hygiène, ses goûts esthétiques comme désirables. C’est présent dans beaucoup de films d’ailleurs, qui, sous couvert de souci social, sont en fait des films éducatifs qui mettent en scène souvent un jeune « prolo » en perdition, une bête sauvage un peu, qui ne s’en sort pas à l’école, qui est plutôt délinquant – ça c’est le début du film toujours, puis qu’est-ce qui va se passer ? Le processus scénaristique va être un processus éducatif assimilationniste : on va faire de cette bête sauvage, une bête civilisée, ce qui va consister pour lui à épouser un certain nombre de codes bourgeois. Le film La Tête haute d’Emmanuelle Bercot est un exemple à mes yeux emblématique, d’où la place que je lui accorde dans Histoire de ta bêtise.
LES VECTEURS HABITUELS D’ÉMANCIPATION SOCIALE SONT EN CRISE
Z.C : L’un des personnages d’En guerre, Catherine Tendron – DRH, est adepte d’un management qui se prétend à visage humain, qui consiste à licencier une personne en obtenant préalablement son consentement. Ce management humain est-il le nouveau visage de la déshumanisation de notre société ? Et pour l’articuler avec une notion traitée dans Histoire de ta bêtise : en quoi le « cool » est-il le nouvel instrument de domination de la bourgeoisie ?
F.B : Absolument, le lien est tout à fait légitime et pertinent, je pense que Catherine Tendron est au cœur de ce que j’allais décrire, quelques mois plus tard, dans Histoire de ta bêtise. Je tente d’y établir une sociogénéalogie de ce management humain, ce « lean »management, ce « cool » management, ce management horizontal ou participatif, etc., il y a un nouveau terme chaque mois. Comment se fait-il qu’une partie de l’industrie se soit convertie à un tel management, en délaissant (même si ce n’est pas autant qu’on le dit), le management fouettard, vertical, autoritaire, patriarcal ? Ce n’est pas parce que les mecs sont devenus plus gentils, c’est parce qu’à un moment, considérant une certaine attente liée à l’évolution des personnalités, on s’aperçoit que la coercition frontale marche moins bien. Un philosophe comme Chamayou a épluché tout un tas de traités de management, notamment ceux d’après-guerre, qui alertent les dominants sur la nécessité de s’adapter à une nouvelle population de salariés, plus demandeuse d’humanité, ou de bienveillance, pour citer le terme nodal de cette mutation. Il faut donc concevoir des stratégies plus subtiles de direction des corps au travail – ce que Foucault et Deleuze appelleront plutôt le « contrôle » (à distinguer donc de la discipline).
Il y a alors un débat, qui n’est pas moral mais stratégique, entre les différents théoriciens du management : est-ce qu’on obtient plus d’un ouvrier qu’on fouette ou de celui qu’on flatte ? Un employé est-il plus performant quand il est surveillé de près ou quand on lui accorde une certaine « autonomie » ? C’est donc par stratégie, et non par scrupule humaniste, (quoique cela ait pu jouer, il y a plusieurs forces au travail, y compris le scrupule humaniste, tel que porté par des syndicats proches du pouvoir), qu’est né le management bienveillant, soutenu par une novlangue que ma Catherine Tendron possède à la perfection. Ce qu’il faut constater, c’est la conséquence de cet effet sur les managers, les employés, les intérimaires, sur tous ceux qui se retrouvent sous la coupe de ce management-là. Quel effet ça leur fait ? Eh bien, on s’aperçoit qu’il est presque vécu comme plus brutal. En tout cas, comme plus insupportable, notamment moralement, parce qu’en fait l’autonomie, la « responsabilisation » créent une nouvelle « charge mentale » — pour prendre un terme issu de la pensée féministe. On voit apparaître tout un tas de pathologies psychologiques liées au travail. Ça remet un autre poids sur les employés : on leur demande d’être innovants, de prendre des initiatives, etc. Beaucoup de personnes à qui j’ai pu en parler en témoignent, j’en ai même tiré une réplique pour un des personnages d’une pièce de théâtre sur le libéralisme, qui dit regretter la pointeuse, l’outil emblématique du carcan patronal. C’est-à-dire regretter ce moment où le boulot est balisé, aussi éreintant soit-il, « à 8 heures, je pointe, à 18 heures, je pointe, et après je suis tranquille ». Alors que le côté « prenez des initiatives », on y pense le soir, ça nous poursuit, d’autant que désormais des outils technologiques permettent cette extension infinie du périmètre de travail jadis circonscrit au «bureau » ou à l’usine.
Z.C : La grève des ouvriers d’Ecolex échoue, les tentatives judiciaires d’Alban et de Romain échouent, mais la séquestration de Paul parvient comme par miracle à le transformer en saint François des temps modernes. L’action violente est-t-elle donc la seule action envisageable pour renverser l’ordre social en place ?
F.B : Je ne sais pas si la violence est la seule solution possible, en tout cas il semble évident que nous sommes dans une période où les modes d’action traditionnels des forces de l’émancipation cherchent à se réinventer, car il y a un certain geste traditionnel qui ne fonctionne plus. La question étant toujours : comment renverser le rapport de force avec les groupes sociaux ou les groupes d’intérêts qui ont la main ?
Z.C. : Parce que sinon les autres alternatives seraient le retrait, ou créer une société autonome ?
En effet, c’est un peu la fin de La Politesse, où s’épanche mon tempérament anarchisant : une promenade dans les niches autogérées. Je sors à peine du tournage d’un documentaire qui s’appelle Autonomes, qui célèbre des personnes ou groupes de personnes en recherche d’autonomie (la vraie autonomie cette fois, pas celle du cadre sommé de s’autocadrer). Ça m’intéresse beaucoup et jamais je n’irais leur faire le procès du style: « pendant que vous inventez votre petit périmètre autonome anarchisant, le monde entier est à feu et à sang, et des centaines de millions de prolétaires souffrent partout ». Ils ont bien raison d’inventer leur propre économie et de se sauver eux-mêmes. C’est déjà quelque chose de commencer par son propre salut. Parallèlement, je peux reprendre la métaphore de la jambe gangrénée, présente dans Histoire de ta bêtise : si vous considérez que c’est une gangrène que vous avez diagnostiquée, alors il faut amputer, si vous avez diagnostiqué que c’est une cheville foulée ou une piqûre de guêpe, vous ne coupez pas. Alors le centriste a l’air de considérer que la société souffre d’une piqûre de guêpe, auquel cas un peu de pommade suffira. Mais si on diagnostique au contraire que le mal est radical, eh bien il faut des solutions radicales, et cela repose la question de la violence, puisque la solution radicale consiste assurément à mettre hors d’état de nuire les forces très organisées et très militarisées du capital, pour faire court.
TOUTE PENSÉE EST RADICALE
Z.C : Dans En guerre c’est la culpabilité qui pousse Romain à entreprendre une action de justice sociale, il fait appel à Alban avocat défenseur des causes perdues, qui l’est d’ailleurs devenu par une sorte de déviation de la victoire personnelle. Le sincère désir d’œuvrer en faveur de la justice sociale, lorsque l’on est un possédant, c’est-à-dire lorsque l’on a “quelque chose à perdre” pour retourner une expression de Louisa, n’existe donc pas ?
F.B : Eh bien, si, mais là encore, il faudrait l’analyser de façon fine. Pourquoi finalement Romain est moins prompt à suivre Louisa qui veut extorquer de l’argent à un patron ? Parce que précisément il fait la balance, qu’on fait tous, entre le risque de prison ou d’emmerdements, et le relatif confort dans lequel il évolue. Le calcul est vite fait : il se dit qu’il n’a pas besoin de risquer. Louisa est dans une autre équation, elle est dans la stratégie du : « je n’ai rien à perdre, j’ai déjà tout perdu : mon pavillon, mon homme dans des circonstances absolument sordides, donc je fonce ». Parce qu’en plus elle est néophyte dans la colère, Louisa : elle était très docile socialement, et pour la première fois quelque chose la révolte, et alors elle montre le zèle des nouveaux convertis, et leur radicalité : il n’y aura jamais de plan social digne de ce nom, il n’y aura pas d’indemnisation à la hauteur, etc. Il n’y aura pas de solution de demi-mesure : il faut des mesures radicales. La voici projetée par le malheur dans la radicalité.
Mais alors comment se fait-il que certains éléments de la bourgeoisie ont des pulsions insurrectionnelles ? Et se retrouvent les porte-paroles ou les théoriciens voire les leaders de ces mouvements insurrectionnels ? Le cas d’Alban est une manière pour moi d’étudier ce phénomène : il vient de la haute bourgeoisie et il se retrouve l’allié objectif, en tant qu’avocat, de la cause sociale. Bon, ça passe par son homosexualité, voilà déjà un truc qui court-circuite un peu les choses, ça le rend sans doute plus sensible aux dominés (car l’homosexuel même riche est toujours dominé dans une société hétéronormée). Entre aussi en ligne de compte le court-circuit érotique de son idylle avec un travailleur immigré. Voilà, il y a mille façons pour un bourgeois de se retrouver aux côtés des forces qui veulent la destitution de la bourgeoisie. À l’inverse, moi j’ai accédé à un niveau de vie bourgeois, mais quand je m’auto-analyse, je pense que, outre mon atavisme de gauche, et mon « tropisme fonctionnaire », c’est mon côté littéraire qui me maintient à vie dans l’orbe de la radicalité de gauche. Car c’est bien d’abord la beauté et la puissance de la pensée radicale qui fait que j’ai envie de m’y inscrire. D’ailleurs c’est ce que j’ai tenté de dire dans Histoire de ta bêtise qui est un livre fondamentalement sur la pensée, j’en viens presque à dire que toute pensée est radicale. Hypothèse à débattre, je m’étonne d’ailleurs que ça n’ait pas été plus discuté. L’élément de discussion c’est que je pense notamment qu’il n’y a pas de pensée centriste. Il peut y avoir un positionnement centriste, il peut même être légitime politiquement, il peut avoir ses raisons (les raisons de la raison raisonnable, qui est d’ailleurs au fond très déraisonnable, car il est très déraisonnable de penser soigner une gangrène par une pommade). Mais du point de vue de la pensée ou de l’art, le centrisme est une zone sinistrée. Le centrisme, parce qu’il n’est pas radical, ne pense pas. Connaissez-vous un seul grand penseur ou écrivain centriste ?
Entretien réalisé en 2019 par Pierre Poligone et Sébastien Reynaud à l’occasion de la revue papier numéro 1 de Zone Critique sur la crise sociale. Vous pouvez vous procurer ce numéro en format PDF ici.
Pour approfondir cet entretien avec François Bégaudeau, vous pouvez également visionner la vidéo de sa venue à RESO où nous l’avons interrogé sur son roman, L’Amour :
- Bégaudeau, François, Vers la douceur, Paris, éditions Verticales, 2009.
- Bégaudeau, François, La Blessure, la vraie, Paris, éditions Verticales, 2011.
- Bégaudeau, François, Deux singes ou ma vie politique, Paris, éditions Verticales, 2013.
- Bégaudeau, François, En guerre, Paris, éditions Verticales, 2018.
- Bégaudeau, François, Histoire de ta bêtise, Paris, Fayard/Pauvert, 2019.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.