Un entretien réalisé au Saint Médard, à Paris, le 26 mars 2025.
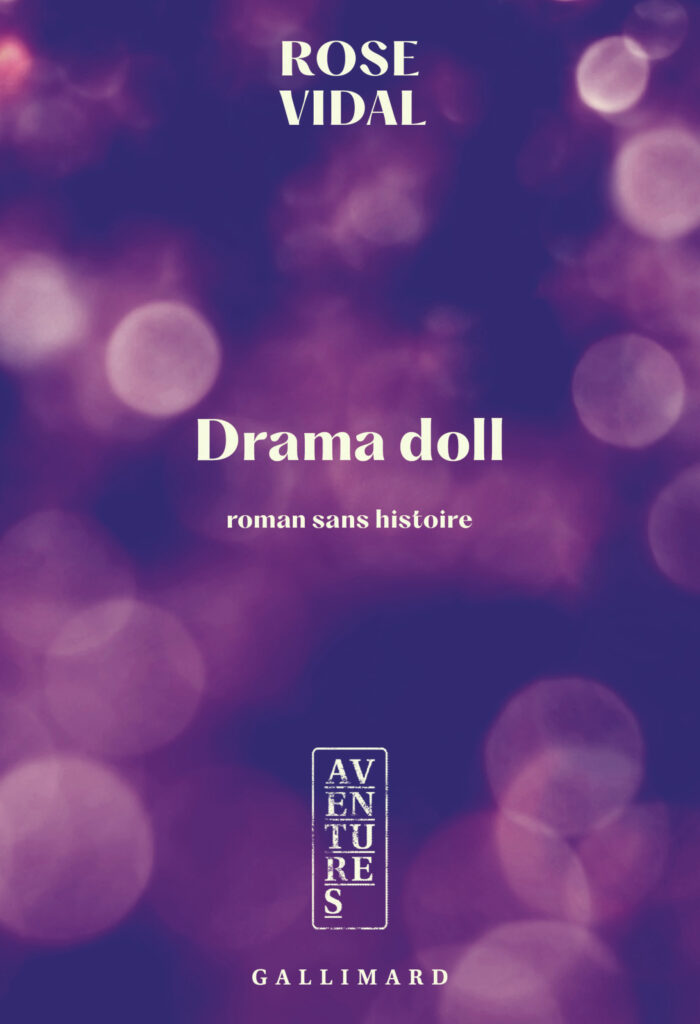
Victor Dumiot : Bonjour Rose. Tu publies ton premier roman, Drama Doll, chez Gallimard, dans la collection « Aventures », fondée par Yannick Haenel. Quel en est le point de départ ? Un roman, « sans histoire ».
Rose Vidal : Je crois que le cheminement a été long, initié dans ma pratique plastique. J’ai longtemps eu du mal à trouver un sujet, à savoir ce que mes travaux plastiques pourraient avoir à dire. Mais les formes sont apparues à mesure que je rencontrais des personnes : je fabriquais alors comme on offre quelque chose. Par amitié, par amour, parfois par réparation. De là est née cette idée d’une pratique qui s’adresse, non seulement à des thèmes, mais à des personnes. Une pratique en forme d’offrande ou d’échange. Ce qui est pratique avec le texte, c’est qu’on peut le donner sans forcément le perdre, à la différence des œuvres plastiques… Pas évident de faire une carrière d’artiste si on passe son temps à tout distribuer toutes ses pièces à la ronde ! (rires)
Victor Dumiot : Ce qui explique sans doute cette écriture disjointe, presque éparpillant la voix dans une série d’adresses. Emmanuelle, notamment, semble traverser tout le livre.
Rose Vidal : Oui… et au-delà d’elle, il y a une volonté d’élargissement de l’adresse. Ces figures, ces instances à qui la narratrice destine les pages. Elles permettent au livre de parler, de manière inattendue, à des lecteurs et lectrices que cela ne semblait pas concerner directement.
Victor Dumiot : Ce qui frappe aussi, c’est cette volonté de faire advenir une forme nouvelle dans le texte.
Rose Vidal : Au départ, j’imaginais ce texte comme une fabrique de formes, un atelier virtuel. Parce qu’à la différence de l’écriture, la production plastique requiert de l’espace, des matériaux, des compétences, une économie contraignante et pas toujours évidente à mettre en place. L’écriture, elle, m’accompagne partout.
Victor Dumiot : L’écriture est mobile. Et pourtant, ce n’est pas une pure expérimentation. Tu travailles la phrase à mains nues. Tu l’inquiètes, notamment par une forme particulière d’écriture inclusive.
Rose Vidal : Cela fait plusieurs années que je travaille sur ma phrase. Je la module, je l’écoute changer. J’en explore les possibilités. Je cherche des variations : comment dire autrement ? Comment penser autrement ? J’ai toujours eu besoin d’écrire pour penser. Ensuite, je taille, j’édite, je monte.
Victor Dumiot : La page devient un espace à part entière, presque une toile. Les phrases, les mots, les lettres, tout y circule hors des logiques classiques. Mais toujours avec un souci de lisibilité.
Rose Vidal : C’est essentiel pour moi : rester lisible. J’ai été formée à l’écriture par l’écriture critique, où la clarté est un devoir. Il faut que le texte puisse parler à quelqu’un. Ce qui me ferait peur, ce serait de m’enfermer dans une écriture hermétique, solitaire. D’où les gestes graphiques dans le livre : les phrases qui s’éclatent, se spatialisent. Pour moi, c’est une manière de géométriser la pensée, peut-être d’en faire un espace habitable.
Victor Dumiot : Comme une carte mentale ?
Rose Vidal : Oui. Le discours est déjà une architecture. Le geste graphique vient simplement souligner cette architecture, sans perdre le lecteur. Il donne un autre accès à ce qui est déjà là.
Victor Dumiot : Certains mots apparaissent en gras. Pourquoi ?
Rose Vidal : J’aime laisser les interprétations ouvertes. Est-ce un mot qu’on lit plus fort ? Un mot qui s’imprime davantage dans la tête ?
Victor Dumiot : Il devient agressif.
Rose Vidal : Ou lumineux. Certains mots ont cette force-là, de toute façon. Je crois que mes explorations stylistiques ou graphiques disent avant tout que j’aime la langue, y compris dans ce que ses formes ont de codifiées. Ce n’est pas un geste de rupture, mais d’attachement. J’aime les langages techniques, administratifs. Mon plaisir, c’est de les faire évoluer, de les plier vers un langage plus souple : celui de la littérature.
Victor Dumiot : Il y a, derrière tout cela, une traque du sens caché. C’est très générationnel. L’écriture inclusive, par exemple, marque cette conscience de la violence symbolique de la langue. Aujourd’hui, nous parlons sans savoir comment nous être entendus. Un simple SMS peut être lu de mille façons. C’est angoissant. Et ton roman capte très bien cette inquiétude contemporaine.
Rose Vidal : Oui, cette inquiétude vient aussi d’une conscience de la puissance du langage. Il peut fasciner, comme un film d’horreur fascine. Il contient des zones d’ombre, des oublis, des invisibilisations. Et comme tu le disais, c’est très lié à la douleur. Il y a une parenté entre douleur et langage, sur cette question du caché. Je crois que j’ai une manière de vouloir mettre en lumière certaines choses, pour mieux les laisser, ensuite, repasser dans l’oubli. Pour moi, rien n’est plus écrasant qu’une douleur qu’on nie, qu’on évite ou qu’on refuse de regarder en face. C’est alors qu’elle surgit au premier plan. J’aime beaucoup l’exemple pictural de la vanité. Comment représenter la mort dans la vie ? La peinture l’a souvent reléguée au fond du cadre, comme pour en atténuer la violence. Car si l’on s’obstine à ne pas la faire apparaître, elle finit par envahir toute la scène. Elle devient écrasante, insupportable. Alors que si on la reconnaît, si on lui donne cette place d’arrière-plan elle perd de son pouvoir de sidération et laisse la vie prendre le devant. Elle devient presque familière aussi, quotidienne.
Je crois que c’est ce que j’essaie de faire avec la douleur : ne pas la poser comme seul sujet, mais comme une réalité difficile à nommer, à accueillir. Nous avons du mal à lui faire une place. Et quand on tente de s’en protéger, on le fait souvent maladroitement.
Victor Dumiot : De la mort.
Rose Vidal : Et de la douleur. D’où la nécessité, peut-être, de savoir en parler. De mettre des mots. Mon livre ne prétend pas épuiser le sujet. C’est une tentative, un essai au sens propre : une proposition. J’écris aussi pour être contredite, reprise, commentée. J’avais envie de lancer quelque chose, et de le voir évoluer au contact des lectures, des retours, des histoires qu’on me racontera en écho. C’est presque une couture à reprendre, un point à rebroder. Repartir du début, s’il le faut.
Victor Dumiot : Justement, cette exploration de la douleur irrigue tout le livre. Douleur du deuil, douleur physique, mais aussi douleur de l’antidouleur elle-même. Tu parles, par exemple, du fléau des opioïdes, de l’addiction aux médicaments. Pourquoi ce rapport si insistant à la douleur ? Qu’est-ce qui t’a conduite à t’y confronter ainsi ?
Rose Vidal : Je crois que c’est un sujet très contemporain. Pas parce que notre époque souffrirait davantage, ou se complairait dans une posture victimaire, mais parce qu’à travers ce genre de phénomènes de surconsommation d’antidouleurs, ou de figures comme Luigi Mangione, elle met la douleur au centre de nos réflexions, comme un point de bascule, une clé pour repenser la culture, l’histoire, nos manières d’être en lien. La douleur devient une voie d’accès, une entrée vers quelque chose de plus vaste. On voit apparaître de nombreux récits de douleur, mais aussi une grande difficulté à les entendre, à les accueillir, à les partager. La crise des opioïdes en est un symptôme, tout autant que les mouvements de libération de la parole.
Pour moi, cela dit quelque chose de notre époque : la douleur comme langage possible, comme forme de reconnaissance, comme fondement même d’une relecture du monde. Elle permet de reconsidérer les structures, les représentations, les récits politiques, symboliques, affectifs. C’est une clé d’accès très actuelle à la culture, à l’anthropologie, à l’histoire.
Et ce que j’aime dans cette manière de penser, c’est que rien n’est figé. On pose des jalons, on se trompe, on corrige. Il y a quelque chose d’excitant à être au début d’une cartographie. Cela permet aussi de dialoguer avec des disciplines différentes, avec des personnes très variées : neurologues, sociologues, artistes…
Victor Dumiot : C’est un vrai phénomène d’époque. Moi qui ai un peu travaillé sur Nicolas Danziger, je vois bien que la douleur devient un vecteur central de notre temps. Mais aussi un point de friction. On l’associe souvent au féminin, notamment dans la littérature : les femmes y racontent leurs blessures, leurs violences subies. Or ce qui m’interroge, c’est la manière dont la douleur peut aussi transformer notre représentation du masculin. Quelle place pour un homme qui dit sa douleur ? Pour moi, certaines figures masculines qui osent le faire sont souvent des incels. C’est terrible, mais c’est aussi révélateur : une douleur intériorisée, tue, peut se retourner en ressentiment, en violence. La douleur, à défaut d’être partagée, se retourne en violence.
Rose Vidal : La douleur et la violence sont étroitement liées. La violence produit de la douleur, mais parfois, c’est la douleur elle-même qui engendre de la violence. Pour moi, c’est un sujet partagé : personne n’y échappe. Et pourtant, on cherche souvent à l’assourdir, à la taire, à ne pas la voir. Cela mène parfois à l’ignorer même en soi. Mais il existe aussi des manières d’en parler, de la partager, de l’apprivoiser. Je ne voulais pas faire de la douleur une identité, ni constituer des identités – même de personnages – sur des douleurs. Ce qui m’intéresse, ce sont les autres formes d’identité que la douleur permet d’éclairer : des formes d’identités relationnelles, des communautés d’attention, de forces partagées, de paroles échangées. Des forces d’espoir et de possibles aussi. C’est là que quelque chose de plus beau peut se créer.
J’explore ces questions dans des champs très différents, parce qu’il y a une base presque scientifique à tout cela. Les corps souffrent, qu’ils le veuillent ou non, qu’ils le reconnaissent ou non. Et cette souffrance déborde le corps individuel : elle habite un corps commun, un corps ancien, un corps futur, un corps transgénérationnel. Ce que je dis là est peut-être moins d’ordre littéraire ou philosophique qu’anthropologique, voire génétique.
Victor Dumiot : Oui, la génétique est passionnante sur ce point. On sait aujourd’hui qu’un traumatisme peut se transmettre. Une personne victime d’une violence extrême peut voir son ADN modifié, et transmettre ce stress aux générations suivantes. Ce n’est plus seulement une affaire de surmoi. Le corps se souvient.
Rose Vidal : Exactement. On l’a observé, par exemple, après des famines : une ou deux générations plus tard, les effets sont visibles sur les générations suivantes. Il en va de même pour la guerre, sur un tas d’autres plans. Ce sont ces phénomènes-là qui m’intéressent. Et je crois ainsi que l’un des grands malentendus autour de la douleur, c’est l’injonction à s’en débrouiller seul.
Victor Dumiot : « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. » (rires)
Rose Vidal : « La douleur n’est qu’une information. » (rires) Ce genre de phrases. Mais si la douleur est à la fois verticale – dans le temps générationnel – et horizontale – dans l’espace et les négociations entre les corps – alors elle dépasse l’individu. Il faut penser autrement. Il faut imaginer d’autres formes de réponse que la seule responsabilité personnelle.
Victor Dumiot : Et justement, ce que tu dis de la douleur, c’est qu’elle est un impossible. Impossible à comprendre, à transcrire, à transmettre. On ne peut pas faire l’expérience de la douleur telle qu’un autre la ressent. C’est pour cela que se créent ces communautés autour du deuil, de la dépression, de l’amputation. Même autour du phénomène incel : ces hommes se reconnaissent dans une même peine, un même isolement. La douleur est une expérience tellement intime qu’elle devient absolue. Et ce qui est très fort dans ton texte, c’est cette intuition que la douleur peut faire peur, qu’elle pourrait être contagieuse. Et c’est cette peur, aussi, qui déforme notre regard sur ceux qui souffrent.
Rose Vidal : Juste avant, tu parlais des communautés. C’est vrai que la douleur semble n’appartenir qu’à soi, qu’on l’éprouve dans une solitude extrême. Et pourtant, lorsqu’on parvient à en parler, quelque chose se déplace. Ce n’est pas qu’on contamine l’autre : on communique. La douleur devient partageable. Elle s’ancre dans un lieu commun – un lieu du corps, du langage, de l’image – qui n’est pas seulement génétique mais culturel. Et si cet espace est partagé, alors il peut faire l’objet d’un travail commun. Il est plastique. Il peut évoluer.
Ce que je propose, c’est de nous intéresser ensemble à ces formes, à ces espaces. Voir ce qu’il advient si on les transforme : est-ce que cela change aussi notre manière de ressentir ? Le docteur Danziger le dit très bien : la douleur s’exprime dans un contexte. Si l’on modifie le contexte, on modifie l’expression, donc possiblement l’expérience elle-même.
Victor Dumiot : Et cette peur de la contagion, justement ? De ce que la souffrance pourrait nous transmettre ? Quel regard portons-nous sur ceux qui souffrent ? Et comment nous en protégeons-nous ?
Rose Vidal : Cette lecture du docteur Danziger m’a aidée à formuler ce que je pressentais : il existe des biais cognitifs qui structurent notre réception de la douleur. Nous avons peur de la douleur, c’est un fait. Et cette peur nous pousse à éviter, nier, fuir. À abandonner ceux qui souffrent. C’est un mécanisme de défense, mais il est aussi culturel. C’est une construction collective, historique. Et donc, ça peut être travaillé.
Les biais cognitifs ne sont pas des fatalités. C’est ce que dit Nicolas Danziger en tant que médecin : il doit et peut combattre ses propres biais, et pour cela, il faut d’abord les connaître. Les rendre visibles. C’est exactement le travail que peut faire la littérature : mettre en mots, déplier ces zones aveugles.
Victor Dumiot : Et en même temps, on pourrait dire que la douleur est un sujet récurrent dans l’histoire des cultures, et pas seulement contemporain. Pensons aux martyrs, aux ascètes. Au XIXe siècle, la douleur est même devenue une valeur littéraire en soi. Le romantisme a posé la souffrance comme preuve de profondeur, souvent dans le registre amoureux.
Rose Vidal : Oui, j’aime beaucoup cette période. Il y a quelque chose d’assez fascinant dans cette émergence de la sensibilité. Dès Rousseau, Diderot, on sent cet éveil à la douleur, mais aussi à l’empathie. Tout le monde pleure, rit, et dans les deux sens : pour soi, pour l’autre. La littérature s’empare de ces sentiments et les fabrique auprès de ses grandes histoires, ses personnages et ses romans.
Victor Dumiot : Tu le dis très bien dans ton livre : le romantisme, en réalité, commence dès le XVIIIe siècle.
Rose Vidal : Quand je parle de Rousseau, de Diderot, je parle d’un temps encore antérieur au romantisme, précurseur. Avant même de se mettre à souffrir, il y a un éveil aux émotions, quelque chose de très intense et, paradoxalement, très joyeux. On passe du rire aux larmes, il y a cette présence du sensible, très vivante, très incarnée. Et dans la littérature de ce siècle, ce sont des scènes de partage, des pleurs et des rires collectifs. Ce que j’aime, c’est cette vitalité, cette humeur mouvante, cette capacité de l’émotion à circuler entre les êtres. Ce lyrisme m’intéresse, car il ouvre la possibilité d’un chant, d’une poésie qui vient de loin, d’un souffle ancien.
Je crois que mon écriture peut parfois prendre ces accents-là. Et j’aime jouer avec cette idée, même un peu floue, de « romantiser ». Il y a le romantisme comme courant littéraire, comme esthétique, mais aussi la forme verbale : romantiser, dans son usage presque péjoratif. C’est une confusion avec le romanesque, sans doute. Mais ce flottement sémantique m’intéresse. Je ne sais pas exactement où cela mène, mais je sens que c’est fertile.
Victor Dumiot : Tu as raison, d’autant que le romantisme plonge effectivement ses racines dans Rousseau. C’est aussi un moment de redéfinition du roman. Et c’est ce qui m’a beaucoup frappé dans ton texte : c’est un roman qui interroge en profondeur la forme romanesque. Je viens de travailler sur un courant né aux États-Unis vers 2010, l’alt-littérature, ou alt-lit, qui ne cherche pas tant à raconter l’actualité qu’à penser comment l’actualité transforme la littérature. Et chez toi, on retrouve cela aussi, notamment dans les échanges avec Benoît.
Rose Vidal : Oui, Benoît Piéron.
Victor Dumiot : J’aime beaucoup son travail. Je ne l’ai jamais rencontré, mais tu le rends adorable dans le livre. Vos dialogues sont remarquables. Et le fait d’avoir intégré des captures d’écran, je trouve que c’est un geste très contemporain, très juste. La littérature doit évoluer dans ses approches, dans ses formes, dans ses supports. On appartient sans doute à une génération qui écrit beaucoup, tout le temps. Peut-être est-ce pour cela qu’on lit moins. On n’a plus besoin de se laisser remplir, on est déjà saturé d’écriture.
Mais avant d’oublier, je voulais te poser une question. Tu emploies, à propos de la douleur, ce terme fort : « effractante ». C’est une belle définition de la littérature, je trouve. Puisque la douleur est, par essence, incommunicable, qu’elle dépasse le langage, n’est-elle pas, justement pour cela, le sujet parfait de la littérature ?
Rose Vidal : Je veux bien croire que la douleur est un sujet parfait pour la littérature, en tout cas c’est celui que je me suis donné comme tel ! Tu évoquais tout à l’heure les SMS, et cela me fait penser qu’entre le langage parlé et l’écriture, il existe une infinité de typologies textuelles. Ce n’est pas un simple spectre hiérarchisé, polarisé entre oralité et langage écrit. Ce sont des zones, des pratiques, des usages, qui se croisent, se répondent. Ce qui m’intéresse, c’est le temps qu’on passe dans ces différentes formes.
J’écris beaucoup de critiques, j’écris aussi beaucoup de SMS. Et le temps passé à ces gestes, dans ces endroits du texte, ça participe à mon rapport au langage, donc à ma littérature. Tout ce que j’ai pu expérimenter dans l’un ou l’autre m’a transformée. Cela me construit. Et ce que je trouve fascinant, c’est que dès lors qu’on considère toutes ces zones comme des lieux possibles du langage, la question devient : quel temps y passe-t-on ? Que fait-on de chacun ? Qu’est-ce qui se fait ici plutôt qu’ailleurs ?
La littérature est-elle le lieu idéal pour accueillir la douleur ? Sans doute. Mais alors, dans quelle forme ? Un hyper-poème, une forme ultra-resserrée ? Un texte long et poreux, qui circule d’une forme à l’autre, comme celui-ci ? Ou dans des fragments de SMS ? À chaque fois, il se passe autre chose. Et la douleur, elle aussi, part dans tous les sens. Physique, morale, émotionnelle, médicale, traumatique… Elle appelle une littérature qui puisse mobiliser toutes les ressources du langage, dans sa diversité, sa souplesse, son articulation.
Victor Dumiot : Et justement, cette incommunicabilité apparente de la douleur…
Rose Vidal : J’aurais du mal à faire sans elle. Je veux dire : c’est ce qui donne du courage, aussi, et motive l’écriture. Ce que montre Nicolas Danziger, et ce qui me parle beaucoup, c’est qu’on est bel et bien capables de comprendre la douleur de quelqu’un d’autre, d’en approcher quelque chose. C’est une question d’attention, de décentration. Et Danziger, en tant que figure scientifique, m’a ouvert une réflexion importante. Le plus curieux, c’est que je l’ai rencontré par hasard, et ce hasard dit beaucoup de choses du livre. Ce texte s’est construit dans une suite d’ouvertures imprévues.
Le fait de me lancer dans ce sujet, c’était déjà un geste, un engagement, et j’ai senti qu’en me tenant à ce geste et son exigence proche, un monde s’ouvrait devant moi. Et à partir du moment où j’ai commencé à parler de ma démarche et mon sujet, j’ai reçu. Beaucoup. Des retours, des confidences. Des gestes d’attention. Cela m’a portée. Et je me suis laissée porter.
Chez Danziger, ce qui m’a notamment attirée, c’est la manière dont il propose une sorte de méthodologie pour recevoir la douleur. Parce que c’est un sujet difficile à recevoir. Il faut s’y préparer. Et le fait qu’il soit médecin ne l’empêchait pas d’avoir cette approche très humble, pratique, éthique, sur la manière dont on accueille une personne, pas juste un sujet médical. Une personne, ça te dépasse, ça te déborde toujours. Cela m’a guidée dans mon propre travail.
Il y a aussi dans sa pratique et ses recherches tout un univers plastique, presque artistique. Des protocoles, des gestes, des images. Certaines des photographies de ses livres m’ont bouleversée. Je me suis mise à dessiner à partir de l’une d’elles. Et elle est devenue ainsi, pour moi, une image de la douleur. Ça m’a vraiment aidée, en tant qu’autrice mais aussi en tant qu’artiste.
Victor Dumiot : Et on revient à cette question de l’incommunicable. Comment parler de la douleur ?
Rose Vidal : Oui. La douleur, c’est l’incommunicable. Mais aussi le mystère. Ce mystère-là, je le dis sans grandiloquence, mais en veillant à respecter son épaisseur, une sorte de résistance qui agrandit le monde. Je crois que le langage a justement aussi ce double pouvoir. Il éclaire le monde et, en même temps, épaissit son mystère.
- Drama Doll, Rose Vidal, Éditions Gallimard, mars 2025.
- Crédit photo : ©Vincent Ferrané.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.