Notre Chute de John Jefferson Selve est notre « Vrilles » de juin 2024. Cette nouvelle met en scène un écrivain qui chute littéralement – il se trouve dans un avion en train de tomber. Cette chute est également symbolique : c’est celle de la littérature qui, à notre époque, est asservie à des contraintes économiques et médiatiques. Estelle Derouen a rencontré Jefferson Selve pour qu’il développe les thèmes évoqués dans son texte.
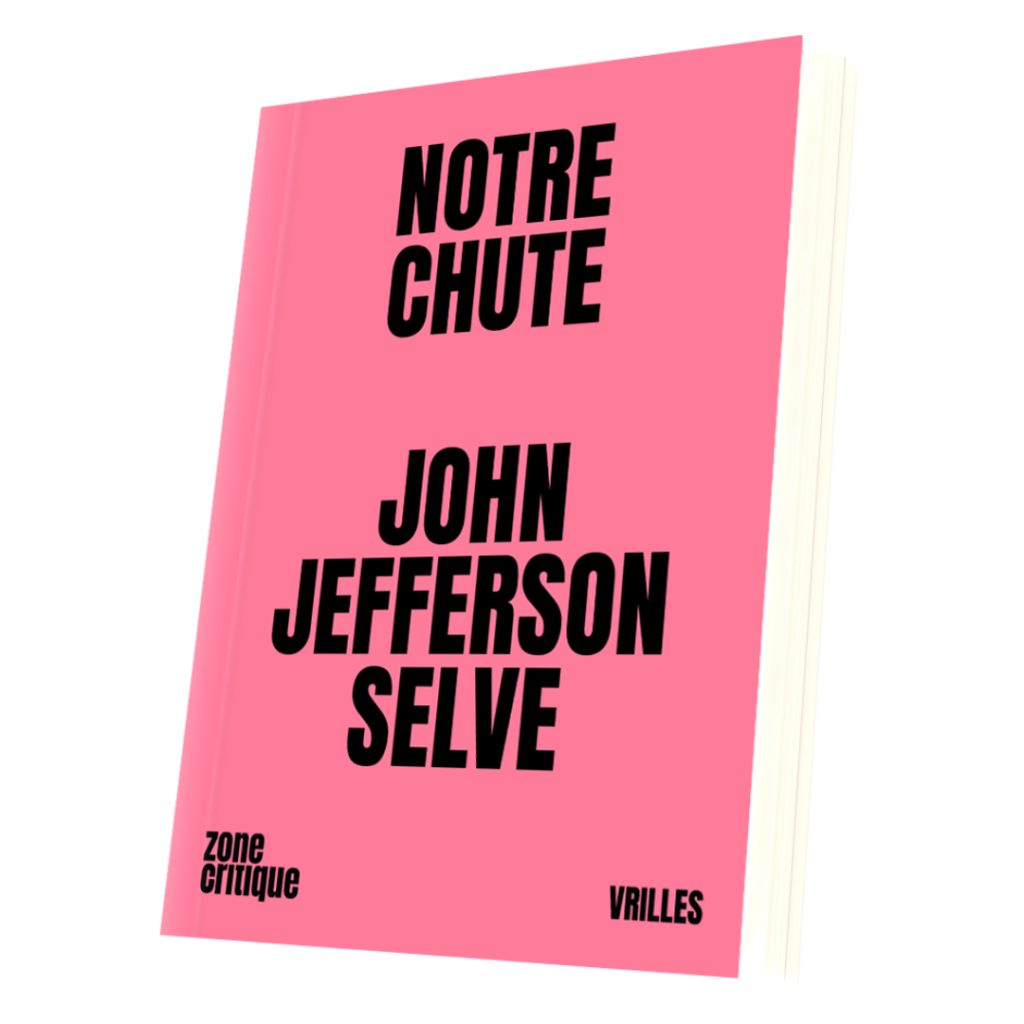
« Notre chute » comme notre monde « qui tombe », comme métaphore de ce qu’est censé provoquer la littérature et de ce mouvement qui pousse aux aveux que l’on jette à la mort attendue. Cela peut faire penser au film Les Amants passagers de Pedro Almodóvar mais, de façon plus sérieuse, le titre rappelle La Chute d’Albert Camus. Il s’agit après tout de confessions du narrateur qui s’exprime sur le monde et son époque à travers le prisme de la littérature et une certaine vision de l’enfance. Se faisant, il inclut le lecteur jusqu’à s’adresser à lui directement et ce dès la première page : « Rien ne t’oblige à continuer ». Qu’est-ce que vous aviez envie de provoquer avec une narration aussi frontale ?
Je voulais que l’opposition, le fait d’être « contre », sous-tende le texte comme un duel. « Entre dans la société par un duel » dit Stendhal. J’ai toujours aimé cette phrase. Plus encore depuis que l’on suffoque d’une certaine forme déviée de bonnes manières ou d’une volonté de vertu parfois mortifère. Du moins d’un point de vue de la création et de l’art littéraire. Alors la littérature comme duel, comme résistance à la mort pour reprendre Agamben. Alors oui, vous avez raison le texte est frontal, même certainement peu aimable dans un premier temps. Mais je voulais cette percussion comme une attaque, afin d’être du même coup attaquable, et vivant. Ça m’est apparu être la porte d’entrée quand Victor Dumiot m’a proposé d’écrire un court texte irrévérencieux et que tout de suite j’ai eu la littérature en tête comme sujet. Puis j’ai écrit très vite et j’ai repris très lentement. J’ai mis l’urgence au ralenti ; pour totalement me consacrer à cette chute mentale et littéraire.
Évidemment Notre chute voulait ce signal hommage à Camus. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une certaine sottise littéraire, ambiante et de bon ton, trouve intéressante de revisiter son œuvre pour distribuer bons et mauvais points dans un présent certifié perpétuel. C’est tout ce que je déteste : les donneurs de leçons a posteriori. Sachant que la moindre ligne de Noces par exemple vaut bien plus que tout le verbiage de ceux qui descendent Camus. Et je trouvais que c’était tout simplement un bon titre pour nous tous.
https://zone-critique.com/critiques/oublier-camus
Avec cette deuxième personne du singulier, vous parlez au lecteur, certes, mais pas seulement. À qui vous adressez-vous plus exactement ?
Concernant sa destination, pour être honnête, ce texte était aussi dans un premier temps une adresse mentale et un peu narquoise à Édouard Louis et Nicolas Mathieu. Alors qu’au fond, je me considère à gauche et que je suis souvent d’accord avec ce qu’ils énoncent. Mais ce côté plan médias et éléments de langage : les bonnes pensées au bon moment, pour les bonnes personnes, ce côté écrivains de gauches performatifs, m’agaçait pas mal il y a un an quand je pensais à écrire ce texte. Prêcher les convaincus, ça m’emmerde autant que cela me met mal à l’aise. Alors avec, je l’avoue, une dose de mauvaise foi et certainement une légère once d’envie pour leur compte en banque, j’ai eu envie de leur écrire sur ce ton-là. Puis très vite, j’ai abandonné l’idée parce qu’elle me limitait à tous les points de vue. Mais enfin, s’introduire comme écrivain de gauche ou storyteller sa mère… Tout de suite, j’y vois, peut-être injustement, un côté ustensilaire. Venant moi aussi d’un milieu pauvre, je pense souvent à cette phrase du groupe Asocial Club, « tu prives la misère de sa fierté. ». En même temps, vous disant ça, je suis tout de même content qu’ils existent et vendent des livres. Ils ont leur utilité. Voilà, c’est ça ! Ils sont plus dans la fonction militante, aujourd’hui je ne vous dirais pas que ça ne compte pas. Mais enfin ce n’est pas mon monde et mon envie de littérature. Parce que nous savons tous, de façon plus générale, même s’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, que la littérature s’énonce trop souvent comme un argument de vente binaire : arguments sur les déclassés, sur les faits de société, les victimes, les coupables… On s’intéresse de moins en moins à l’essence littéraire, sa pneuma comme disent les grecs, qui est à la fois son âme et son nerf. J’aime les livres sans sujets qui se reniflent trop vite.
La littérature s’énonce trop souvent comme un argument de vente binaire : arguments sur les déclassés, sur les faits de société, les victimes, les coupables
Enfin ce lien entre la littérature et la politique est un vaste sujet et il habitait le début de Notre chute. Parce que ce lien est quand même le mien mais je l’imprègne par les sensations et la rythmique de la phrase avant tout. Et pour aller jusqu’au bout de ce name dropping, à l’époque je n’avais pas lu Mathieu, faut reconnaître qu’il a un truc. Toutefois dans le nouage littérature et politique, je trouve que Joseph Andras s’en sort haut la main. Même si à le lire, je me sens comme Le Coupable de Bataille, pris dans des obsessions qui ne font plus forcément société, c’est sûr… Enfin lui ne cède rien à la langue. Ethos et esthétique se confondent, par-delà son militantisme et je trouve ça honnête. Son essai avec Kaoutar Harchi, Littérature et révolution se situe à cette intersection, sans être tiède ou dans une novlangue psychosociologique de devenir bourgeois. Il n’a peur du déboulé des phrases comme dirait Pierre Michon. Et pour revenir enfin à Notre chute, ce déboulé, et je crois la seule chose que je possède. Ce qui n’est pas grand-chose, mais secoue parfois un peu la machine. Excusez-moi je pars de loin, mais la genèse du ce petit livre rose vient de tout ça.
La première phrase de votre nouvelle est « Je me fous de la littérature », pour finalement tout un texte qui exprime l’inverse. Pour autant, l’écrivain prend aussi cher que le lecteur. Qui est le plus responsable de l’état de la littérature, que vous considérez sans tellement de nuance, aujourd’hui ?
À Radio France Macron, j’entendais il y a quelques jours que cela pourrait être une bonne chose de supprimer le mot « désir ». Bon… On touche l’un des nœuds de l’affaire. Qu’ils s’agissent du maigre désir des grands éditeurs, de l’absence de désir des lecteurs, on ne peut pas dire que la puissance de vie littéraire, sa reviviscence soit là. Faut que ça aille vite, faut tourner les pages. Sans perdre de temps. Pas que ça à faire. Faut digérer vite aussi, avant d’aller ronronner des platitudes dans les médias. Mais puisqu’il faut choisir un coupable, je dirais l’écrivain. Pour faire une comparaison, je ne me bouche pas le nez devant les électeurs du RN, mais je pardonnerai difficilement à tous ceux qui ont servi ce parti et ses idées sur un plateau depuis des décennies. Quelle violence. L’inconséquence de ces émetteurs est macabre.
Est-ce qu’on a le droit de dire que vous n’aimez pas vraiment les livres qui ont du succès en ce moment ? J’ai quand même envie de vous demander ce qui a pu vous secouer récemment en la matière.
Au contraire, je ne souhaite que leur succès. Puis précisons, beaucoup de maisons font le job. Je pointe plus un système pernicieux et dominant économiquement que la vie littéraire elle-même. Et il existe des textes contemporains qui marchent bien, des textes exigeants, parmi tant d’autres : Laura Vasquez par exemple dont je lis les livres et observe la démarche, ou Ocean Vuong. Yannick Haenel aussi depuis longtemps montre qu’il est possible d’avoir une certaine exigence et un lectorat. Et, j’en oublie un certain nombre bien sûr.
Puis la revue littéraire et artistique Possession immédiate, dont je me suis occupé pendant dix ans est composée d’écrivaines et d’écrivains dont j’aime le travail et que je lis attentivement. Par-delà leur hétérogénéité, existe chez eux une perception de l’existence qui nous sert de lien. Ce lien crée une philia, une camaraderie essentielle aussi, qui me donne envie de publier. Parce que la puissance paradoxale de l’art littéraire réside pour ma part dans son anarchie et ses tourbillons qui, je le crois, dépasse les clans et les polices. Dans le sens où il faut le répéter, la littérature n’a pas de leçons à donner. Il n’y a pas de pouvoir à prendre, seulement une certaine anarchie à faire vivre, avec ses parts maudites et ses pulsations amorales. Pour moi, l’espace littéraire de Possession immédiate a toujours été dans cette volonté de trembler, et ce tremblé, cet indéfini n’est pas sans une certaine sauvagerie. Écrire coûte. Je vois trop de confort dans les livres mis en avant. Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas dans tous les manuscrits que je reçois où les travaux des étudiants, que je peux suivre à La Cambre où j’« enseigne », beaucoup ont le verbe fort.
Vous ne craignez pas de passer pour un réac ?
Les réacs aujourd’hui sont ceux qui veulent interdire les livres et les œuvres d’art. Qu’ils soient à droite ou à gauche. Ils sont en tout cas de plus en plus nombreux. Mais pour ma pomme, ça ne marche pas. Certes, ma curiosité « intellectuelle » et politique est liée à la philosophie de la technique. Je pense à Günther Anders ou encore Bernard Stiegler qui, il y a 15 ans, dénonçait déjà les divers troubles de l’attention et les conséquences de l’intelligence artificielle sur des millions d’emplois en Europe et États-Unis d’ici une vingtaine d’années. Si le progressisme d’aujourd’hui c’est les IA ou la pharmacopée mondiale alors je ne suis pas progressiste. Mais enfin une France politique qui tape sans cesse sur les immigrés et se pavane à la moindre tablette ou à la moindre intelligence artificielle utilisées à l’école de la république me dégoûte. Parce que le sous-texte de tout ça est simple, il s’agit de ne plus lire, dans le sens le plus noble de ce verbe. Il s’agit de ne plus lire et donc de ne plus écrire. Si le ressentir est réac alors amen.
Tout grand texte demande une part de risque.
« La littérature est une guerre comme les autres. », cela signifie que la littérature serait l’objet ou le sujet de cette guerre ?
Je pense qu’elle est les deux mais et que tout grand texte demande une part de risque. Et pour le dire autrement, Faulkner et Lowry, ces grands esprits des méandres intérieurs ne passeraient plus chez un éditeur généraliste. Je l’avoue je suis un peu nostalgique de cette impression du monde où la littérature demandait un effort avant d’atteindre la grande sensation de l’Existence. Notre chute parle de ça, de cette peur que les livres à venir perdent de leur pouvoir pour n’être plus que des décorums culturels bon marché.
https://zone-critique.com/critiques/sortir-du-monde-meta-carpenter
Dans Notre chute, vous parlez du métier d’écrivain, et de ce qu’il ressent lorsqu’il écrit. Je pense notamment à cette phrase par exemple : « La littérature est un AVC. Tous les écrivains font des micro AVC à chaque phrase réussie ». Il est en fait question du sens que l’on donne à cette activité, quel en est le vôtre si ce n’est, comme vous l’écrivez aussi, de « choisir son tombeau » ?
Un peu plus loin j’écris « La littérature est une langue dans un trou. Le reste n’est que technique », et « L’encre fulgure le trop d’humains en vision », ce que je veux dire pour reprendre le début de notre conversation est que tout se tient dans cette Résistance à la mort. Et qu’elle passe par-delà le fait de montrer ou de dévoiler des désordres ou des mouvements de pensées. Il y a quelque chose de plus physique dans l’écriture, des trappes de sensations où l’on tombe. Des odeurs et des vertiges qui surgissent, suintent, font secréter la tête de tout ce que peut être la nécessité d’écrire, et c’est pour ma part une certaine béatitude négative. Il faut aussi que les phrases s’avalent, se crachent, enfin faut que ça coule un peu. Une littérature sans secrétions, incapable de s’insinuer là où elle ne sait pas, ne m’intéresse plus.
Comment avez-vous senti que c’était le moment ?
J’ai pu voir le moment venir parce que j’écris très peu. Disons que c’était spirituel. Des fantômes du passé m’ont parlé.
Outre la puissance de l’écriture, il est aussi question de celle de la lecture, la fin de Martin Eden étant une illustration du considérable vertige qu’elle peut provoquer. D’ailleurs, vous dites que vous ne l’avez pas lu mais je ne vous crois pas, ai-je tort ?
Oui ! Même si j’en ai lu après coup de longs passages mais je ne voulais pas le lire dans son entièreté afin de préserver cette imago, cette scène visuelle primitive de mon enfance où je vois Martin Eden se suicider. D’ailleurs, je l’ai retrouvée sur Internet, elle provient d’une série italienne diffusée en France en 1983. En retombant dessus, j’ai réalisé qu’elle était identique à mon souvenir alors que je n’ai habituellement aucune mémoire. C’est un moment sublime et terrible, avec cette lumière à l’envers qui tombe dans l’eau. Tout se retourne, le ciel est au fond. Ce qui le rend plus céleste encore. L’on comprend tout de suite que Martin Eden plonge pour mourir. Quand on est enfant, ce genre de scène est à la fois une révélation et une effraction. Ça touche à plus profond que soi. En même temps je comprenais le geste, je découvrais que l’autre, mon semblable, pouvait se donner la mort. L’idée était de retrouver ces sensations de l’enfance, auxquelles je suis lié à vie. Je voulais que le narrateur chutant dans son avion se synchronise avec cette chute qui est celle du héros tombant au ralenti au fond des océans.
Puis Martin Eden, c’est quand même l’histoire d’un jeune écrivain qui se fait humilier par une idéalisation de la littérature. Une fois les réussites, il voit les concessions à la bourgeoisie et il en meurt. Encore une fois, écrire coûte. Même si ça ne se dit plus et que je n’ai pas envie aussi qu’on y entende une sorte de passion mortifère. Mais il y a aujourd’hui une bourgeoisie de l’écriture, un confort de communicant, je voulais que Notre chute lutte contre ça. De manière un peu folle ou donquichottesque avec des morceaux d’enfance et de sensations dedans.
Et vous, qu’est-ce qui vous fait le plus d’effet entre lire et écrire ?
Pendant très longtemps, c’était lire. J’ai un côté Bartleby de l’écriture, « je ne préfèrerais pas ». Il faut que je sois seul pour sortir de moi, écrire est encore à mon âge de l’ordre de la honte. Et j’ai toujours une bonne raison pour esquiver la chose. Se mettre à table n’est pas simple. Ajouté à ça une réelle fainéantise, c’est encore plus délicat.
À un moment, dans votre nouvelle, on peut lire : « Le déluge illimité de films, de musiques, de livres et de pornos est un rêve d’enfant. Mais tu le ne sais plus. Parce que tu ne vis pas. Tu fonctionnes. Efficace et miscible dans le grand nulle part. » Qu’est-ce que vous voulez dire ?
J’ai quand même l’impression, qu’il n’y a plus rien de gratuit, c’est ce à quoi je pense quand je dis « tu fonctionnes ». Nous sommes tous notre petite entreprise. Je regrette l’époque où les écrivains étaient plus inconséquents sur ça. Ils n’étaient pas obligés de faire eux-mêmes leur service après-vente, leur communication, maintenant il faut être son propre animateur télé, son propre connaud sur les réseaux. Ça semble obligatoire, sinon c’est facilement la sellette si l’apprenti écrivain n’est pas à l’aise avec la performance. Dommage.
Après l’été, nous aurons ce rendez-vous annuel qu’est la rentrée littéraire. Comment vivez-vous ces périodes ? Ne peut-on pas se réjouir de la « place » qu’elles prennent ?
Je l’ai vécu de l’intérieur et comme pigiste. Bien sûr je lis les livres de mes amis. Je vais bientôt m’atteler à celui de Jean-Noël Orengo : Vous êtes l’amour malheureux du Führer qui travaille la figure de l’architecte Albert Speer, ça à l’air passionnant. Sinon ça fait longtemps que le barnum de cette rentrée m’indiffère. Même si contrairement à beaucoup, je ne me plains pas du tout du nombre de livres. Puis encore une fois, il y a des maisons d’éditions, des petites structures qui proposent des choses vivantes. Chaque année je découvre des voix, faut juste faire un léger pas de côté.
Avez-vous peur de prendre l’avion ? Vous seriez du genre à vouloir maintenir vos yeux ouverts en cas de crash ?
J’ai eu peur de l’avion assez tard, vers 32 ans. Pour l’anecdote, j’ai été journaliste automobile quelques mois, et je suis parti une fin de septembre à Barcelone, essayer une Maserati sur un circuit ; et il y a eu une tempête de neige durant le vol. Ça secouait très fort. Et je n’ai même pas pu me raccrocher au regard bienveillant des hôtesses de l’air parce qu’elles-mêmes flippaient. Leur abandon m’a fait vriller. Depuis, j’ai ma petite recette : anxio- alcool, parfois un bétabloquant quand j’en trouve un. La posologie est efficace, je recommande.
Après, dans cette chute d’avion si souvent rêvée, je ne peux pas savoir comment je réagirai. C’est un peu comme dans Melancholia de Lars Von Trier (grand froussard de l’avion devant l’éternel), est-ce que je garderai les yeux ouverts ? J’espère que oui car j’ai une nature de « voyeur » mais bon, j’espère ne pas avoir à le savoir. Cela dit pour être météorologique, ce que je décris dans la nouvelle, le phénomène de turbulence en air claire (TAC) se développe en raison du changement climatique. Pour le moment, ça ne concerne pas l’Europe mais des avions font des chutes libres de quelques centaines de mètres. Elles sont totalement imprévisibles. De plus en plus d’avions tombent comme ça. Il y a eu deux trois chutes ces dernières semaines. Je crois que ce n’est qu’un début.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.