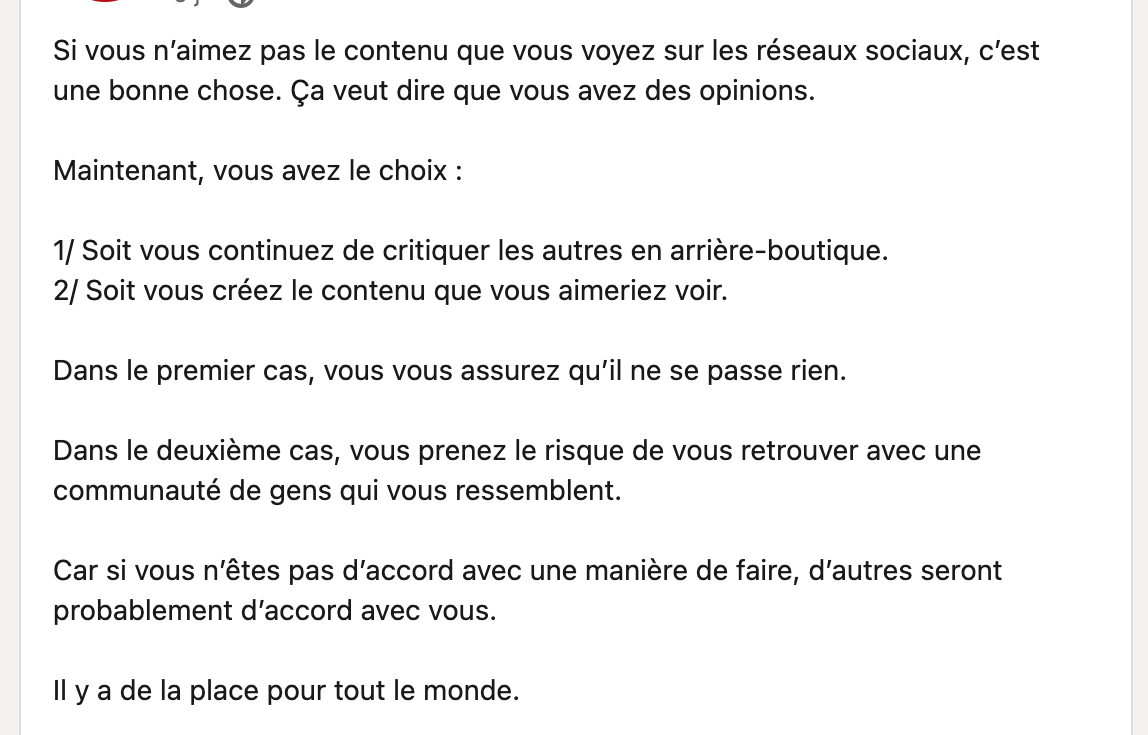ENQUÊTE. Pendant deux mois, de mai à juillet, notre journaliste – en fin de droits au chômage – s’est immergée dans le réseau social à but professionnel aux 30 millions d’utilisateurs dans l’hexagone. En sortira-t-elle indemne ? Rien n’est moins sûr.
J’avais un CDI, je n’en ai plus voulu. Un matin, j’ai débarqué dans le bureau de ma rédactrice en chef pour solliciter une rupture conventionnelle, requête qu’elle a acceptée sur le champ – à croire qu’ils n’attendaient que ça au journal, me voir tourner les talons. Disons que j’avais besoin d’une pause, de souffler, et surtout, d’écrire pour moi. Deux ans plus tard, voyant la fin de mes indemnités approcher comme l’iceberg du Titanic, je me suis dit qu’il me fallait réagir avant le naufrage. Comprendre : retrouver un job.
Premier réflexe, remettre à jour mon profil LinkedIn. Ça me semblait tomber sous le sens, et puis, il ne m’avait pas échappé qu’au même moment, la plateforme venait de passer la barre des 30 millions d’utilisateurs dans l’hexagone… Dix millions de plus qu’en 2020, deux fois plus qu’en 2017. Un milliard à l’échelle mondiale !
Premier réflexe, remettre à jour mon profil LinkedIn. La plateforme venait de passer la barre des 30 millions d’utilisateurs en France.
De cette brève incursion printanière j’ai tiré deux constats. 1/ Ma carrière ressemblait à une robe Desigual. Les stages non rémunérés dans des médias moribonds côtoyaient des jobs d’été dans la restauration ou le télémarketing, lesquels se retrouvaient à côté d’une brève expérience de fichiste pour un animateur du PAF, bref, on n’y comprenait goutte. J’ai procédé à un élagage drastique pour ne conserver que mes expériences solides en journalisme ; 2/ Des gens que je croyais pourtant connaître dans la « vraie vie » me sont apparus, comment dire… bizarres. Je pense à cet ami de lycée devenu informaticien qui avait décidé de transformer son open space en téléréalité. À cette ancienne camarade de Sciences Po fraîchement reconvertie en coach « bien-être », qui distillait chaque matin un conseil pour surmonter un burn-out illustré par une photo d’elle en position du chien tête en bas. Ou à ce journaliste sportif devenu consultant en growth (croissance) qui se targuait de démultiplier votre chiffre d’affaires tout en s’exhibant au volant de grosses cylindrées.
Effrayée par cet étalage très premier degré, je me suis déconnectée. Mais LinkedIn ne l’entendait pas de cette oreille. Dès lors que j’avais remis une pièce dans l’algorithme, il n’y a pas eu un jour sans que je reçoive un mail de relance du type : « Lisa, on vous remarque… », « Découvrez qui a consulté votre profil cette semaine ! », « Lisa, félicitez Nadia pour ses 6 ans chez L’Oréal », « Lisa, saviez-vous que LinkedIn est encore plus performant sur l’application ? », « Lisa… »
À force de spamming, je me suis demandée : c’est quoi ce bordel avec LinkedIn ? Et puis d’autres questions dans la même veine : ai-je intérêt à y retourner ? Si oui, comment vais-je virer ? Ou encore : faut-il vraiment y être pour exister, professionnellement du moins ? Et enfin : c’est quoi le travail ?? J’étais super angoissée.
Un lundi, je suis allée trouver conseil chez Séverine Bavon, la fondatrice d’Acracy, une communauté de freelances créatifs, et animatrice d’une réjouissante newsletter sur le travail intitulée « CDLT » sur Kessel Média. « LinkedIn est un mal nécessaire, m’entreprend-elle en me servant un café. Toute personne saine d’esprit y va forcément contrainte et forcée ».
Pour ma part, je me suis inscrite en 2009, soit six ans après sa création en Californie par Reid Hoffmann, le père de Paypal. Comme pour Facebook, j’y suis allée de manière automatique, parce qu’il fallait en être, j’imagine, et aussi parce que 2009 coïncidait avec mon entrée dans la vie active. Par chance, je n’ai jamais eu besoin de m’attacher ses services. Jusqu’à ma désertion du journal, tout a roulé comme sur des roulettes. Les opportunités se sont succédé de façon naturelle, fluide. J’avais la win. Aujourd’hui, c’est l’inverse.
Comprenant mon désarroi, ma marraine LinkedIn m’oriente vers Nina Ramen, papesse du Personal Branding sur LinkedIn – terme qui désigne le fait de créer sa marque personnelle. Au départ, rien ne prédestinait cette « dyslexique sévère » de 33 ans, ayant grandi en région parisienne, à devenir une des coachs les plus en vue de la plateforme. En 2017, alors qu’elle travaille comme recruteuse dans le domaine scientifique, LinkedIn n’était encore qu’une simple CVthèque avec un fil d’actualité très convenu. « C’était très axé recrutement » me confirme-t-elle par téléphone. S’inspirant des pionniers du genre, la jeune femme commence à émettre du contenu en son nom propre. « Et là, je me rends compte que ça m’apporte plus de crédibilité, plus de business et donc plus d’espace dans mon écosystème. » Aujourd’hui, elle a quitté l’entreprise traditionnelle pour vendre ses propres formations et dépasse le million d’euros de chiffre d’affaires annuel.
« Les solopreneurs sont les start-uppers d’il y a dix ans, me confirme mon amie Isild, qui s’est formée à LinkedIn sur le tas. Aujourd’hui, les jeunes d’écoles de commerce n’ont qu’un objectif : le freelancing, le freelancing, le freelancing. On se fait tout seul, on monte sa marque personnelle à coups de publications LinkedIn et on engrange le maximum de cash. En un sens, le solopreneur réactive la figure du self-made man. »
Audience et cash, c’est le crédo des gourous de LinkedIn. Maud Alavès, 32 ans, ancien mannequin et « Top Voice » LinkedIn, ces influenceurs élus par la plateforme, soutient que LinkedIn est le dernier réseau où il est encore possible de « percer » sans trop d’effort. À condition d’être régulier. Suivant à la lettre les conseils distillés par les stars américaines ou ceux de l’influenceur Grégoire Gambatto, auto-proclamé « homme le plus détesté de LinkedIn », en seulement deux ans, la jeune femme a réussi à atteindre les 10 000 euros mensuels, soit le « SMIC LinkedIn ». C’est encore Isild qui m’a parlé la première de cette rémunération étalon. Quand on sait que le vrai SMIC est de 1 400 euros, ça laisse songeur…
Maud reconnaît volontiers sa part de responsabilité dans cette « petite blague » qui continue d’affoler le réseau. « Je pense que ça vient du fait que moi et quelques autres avons parlé ouvertement de notre rémunération. D’autres ensuite sont venus affirmer que si l’on ne faisait pas 10 000 euros par mois, on serait des losers. »
Les autres, comme elle dit, ce sont les Growth Hackers, ces pirates de croissance qui promettent de démultiplier votre chiffre d’affaires en un claquement de doigts. À en croire toutes les personnes que j’ai interviewées, le premier d’entre eux serait actuellement Thibault Louis. Casquette « Bossistan » vissée sur le crâne, ce « solopreneur d’élite », comme il se définit lui-même, déroule sa mission en tête de son profil : « Aider les entrepreneurs internet à gagner plus d’argent en restant alignés avec leur style de vie. » D’après son feed, le sien semble osciller entre les hôtels de luxe, la salle de sport, et Elon Musk, qu’il cite régulièrement : « Optimism, pessimism, fuck that. We’re going to make it happen, and God is my witness ».
Une autre de ses saillies m’a fait bondir dans mon lit : « 99 % des livres pourraient être résumés en 5-10 pages. Le reste n’est fait que pour démontrer la thèse de l’auteur. La majorité des livres sont nuls à chier, d’ailleurs n’importe quel pimpin peut écrire un livre en 2024. » Moi qui m’échine sur un manuscrit depuis des mois, je suis prête à faire péter mon PEL pour m’offrir les services de Thibault Louis, et je le dis sans aucune ironie tant il me fascine…
N’empêche, certaines publications sont tellement extrêmes qu’on a du mal à savoir s’il faut les prendre au sérieux.
N’empêche, certaines publications sont tellement extrêmes qu’on a du mal à savoir s’il faut les prendre au sérieux. Séverine me cite pour exemple cet Américain « qui a buté tout le monde » en écrivant : « J’ai demandé ma copine en mariage ce week-end et voici ce que ça m’a appris sur les sales b to b. » Elle-même s’est inventé un fils, Looka, 4 ans, « très de droite » qui lui explique comment faire fortune au mépris des acquis sociaux. Certains posts de Looka ont fait des scores bien supérieurs aux siens. « Des personnes m’ont écrit en privé pour me féliciter d’avoir un fils aussi intelligent », me rapporte-t-elle en riant. Ça montre bien que le niveau général est tel qu’il est devenu très difficile à parodier ».
« Il y a toute une frange de LinkedIn qui ne supporte pas ce qu’il s’y passe et qui ne se prive pas pour s’en moquer sur des groupes privés » abonde Yann Leonardi, consultant en marketing et auteur d’une vidéo culte intitulée « LinkedIn : l’armée du cringe », disponible sur Youtube. C’est le cas du groupe Facebook « Neurchi de LinkedIn » qui compile le meilleur du pire de LinkedIn (85 000 membres) ou du compte Twitter « Disruptive Humans of LinkedIn » (100 000 abonnés). L’esprit « neurchi », chineur en verlan, se traduit par « une bonne dose d’absurde et de second degré » m’explique Bruno Gelsomino, son administrateur.
Les publications épinglées par les neurchis usent toujours des mêmes ressorts : « On parle de son gamin, de sa femme, ou de sa morning routine avec une petite morale à la fin. LinkedIn, c’est le royaume du premier degré » égrène Dan Geiselhart, le cofondateur du média Tech Trash qui s’est donné pour mission de « gratter le vernis de la start-up nation ».
Mais si ces nouveaux modes de narration nous paraissent étranges, au fond, ils ne le sont pas tant que ça. « Ils font partie d’un micro-genre avec ses codes propres, au même titre qu’un CV ou qu’une oraison funèbre » révèle la linguiste Victoria Weidemann. C’est plutôt leur « surformatage » qui va créer le sentiment de bizarrerie. D’après elle, cette surenchère trouve son explication dans le fonctionnement même de l’algorithme de LinkedIn : « Les gens se mettent une pression énorme pour capter l’audience la plus large possible en employant des techniques de langage extrêmes afin de générer de la réaction, et donc de la dopamine. » « Comme toutes les applications de la Silicon Valley, LinkedIn a intérêt à faire passer ses membres de spectateurs à créateurs, parce que c’est là que l’engagement émotionnel est le plus fort », réagit Yann Leonardi. C’est pourquoi la plateforme entretient à dessein le flou sur les performances réelles des publications en ne mettant en avant que leur nombre d’impressions, c’est-à-dire le nombre de fois où un post a été affiché sur le fil d’actualité, et non le nombre de vues effectif, forcément bien moindre.
Quitte à bousiller notre santé mentale. Actuellement, les témoignages évoquant des burn-out liés à une surutilisation de LinkedIn sont légion. Alexis Makounga, coach et influenceur de 29 ans, prévient : « LinkedIn, c’est un travail en soi. » Pour lui, au travail effectif (architecte, pigiste, apiculteur, médecin légiste…) s’additionne désormais un autre, celui de la promotion de ce travail sur LinkedIn, et éventuellement un troisième, celui du calcul du retour sur investissement de ce dernier. Un engrenage qui n’est pas sans évoquer le paradoxe soulevé par Hannah Arendt dès 1964 lors de la première conférence annuelle sur la Révolution cyberculturelle qui s’est tenue à New York. La philosophe y soutenait déjà que l’essor des machines intelligentes avait induit une réévaluation de la place du travail dans nos vies et que, si « les activités d’œuvre et de travail » étaient « plus faciles à mener », les individus y passaient « toujours autant de temps et même plus ».
Quand il sent qu’il perd pied, Alexis a le réflexe de couper LinkedIn pour deux semaines. Récemment, il a décidé de prendre un psy pour l’aider à gérer son addiction. Moi-même après deux mois à publier sur LinkedIn dans l’espoir de me faire embaucher, j’ai la nausée. Ça y est, je crois que je suis atteinte de LinkedIn fatigue. Mathieu Pimort, 24 ans et fondateur de Linker, agence experte en stratégie sur LinkedIn, avance : « Ce n’est peut-être tout simplement pas ton canal d’expression. Écrire en 3 000 signes, c’est peut-être trop peu pour toi. » On va dire qu’il a raison.