Le gars qui allait quelque part est le premier roman de Michel Bezbakh. Journaliste pour Télérama, il souhaite ici s’affranchir de l’écriture journalistique en livrant un texte qui incite à repenser l’oralité. Pour Bezbakh, notre façon de parler est constitutif de la manière dont nous percevons les autres. C’est cette thèse qu’il essaye d’illustrer à travers le personnage principal de son roman : un père de famille à la fois détestable et désespérant dont on suit le flux de conscience tout au long d’un périple en voiture, à la destination inconnue.
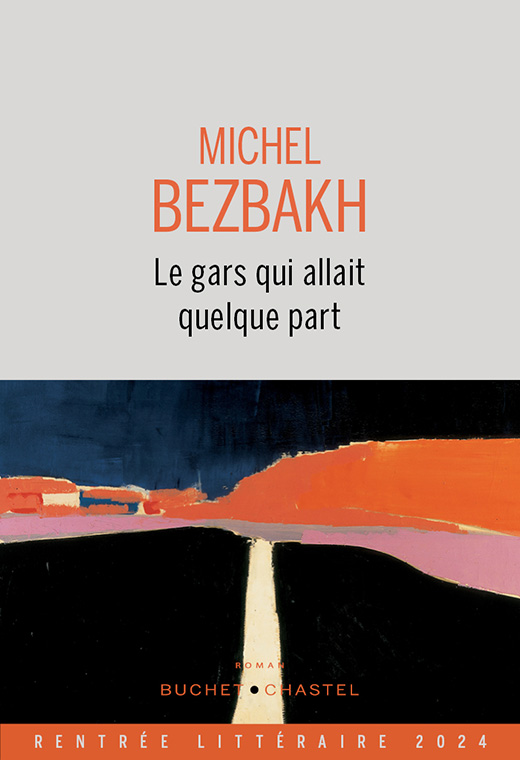
Commençons par le commencement : le personnage principal de ce récit est absolument détestable. Un homme d’une quarantaine d’années qui n’hésite pas à dénigrer son fils tout au long de sa vie. Les causes ? Son fils préfère Cendrillon à Mowgli, craint les lions, ou préfère davantage les hommes aux femmes. Ce fils est constamment humilié par son père. Son nom ne sera par ailleurs cité qu’à la fin du roman : « le gamin redevenait ce qu’il était, un sale gosse qui me faisait chier ».
Retrouve-t-on ici la dimension patriarcale de notre société ? Dans ce récit, le père cherche en effet à modeler l’avenir de son fils. Face à son échec, la violence prend finalement le dessus. Le langage est cru, violent, assommant : « […] je sentais en moi le monstre qui grandissait, il s’allongeait le monstre, il prenait toute la place dans mon corps, j’étais entièrement remplacé par ce monstre jusqu’au bout des doigts, moi j’étais plus là, le gars qui s’était contenu toutes ces années il avait disparu, le gars qui avait d’abord fait quelques petits efforts, qui avait vu que ça servait à rien mais qui l’avait fermée pour le bien de sa famille, pour le bien de Clara, ce mec-là il était à terre, renversé par l’autre, celui qui voulait aplatir le gamin, creuser un trou et le foutre dedans, faire disparaître ce petit enculé qui osait me mépriser, car ce gros pédé il me méprisait de plus en plus ».
https://zone-critique.com/critiques/nicolas-chemla-entretien-amsterdam
A contre-courant
Le gars qui allait quelque part est finalement l’histoire intime d’un père et de son fils. Alors qu’on s’attend à découvrir le point de vue d’un fils humilié, nous avons ici accès à celui du père tortionnaire. On se retrouve donc à contre-courant du récit classique, puisqu’on s’imprègne de la vision du « méchant » de l’histoire. Comme l’a évoqué Michel Bezbakh dans un entretien : « La littérature permet de mettre en relations diverses subjectivités afin de permettre une certaine progression dans le monde. »
Ce père cache son fils tel un monstre, et envie la « normalité » des enfants de ses amis : « Il repense au gamin. Ça s’est pas super bien passé avec lui, dès le départ c’était bancal. Il était tout petit, il avait peur des lions, il préférait Cendrillon à Mowgli, il n’a jamais été normal. […] le voir s’efféminer de plus en plus c’était une torture, une torture bien lente, bien progressive, mais voilà c’était une torture de tous les jours, on s’y habitue, quand on a mal tous les jours on se rend plus trop compte qu’on a mal. »
Y a-t-il une leçon à tirer ?
Tout au long du récit, on espère une évolution du personnage. Cependant, plus on suit le fil de sa pensée, plus on découvre qu’il est probablement irrécupérable. Il est égoïste, n’a espéré et demandé le départ de son fils à sa majorité que pour pouvoir retrouver le bonheur conjugal avec sa compagne, Clara : « La veille du jour J j’étais un peu tendu j’avoue, mélange de stress et d’excitation, je sentais la libération juste là, imminente, j’allais enfin être débarrassé de ce putain de poids qui m’accablait depuis dix-huit ans. »
Tout au long du récit, on espère une évolution du personnage. Cependant, plus on suit le fil de sa pensée, plus on découvre qu’il est probablement irrécupérable.
La raison de tout ce « malheur » semble être ce fils, qui ne correspond pas au schéma sociétal classique : « c’est surtout devenu l’enfer sur terre à la maison. Parce que maintenant c’était sûr, y avait un gros pédé sous mon toit. » Suite à un ultimatum posé par sa compagne, il tente toutefois de se remettre en question : « Et puis après, avec le recul… je suis devenu un peu moins con peut-être… on devient moins con en vieillissant des fois… et je me suis fait la réflexion que quand même, j’étais peut-être un peu fautif. » Est-ce son incapacité à exprimer ses émotions qui empêche ce père de comprendre son fils ? Michel Bezbakh fait exister un homme empreint de croyances fondées sur des a priori futiles. Parviendra-t-il à évoluer loin de ses carcans homophobes et ainsi développer une ouverture d’esprit ? C’est ce que le lecteur lui souhaitera certainement. À priori, on pourrait donc résumer ce livre par ce très sage adage : ne jugez pas celles et ceux qui ne correspondent pas à vos attentes personnelles, et surtout ne cherchez pas à les changer pour correspondre à un idéal.
C’est cette vision supposément utopique mise en avant par une partie de la société qui m’amène à évoquer la figure de Michel Bezbakh comme celle d’un nouvel « enfant terrible » du XXIe siècle. Tout comme Baudelaire, Rimbaud ou plus récemment Cocteau, cette œuvre que l’on peut considérer comme « insolente » permet à Bezbakh de dévoiler les failles de notre société.
- Le gars qui allait quelque part, Michel Bezbakh, Éditions Buchet/Chastel, 2024.
- Crédit photo : © Olivier Roller

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.