Qui ne s’est jamais assis à la terrasse d’un café et, en posant distraitement puis plus attentivement le regard sur les individus qui l’entourent, n’a essayé d’imaginer quelles seraient leur existence, leur profession, leurs amours, leurs souffrances ? Christine Montalbetti se fait maîtresse de cet art dans La Terrasse. Notre narrateur, dont nous ne savons rien si ce n’est qu’il est écrivain, se trouve attablé à la terrasse d’un hôtel portugais pour le petit-déjeuner. Balayant l’espace du regard, il se met à fantasmer, bercé par le principe du flux de conscience, la vie de cette jeune fille assise en face de son professeur, ou encore celle de ce couple marié dont la femme lui apparaît d’une beauté renversante, de ce jeune homme qu’il imagine poète, et de bien d’autres comme autant de personnages de romans qu’il pourrait écrire. Cette terrasse devient comme une interface entre le livre offert au lecteur et l’imaginaire même de l’écrivain.
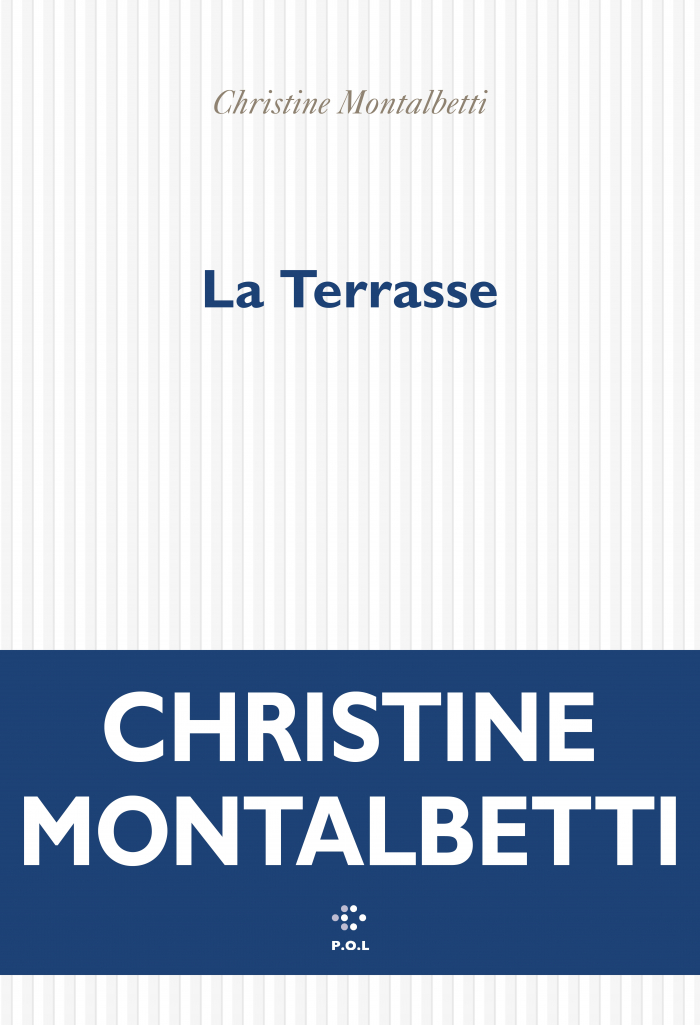
« Ce hors-champ, loin de mon regard, là-bas, chez eux. J’ai pensé au mot intimité. »
En imaginant ce que pourraient être ces inconnus au quotidien, le narrateur pénètre dans une forme d’intimité qui leur est propre, bien que cette dernière ne puisse être que fantasmée puisqu’il ne sait rien d’eux. Chaque personnage se retrouve enfermé dans une sorte de bulle l’isolant des autres, possédant une individualité et des potentialités qui lui sont propres. Alors qu’il extrapole, le narrateur réalise parfois qu’il se trompe et bifurque alors vers une tout autre histoire. C’est aux méninges de l’auteur, aux mécanismes de son imaginaire que donne accès Christine Montalbetti à travers la retranscription de ce processus de création prenant la forme d’un roman. Ces personnages fantasmés, ces êtres de papier que sont devenus ces individus de chair et d’os deviennent plus réels que leurs modèles pour le narrateur ; pourtant, l’écrivain est tenté d’interférer dans cet équilibre ainsi créé en s’éprenant de l’un de ses personnages, la femme mariée, Gloria.
Mais cette femme aux yeux azur n’est qu’un mirage, fruit de l’imagination de son créateur qui ne connaît de son modèle que le regard, le prénom saisi au vol et l’alliance à l’annulaire gauche. Il en est de même pour chacune des créatures romanesques dont l’intimité n’aura jamais aucune incidence sur celle de l’être qui leur a servi de calque. C’est ici un questionnement propre aux écrivains que soulève l’autrice : qu’advient-il de ces êtres créés de toutes pièces lorsque le point final est apposé, lorsque le roman est refermé par le lecteur, ou parfois même lorsqu’on n’écrit pas encore leur histoire ? Cette incursion dans l’imaginaire de l’auteur amène également à redéfinir le pacte de fiction scellé implicitement avec le lecteur au seuil de toute œuvre romanesque.
Cette incursion dans l’imaginaire de l’auteur amène également à redéfinir le pacte de fiction scellé implicitement avec le lecteur au seuil de toute œuvre romanesque.
Le pacte de fiction, jeux métatextuels
« Le mouvement de l’imagination pourtant, […] c’est le cœur même du plaisir. Celui du romancier ou de la romancière, mais aussi celui des lecteurs et des lectrices. »
Accord tacite passé entre l’écrivain et son lecteur, le pacte de fiction ou pacte de lecture demande au destinataire du texte d’accepter de tenir pour vrai ce qu’il lira, même s’il sait que ce qui est narré n’est que fictif. Partant de ce principe, le lecteur peut s’immerger dans le texte et ainsi l’apprécier dans toute sa dimension. Soumis à rude épreuve dans La Terrasse, le pacte est éprouvé en ce qu’il se tisse puis se rétracte au gré des pérégrinations mentales du narrateur. Le lecteur sait ce qui se joue et ne peut adhérer au contrat qu’on ne lui soumet d’ailleurs aucunement. Il faut toutefois garder à l’esprit que ce narrateur masculin n’est pas l’auteur du roman. En instillant le doute chez son lecteur, Christine Montalbetti scelle néanmoins son pacte en moins de temps qu’il n’en faut pour le réaliser. S’instaure alors un jeu de jonglage entre l’autrice, son narrateur et son lecteur. Ce dernier comprend qu’il a affaire à une sorte de fabrique de la fiction, il a accès à toutes les étapes de conception mentale des romans de cet écrivain qu’est le narrateur, dont l’identité semble volontairement obscure car il pourrait finalement s’agir de n’importe quel auteur.
/https://zone-critique.com/critiques/plus-rien-que-les-vagues-et-le-vent/
La Terrasse propose une réflexion métatextuelle, c’est-à-dire que le texte pousse à s’interroger sur lui-même, mais aussi sur le genre dans son intégralité. Le roman semble dépourvu de schéma narratif, on y suit le flux de pensées d’un personnage-narrateur dont l’identité n’est pas importante, de la même façon que les personnages qui le peuplent pourraient très bien se voir substitués par d’autres. L’intérêt de La Terrasse réside dans ce double pacte : celui, honoré, de l’autrice, et celui, d’emblée rompu, de l’écrivain-narrateur. Ensemble, ils lèvent le voile sur la genèse de toute fiction, sur ces liens qui se nouent, se brisent ou s’entrecroisent dans l’esprit de l’auteur, qui donne vie à des créatures qu’il choisit de continuer à faire exister, ou non.
La maïeutique de la fiction est donc un acte périlleux : la création de personnages authentiques, dont il faut prendre garde à ne pas s’éprendre, demeure complexe, tandis que l’auteur doit aussi veiller à honorer son engagement vis-à-vis du lecteur. Le « mouvement de l’imagination » de l’écrivain est rarement perceptible à la lecture d’une œuvre de fiction, par souci, justement, d’adhésion du lecteur. Pourtant, c’est précisément ce que Christine Montalbetti s’attache à montrer dans La Terrasse, bousculant au passage les codes du genre en donnant accès à ces mécanismes habituellement hors-de-portée.
- Christine Montalbetti, La Terrasse, P.O.L., 2024

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.