Le Chœur des lions, recueil du traducteur et écrivain hongrois György Dragomán, explore dans ses nouvelles les facettes de cet art mystérieux qu’est la musique ; plus encore, il nous apprend à regarder le monde et à entendre sa musique à la manière des enfants.
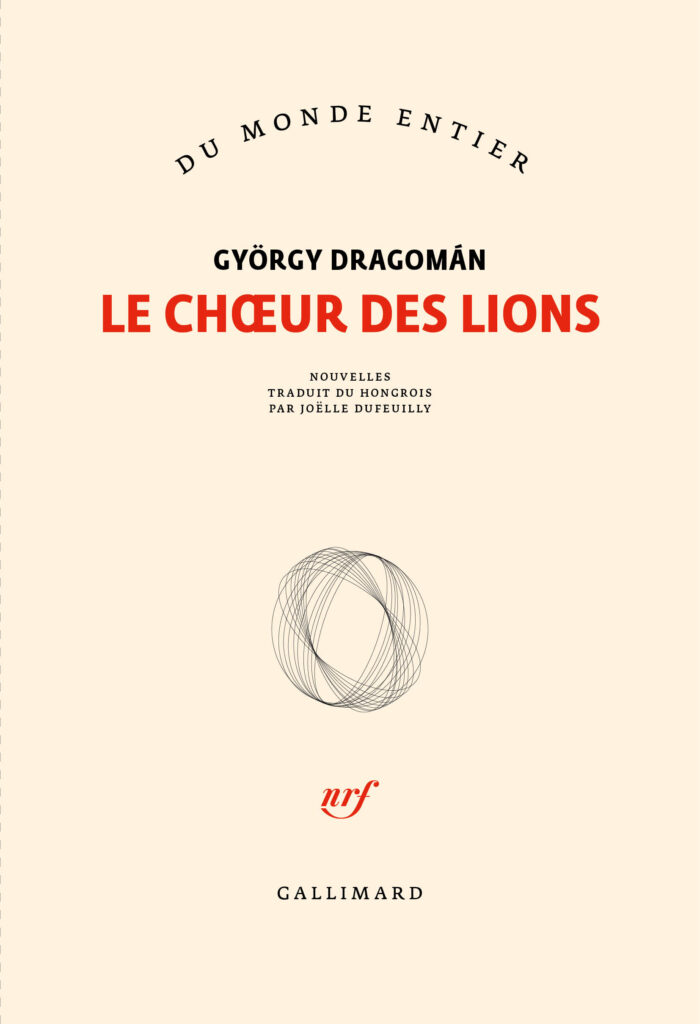
Ce livre est tout d’abord – et ce n’est pas rien – l’occasion pour le lecteur français de se confronter à deux angles morts fréquents chez lui : la littérature hongroise et la nouvelle. Avec en prime une traduction de Joëlle Dufeuilly, à laquelle nous devons déjà celle, splendide, des romans du géant hongrois László Krasznahorkai.
https://zone-critique.com/critiques/laszlo-krasznahorkai-rendre-son-billet-a-dieu/
Un recueil animé par l’enfance
Comme l’indique le quatrième de couverture et le laisse deviner le titre, Le Chœur des lions a pour leitmotiv la musique. C’est celle d’une chanteuse de renommée mondiale, ou celle de danseurs de rue madrilènes, celle de l’entraînement sans relâche comme celle de l’évasion nostalgique ; mais surtout celle qui naît des rêves d’enfants, et les nourrit. Car le vrai sujet de ce recueil n’est pas tant la musique que l’enfance ; et il est tout sauf innocent que l’auteur l’ait dédié à ses fils.
Le Chœur des lions a pour leitmotiv la musique
Certes, le mystère de la musique, et plus largement celui de l’art, est exploré ; en particulier, cette capacité qu’ils ont de faire ressentir ce que l’on n’a pas vécu, à l’auditoire mais aussi à l’interprète, comme le dit la chanteuse dans la nouvelle « Cry Me a River » : « J’ai commencé à chanter Cry Me a River, je n’avais jamais été vraiment amoureuse, personne ne m’avait jamais quittée, je n’avais jamais quitté personne, mais la déception était là, dans ma voix, douloureuse et désespérée, ma voix qui disait que tout était fini, que tout était vide, que tout était perdu, personne ne m’avait jamais brisé le cœur, je n’avais jamais brisé aucun cœur, et pourtant la douleur était là, dans ma voix, elle disait que je me résignais à cette douleur, et aussi que je pardonnais, et que je ne pardonnerais jamais, elle disait tout, ma voix. » Et, à l’issue de cette représentation, György Dragomán décrit la sensation de la chanteuse comblée – mettant ainsi le doigt sur ce que peut ressentir l’artiste qui a l’intuition d’être (enfin) parvenu à ce qu’il recherchait – comme un « soulagement pesant ».
Les phrases de l’auteur sont étendues, nerveuses, rythmées, tournant autour du réel en ondoyant comme un félin dans les broussailles, essaimant alentour avant de se resserrer telle la meute encerclant sa proie. Mais cette description collée au monde est parsemée de touches saisissantes de réalisme magique ; ou, plutôt, l’univers de nombre des nouvelles est structuré par une capacité sous-jacente de la réalité à s’augmenter — à mi-chemin de l’Écume des jours et du conte de fées. C’est par cette texture donnée à la réalité que l’auteur parvient souvent à nous faire saisir cette façon si particulière qu’ont les enfants de voir le monde.
Ainsi le recueil s’ouvre et se ferme par deux nouvelles évoquant le violoniste à « l’archet de fer » qui cherche un apprenti à sa mesure et qui, quand il l’a trouvé, le séquestre pour l’entraîner : lorsqu’il veut offrir à ce dernier une chance de s’échapper, il lui propose une partie de cache-cache. Dans une autre nouvelle, le grand-père du narrateur, pour l’emmener à la pêche, l’entraîne dans la salle de bains, ouvre tous les robinets, et inonde la pièce : « La baignoire est maintenant remplie, l’eau commence à déborder, grand-père m’explique qu’il avait à peu près mon âge quand il est monté pour la première fois sur un bateau, et que tout va se passer comme à l’époque, ils avaient vogué sur les eaux du Danube, jusqu’à la mer Noire, on va partir très vite, il faut juste attendre que l’eau soit assez profonde. […] Je sais ce qu’il faut faire, nous devons attendre que l’eau atteigne le plafond et remplisse toute la salle de bains, comme si c’était un grand aquarium, et à ce moment-là, on ouvrira la bouche et on soufflera pour former une bulle géante, une bulle si grosse qu’elle englobera le fauteuil, sous l’effet du souffle la fenêtre volera en éclats et, en se déversant, l’eau nous propulsera comme un raz de marée, nous et notre bulle géante, et nous fera voler jusqu’au Danube, là, nous hisserons sur le fauteuil la voile que grand-père a bricolée à partir de vieux pantalons, le Danube et le vent nous emporteront, nous naviguerons au milieu des poissons aux écailles argentées, nous traverserons les frontières, franchirons les Portes de Fer et le delta, et enfin ce sera la mer. »
Le recueil compte nombre de réflexions, de regards, de traits d’esprit enfantins. Dans une nouvelle se situant dans la Roumanie communiste, le narrateur se voit demander ce qu’il préfère chez cette idole soviétique que fut le cosmonaute Youri Gagarine : « J’ai répondu que ce que j’aimais le plus chez lui, c’était son casque, le fait qu’il soit rond et qu’on puisse quand même voir à travers. » Dans un autre texte, le narrateur — encore un enfant — fabrique « un périscope avec des rouleaux de papier toilette et deux miroirs grossissants pour le rasage » afin d’apercevoir l’ange qui lui apportera ses cadeaux de Noël. Et l’une des nouvelles porte le nom de ce jeu que, visiblement, les parents du monde entier, ou du moins de l’Europe entière, imposent à leurs enfants, de ce faux jeu qui est une vraie torture et désigne en même temps un monstre inquiétant : « Le Roi du silence ».
Écrire pour voir comme un enfant
Davantage que la musique, c’est un regard attendri porté sur les enfants, et plus encore un regard emprunté aux enfants qui fonde la cohérence du recueil. C’est d’ailleurs un enfant qui, dans « Cry Me a River » — sans doute la plus belle nouvelle du livre —, démasque la vérité, et montre que le sens de l’ouvrage n’est pas vraiment de cerner la nature profonde de la musique, que Proust considérait comme la langue des anges, mais plutôt d’adopter le point de vue de ces autres anges que, par leur totale ingénuité, sont les enfants.
Davantage que la musique, c’est un regard attendri porté sur les enfants, et plus encore un regard emprunté aux enfants qui fonde la cohérence du recueil
La narratrice de cette nouvelle est une grande chanteuse, qui a élevé seule son fils unique ; âgé de cinq ans, celui-ci lui demande : « Maman, pourquoi est-ce que mon père à moi, c’est la musique ? » La narratrice fond alors en larmes, naturellement bouleversée par une de ces remarques cruelles et lucides qui, tout autant que leurs jeux et leur curiosité, caractérisent les enfants.
Peut-être René Char pensait-il aux enfants en écrivant que « la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil » ; et peut-être György Dragomán veut-il nous signifier qu’écrire, c’est réapprendre à voir comme un enfant — c’est-à-dire crûment et poétiquement à la fois.
- György Dragomán, Le Chœur des lions, Gallimard, Paris, 2024 (trad. Joëlle Duffeuilly).

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.