Avec Évocation d’un mémorial à Venise, Khalid Lyamlahy signe un deuxième roman ambitieux et poignant, qui invite le lecteur à naviguer à contre-courant dans le Grand Canal vénitien, vers l’histoire oubliée d’un nom, pris au piège entre des pages de journaux et un monde qui vogue bien loin de son drame. Le suicide du Gambien Pateh Sabally à Venise, le 22 janvier 2017, a choqué l’Italie en premier lieu, mais le monde entier également. Devant une foule d’une centaine de touristes, le jeune migrant se jette dans le Grand Canal et se noie, sans que personne n’intervienne avant un long moment, ponctué de rires et d’insultes. Les secours sont appelés bien trop tard pour éviter la mort à Pateh, mort dont le roman de Lyamlahy s’efforce d’exhiber l’inadmissible et l’insupportable, tout en esquissant un portrait pudique et délicat du jeune homme gambien. C’est ainsi que l’écriture, tandis qu’elle dessine les contours d’une existence brisée, défait le double standard du symbole et de l’anonyme, pour rendre à l’homme la dignité que lui a arrachée une société placée sous le signe de l’éphémère, de l’obscurantisme, et de l’incrédulité iconodule des prisonniers d’une caverne bien trop contemporaine…
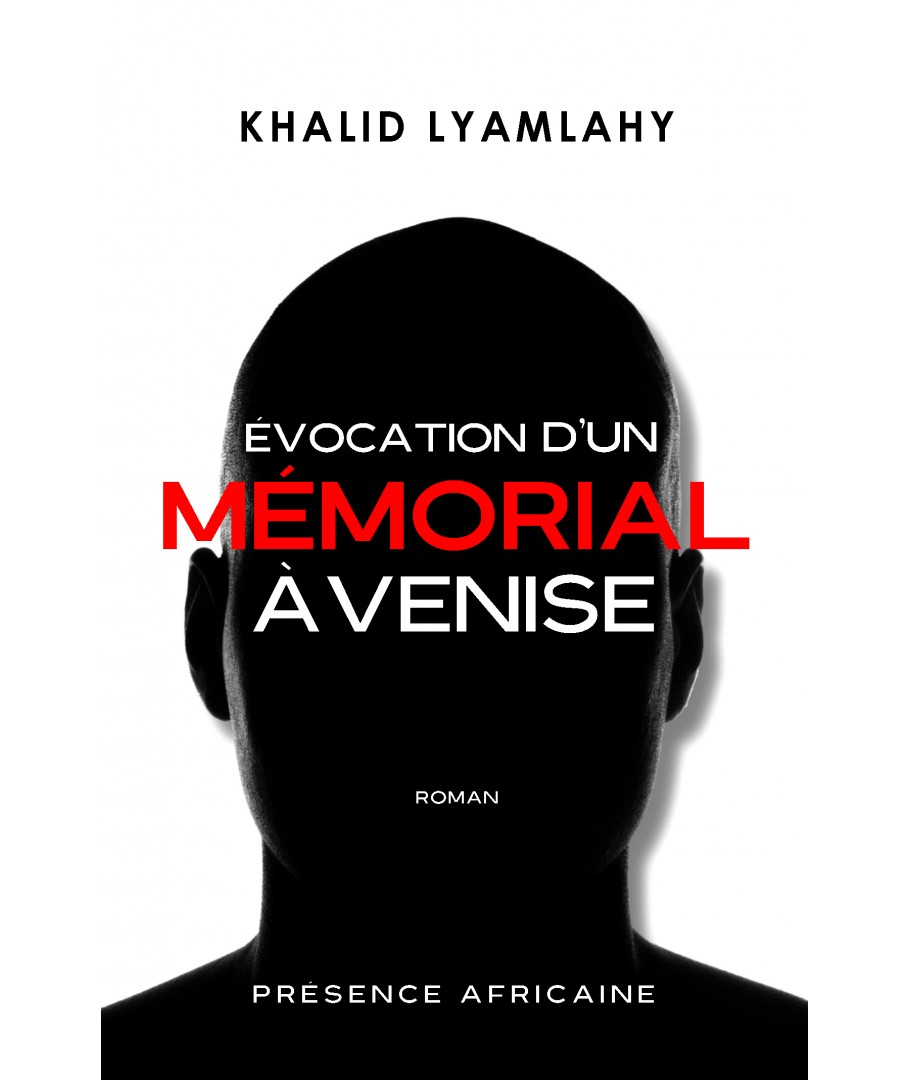
Une « tragédie » relayée à l’international, brandie en symbole de la lutte antiraciste et du drame des migrants réfugiés, souvent livrés à eux-mêmes, à la recherche d’une voie plus clémente pour accéder au droit d’exister libres et souverains de leurs lendemains. Voilà, en l’an 2017, ce que fut pour le monde la mort de Pateh Sabally ; mais de cet élan d’indignation qui enflamma une poignée de mois, il ne reste guère traces ; sauf, peut-être, l’aveugle souvenir d’anonymes 22 ans sacrifiés sur l’autel de l’indifférence et de l’oubli. Il n’est pas suffisant de déplorer l’exceptionnel lorsqu’il survient ; au contraire, il convient davantage de se demander : « est-ce vraiment une exception ? ». En replaçant l’histoire individuée de Pateh Sabally au cœur de l’histoire diachronique mondiale de l’immigration et du racisme, Lyamlahy inquiète la légèreté de nos vies, qui glissent innocemment au-dessus d’affres, âpres de vérité, au fond desquels se débattent et luttent des existences niées, que l’on n’ose plus compter ni nommer. Evocation d’un mémorial à Venise s’attaque au silence des hommes malgré le bavardage des journaux, aux représentations superficielles des territoires au détriment de la vie vraie sur le sol. Audacieux projet que d’exhiber, au sein de la fiction, le fictionnel au cœur du réel ; par un tour de force, l’auteur détruit le mythe qui permet à la société de tenir, une et sans fraction, pour bâtir sur ses ruines un tombeau de mots dont la poésie éveille l’occupant, et le fait danser devant nous. Car, pour conjurer les représentations erronées et lisses du monde, et lui rendre sa texture de réel, il faut bien consentir à s’engager avec Proust : « la vraie vie est dans la littérature ». Evocation d’un mémorial à Venise nous invite à réactualiser cette formule facile aux lèvres – mais rarement, cependant, osée au crayon.
« Le poids des mots, le choc des photos »
L’auteur détruit le mythe qui permet à la société de tenir, une et sans fraction, pour bâtir sur ses ruines un tombeau de mots dont la poésie éveille l’occupant, et le fait danser devant nous
Evocation d’un mémorial à Venise s’attaque d’emblée à des titans : la diffusion compulsive de l’information, l’indifférence paradoxale qu’elle déclenche face au racisme et, plus largement, aux dégâts causés par la boulimie picturale qui caractérise notre société. Témoin de l’iconodulie d’une époque, le narrateur, sous la plume de Lyamlahy, s’efforce de montrer que le culte de l’image mène, paradoxalement, à une banalisation de celle-ci ; les photographies et vidéos violentes se démultiplient, si bien que, tout se voulant symbole, rien ne l’est véritablement. Ce renversement paradoxal de l’effet de l’image, dès lors qu’elle se massifie sous l’essor du journalisme, est l’objet dès le XXe siècle d’essais et de réflexions philosophiques, quant aux conséquences de cette récupération par les médias de la possibilité de fournir au public des clichés instantanés de l’actualité, locale aussi bien que mondiale. Un bouleversement double s’opère avec la massification progressive de la photographie à usage informatif, à partir du XIXe siècle : d’une part, l’accès à l’objet représenté n’est plus médiat, mais direct, puisque l’objet est livré « tel qu’en lui-même » (en empruntant la fameuse périphrase mallarméenne du mot « mort », qui ouvre le magistral « tombeau pour Anatole » ; la mort étant selon Barthes (La Chambre claire) justement la conséquence de l’objectification du sujet de la photographie dans son acte de capture instantanée, qui avoue un « ça a été » – donc ce n’est plus), dans l’illusion d’être cueilli au cœur de l’instant. L’instant cependant n’est plus, et Barthes voit juste : les images sont déjà mortes, se conjuguent au passé, et l’actuel de la photographie n’est jamais qu’une relique du temps, qu’il est aisé d’oublier lorsqu’on la chasse de notre vue. D’autre part, l’accès à l’objet représenté est matériellement facilité par la reproductibilité de la photographie, que l’on peut diffuser très rapidement et à grande échelle, d’abord grâce à l’impression, puis davantage encore avec l’avènement de la numérisation. L’enthousiasme autour de cette libéralisation de l’information par l’image est tout entier contenu dans la célèbre formule héritée de Paris Match ; le mot pèse certes son poids ; mais la photo choque, elle s’impose au lecteur transfiguré en spectateur direct de la scène qu’on ne se contente plus de lui raconter, mais de lui offrir au coeur de son foyer, son salon, son intimité. Nous n’allons plus vers l’extérieur ; l’extérieur nous est livré sur un plateau d’argent. Les réflexions de Walter Benjamin concernant la reproductibilité des œuvres d’art et notamment de l’image imprimée excède le seul cadre esthétique ; et si ce que le philosophe nomme l’ « aura » de l’œuvre – c’est-à-dire, sa puissance d’évocation et la densité de sa texture – est considérablement amoindrie à mesure que sa diffusion se massifie, il en va de même concernant les photographies et les vidéos d’actualité.
Le narrateur de l’Évocation d’un mémorial à Venise recense ainsi, au fil des pages, les différents articles qui évoquent la mort de Pateh Sabally, et relaient la vidéo prise par un témoin de la scène. Le constat de l’indifférence paradoxale du monde malgré la diffusion compulsive de l’information est posé dès la première page du roman ; s’adressant directement au migrant, le narrateur déclare :
« Pour le moment, tu es un bandeau d’information qui défile en bas de l’écran. Une dépêche du Corriere della Sera, reprise par Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Ouest-France et tous les journaux de la place. Variations dérisoires sur le thème de ta disparition. »
L’instrumentalisation de la mort « insolite » et « originale » d’un migrant est vivement fustigée par le narrateur, qui refuse la facilité de parler de « tragédie ». Ce terme laisse entendre, tacitement, que le drame de Pateh Sabally constitue une exception, une curiosité dont on dénonce certes l’inadmissible dans une sensationnelle mise en scène, mais telle que le racisme et l’abandon des migrants à leur propre sort n’apparaissent jamais dans leur affreuse et quotidienne banalité. Le piège du symbole est rendu évident par le constat implacable du narrateur : le choc produit par la vidéo d’une noyade frappe la rétine du monde aussi rapidement qu’un éclair au cœur d’un vague orage dont ne demeure cependant que le sombre, et, en lui, le souvenir perdu d’un éclat qui n’est déjà plus. La presse, dans la sempiternelle tempête qui ballote les réfugiés et les précipite au fond de la Méditerranée – et, rarement, envole leurs destins vers de plus jolis horizons – se complaît à porter aux nues la foudre, à se faire caisse de résonance des coups de tonnerre, sans consentir à regarder les nuages noirs dont l’empire ne cesse de s’étendre. Voilà le processus vicieux du concept « d’actualité » auquel s’attaque notre auteur, concept qui dissimule paradoxalement l’actuel et pérenne état des choses. C’est ainsi qu’en nommant plusieurs autres migrants, le narrateur conjure la mémoire postiche des journaux par une constellation de destins pluriels et ignorés, qui gravitent autour de la figure mystérieuse de Pateh, dont personne ne sait rien, en réalité, malgré l’encre versée à son sujet et la capture de ses derniers moments. Le livre est une enquête, mais une enquête toute contraire à celles des médias. Il ne s’agit pas d’un documentaire, d’un reportage qui s’offre au lecteur ; c’est, bien davantage, un roman, une fiction dont la fin principale est de contraindre son lecteur à sortir de chez lui, guidé par le voyage du narrateur à Venise qui tente de « bâtir un pont de mots et d’images entre (la) perte [de Pateh Sabally] et le trop-plein d’information ». En empruntant ce pont qu’actualise la lecture, nous sommes ainsi conviés à éprouver activement l’espace vécu, plutôt qu’à le regarder passivement depuis notre canapé.
L’envers du décor : une poésie du territoire en mouvement
Ce faisant, Lyamlahy déploie une écriture novatrice, tant du point de vue descriptif que narratif. Les deux lieux évoqués dans le roman, l’Italie – Venise, plus particulièrement – et la Gambie – Banjul, notamment – sont opposés l’un à l’autre, dans une volonté d’inverser les représentations respectives de ces territoires. Volontiers provocateur, le narrateur, en arrivant à Venise, déchire le stéréotype romantisé d’une ville ensevelie sous d’innombrables clichés, à l’ère du tourisme de masse. La description morose des guides touristiques et des publicités aperçues à l’arrivée du Ferry à Venise participe de la démystification d’un lieu que tous croient connaître, et qui a été porté aux nues par toute une littérature occidentale. Le narrateur évoque ainsi à tour de rôle Thomas Mann, Philippe Sollers ou encore Michel Tournier, citant et recopiant mot pour mot dans son carnet de bord des descriptions de la ville qu’il investigue ; et bien souvent, la profondeur que ces écrivains accordent à la ville ne trouve aucun écho dans l’expérience du narrateur, qui apostrophe innocemment le lecteur :« Et si Venise était un décor en carton ? »
Le roman de Lyamlahy est particulièrement habile à rendre compte de la dégradation d’un lieu, dès lors qu’il est l’objet d’un fétichisme inconscient alimenté et bâti autour de représentations topiques
Le roman de Lyamlahy est particulièrement habile à rendre compte de la dégradation d’un lieu, dès lors qu’il est l’objet d’un fétichisme inconscient alimenté et bâti autour de représentations topiques ; l’unique cité lagunaire devient image d’Epinal, l’authenticité de son histoire plurielle et complexe s’effondre derrière l’idole que l’on a faite à son image. Aujourd’hui, Venise est une idole ; et le roman de Lyamlahy, le marteau qui fait éclater son sourire faux, la sérénité feinte qu’elle affecte. Le fameux verre vénitien, plus opaque qu’on ne le prétend, laisse apparaître la figure d’un homme de chair et d’os que le Grand Canal a tenté, fidèle à la tradition, de masquer. A cet endroit, on aurait pu imaginer que jaillisse également, sous le carton déchiré de la carte postale, une description de la ville qui unisse son histoire perdue, à l’histoire de Pateh Sabally, en déterritorialisant la Vénétie vers une pluralité, une richesse géographique et historique inconnue et véritablement étrangère. Le désir d’union dans la diversité que l’on devine sous la plume de Lyamlahy mènerait alors à une révélation non seulement des revers de l’histoire géographique et existentielle du jeune Gambien, mais également de ceux de la terre étrangère où il échoue, afin de rendre à celle-ci son étrangeté vraie, et, ce faisant, de construire une altérité spatiale de partage et de rencontre. Les descriptions déceptives de Venise sont entrecoupées, au sein du roman, par des descriptions de la Gambie bien plus agréables à l’imaginaire. L’itinéraire de Pateh Sabally n’est pas réduit à son point d’arrivée ; en effet, Evocation d’un mémorial à Venise se présente également comme un petit Cahier de retour au pays natal (Césaire est d’ailleurs cité à plusieurs reprise dans l’ouvrage) visant à rendre hommage aux lieux qui ont vu naître et vivre, effectivement et pleinement, l’homme noyé au fond d’une ville désincarnée et hostile, qui ne laisse plus de place à l’existence des hommes qui marchent, naviguent, et déambulent pour sauver leur vie. La mort du jeune Gambien, point d’ombre du roman que le narrateur s’acharne de tenter d’éclaircir, projette une paradoxale lumière sur l’histoire des vicissitudes nombreuses commises à l’encontre des peuples africains, et sur l’actuelle et insupportable condition des migrants, qui trouvent bien trop souvent la mort au fond de la Méditerranée pour que l’on se contente de traiter le suicide d’un réfugié comme une chose exceptionnelle.
Ce retour au pays natal s’accompagne d’un retour à la poésie au sein d’un récit attaché aux faits. Si les images, les représentations de Venise et de la mort de Pateh Sabally par la presse donnent dans le lieu commun, l’écrivain s’efforce de faire de la fiction le foyer d’une vérité niée par le réel admis de tous. Contre l’idée bien connue d’une description qui piétine sur place, et d’une narration qui court au-devant de l’action (que l’on doit à Gérard Genette, notamment), Evocation d’un mémorial à Venise exhibe au cœur même de sa trame le travail réflexif de l’écrivain, tant et si bien que « l’action », l’ « intrigue », semblent ne jamais avancer, et ressasser les mêmes idées, tandis que la plongée au cœur des territoires et de leurs descriptions entrecroisées permet a contrario d’approcher l’objet de la quête du narrateur : le souvenir de Pateh Sabally. C’est en toute authenticité que le narrateur évoque cette curiosité littéraire :« Cette écriture est condamnée au va-et-vient, à l’errance sans fin entre le fleuve du pays natal et les canaux du pays des autres. Ecriture de l’oscillation et du vertige. »
Évocation d’un mémorial à Venise, ainsi, entraîne le lecteur au cœur d’un récit au rythme déroutant, porté par le style poético-réflexif d’un narrateur qui exhibe l’histoire des territoires à peau retourné
En d’autres termes, la plume de Lyamlahy revient sans cesse sur elle-même, trace les contours d’une carte nouvelle, qui perturbe les frontières : la carte de l’être-au-monde d’un réfugié gambien. Il aurait été intéressant, à ce propos, de creuser davantage la question du rapport du « pays natal » à celui du « pays des autres », en convoquant l’histoire de la complexe intégration de la République de Venise au reste de l’Italie (unification que la Vénétie rechigne encore à consommer) ainsi que l’expérience violente du racisme français lors de la vague d’immigration des populations piémontaises et vénitiennes vers le Sud de la France à la fin du XIXe siècle (on se rappellera du massacre d’Aigues-Mortes, des Vêpres marseillaises, des pancartes « Interdit aux chiens et aux Italiens »…). La complexité du lien au « pays natal » n’est ainsi pas étrangère à la population italienne ; démasquer cette réalité historique pour la confronter à celle – certes radicalement différente et unique – des problématiques identitaires des migrants africains eut été un approfondissement intéressant de la question du sentiment d’appartenance à un sol, et un terreau fertile pour interroger le concept « d’autre ». D’autant que le style réflexif de l’auteur se prête particulièrement à ce genre de thématique ; en effet, la narration devient le lieu de la fabrique même du roman, de son élaboration, exhibée aux yeux du lecteur, qui erre sans ne jamais avoir l’impression d’avancer, à l’image de son guide, sinon lorsqu’il est précipité au cœur de la description mouvante du sol et des eaux. Et l’on est bien tenté, alors, de convoquer les derniers mots de Césaire couchés dans le Cahier :
« et le grand trou noir où je voulais me noyer l’autre lune
c’est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile verrition ! »
Néologisme créé par Césaire, la verrition est l’action de mâcher, remâcher, faire sans cesse tourner les mots dans sa bouche, avec sa langue ; c’est-à-dire de recourir à une pratique incantatoire du langage pour que naisse une poésie prompte à redonner vie à tout ce que l’on laisse sombrer dans « le grand trou noir » de notre mémoire. Immobile, le ressassement n’en est que plus intense, et son mouvement incessant creuse en vérité un chemin dans l’indifférence du réel, pour libérer, d’un coup de langue poétique et cathartique, les innombrables noyés du Léthé mondial. Ainsi, le piétinement ânnoné par le narrateur finit par se convertir en une incroyable fuite vers l’avant, qui va croissante à mesure que les trois sections du roman s’enchaînent, pour aboutir à une atmosphère proprement fantastique lors des dernières pages, sublimes et envoûtantes.
Évocation d’un mémorial à Venise, ainsi, entraîne le lecteur au cœur d’un récit au rythme déroutant, porté par le style poético-réflexif d’un narrateur qui exhibe l’histoire des territoires à peau retournée, et porte un coup violent au culte de l’image omniprésent dans les médias – dans les têtes, également. Une invitation à recouvrir la mémoire, la vue, en sortant de nos cavernes pour arpenter le sol et sa réalité mouvante, vivante, dans l’urgence de faire advenir un espace d’hospitalité et de partage au sein de la vérité rugueuse du monde.
- Khalid Lyamlahy, Évocation d’un mémorial à Venise, Présence Africaine, avril 2023

