Un an et demi après le succès international de Vivre nu, l’écrivaine et philosophe Margaux Cassan publie Ultra violet aux Éditions Grasset. Dans une œuvre hybride où l’essai se mêle au récit de soi, l’autrice propose une petite histoire du soleil, de la peau qui change de couleur et de notre amour – parfois périlleux – de la métamorphose. Entretien.
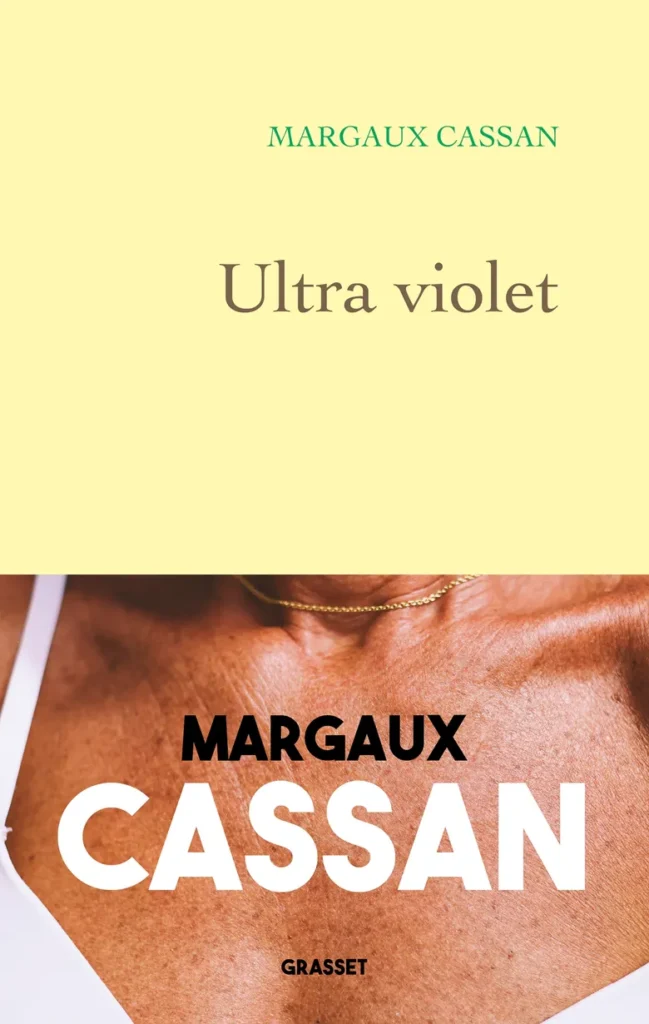
Deux ans après le succès de Vivre nu, où vous proposiez une exploration philosophique et littéraire du naturisme, vous publiez aujourd’hui Ultra violet, toujours aux éditions Grasset. D’abord, j’aurais aimé revenir avec vous sur la genèse de ce projet : qu’est-ce qui vous a menée de la nudité au soleil ?
Margaux Cassan : Je pars toujours d’une image. Cela faisait quelques années que je vivais avec l’image d’une tache sur le front de ma mère, une tache pourpre, un mélanome qu’elle cachait mal sous des mèches peroxydées. Même quand la peau est nue, elle est habillée, de tatouages, de cicatrices, de taches. J’ai voulu raconter ce que ces taches de soleil disent de cette génération qui a entre cinquante et quatre-vingts ans aujourd’hui. À mon sens, beaucoup de choses : un mépris pour la protection, un goût du risque et de l’exposition, une société dans laquelle le corps est la clef du pouvoir, et où la liberté est la valeur phare. Une société où l’on a le pouvoir de se transformer, de muter, socialement et physiquement.
En vous lisant, je me suis rendu compte que vos livres ne s’apparentaient que difficilement à un genre littéraire déterminé. Le lecteur est toujours en lisière, incertain de la nature de ce qu’il lit, passant d’une page à l’autre du romanesque à l’essai, du récit de soi à l’autofiction. Comment percevez-vous votre propre pratique littéraire ? Qu’est-ce qu’Ultra violet ?
Margaux Cassan : Je dirais que c’est un livre hybride au sens où comme la peau, d’ailleurs, il s’exprime en millefeuilles : l’épiderme, le derme, l’hypoderme qui sont ici l’essai, la fiction, l’enquête. Je crois beaucoup en ces formes errantes parce que si l’on écrit une philosophie du corps en écartant la fiction, on se prive du « je » qui seul peut raconter vraiment l’expérience de la brûlure, de la cabine à UV, et même de la filiation. On n’écrit pas le corps avec les mots de la bibliothèque. Et vice versa, la fiction seule, je ne saurais pas quoi en faire, j’ai envie d’aller chercher ce qui motive le personnage, dans la sociologie, dans l’Histoire, dans le patrimoine culturel qui le constitue. J’essaie de voir ce qui dans les anecdotes personnelles convoquent des mythes ou des utopies universelles, ou d’époque.
Dans ce nouveau livre, il y a deux personnages principaux, si je puis dire : le soleil et votre mère. Concernant le soleil, d’abord, vous présentez une classe bien précise de figures ayant choisi « de brunir leur peau pour parvenir », en précisant dès les premières pages l’ambition de votre travail : « Les Rastignac du soleil, dont l’ambition baignait dans l’huile, n’ont plus la cote. Ce livre raconte leur déclin. » Alors, qu’est-ce qu’un Rastignac du soleil ? Et qu’entendez-vous, lorsque vous parlez de leur déclin ?
Margaux Cassan : Les « Rastignac du soleil », ce sont des hommes et des femmes qui ont entre cinquante et quatre-vingt ans aujourd’hui. Ce sont des ambitieux qui sont allés chercher la réussite avec la peau. Ils sont bronzés parce qu’en étant bronzés, ils envoient le signal d’une appartenance sociale mais aussi d’un certain hédonisme, d’un état de santé, de leur propre victoire. On pense à quelqu’un comme Jacques Séguéla qui a revendiqué ce lien entre la peau mate et le succès, et même d’une certaine façon, Donald Trump. Aujourd’hui, la peau bronzée est au mieux kitsch, au pire dangereuse.
“Les « Rastignac du soleil », ce sont des hommes et des femmes qui ont entre cinquante et quatre-vingt ans aujourd’hui. Ce sont des ambitieux qui sont allés chercher la réussite avec la peau.”
Vous proposez au fil des pages, en parallèle du récit d’ascensions par le bronzage, une petite histoire du soleil, considérée par différentes époques soit comme un auxiliaire aux pouvoirs presque magiques, soit comme un ennemi dont il faut se garder. À votre sens, quel est le rapport symbolique et poétique de notre époque au soleil ?
Margaux Cassan : On est passés, en quarante ans, d’une société de vitesse, d’exposition et de consommation à une société de longévité, de protection. Pour le dire grossièrement, dans les années 1980, il fallait cramer. Il fallait cramer l’argent, les ressources, sa peau. Notre époque voit les conséquences de ce feu de camp collectif. Le soleil est devenu le symptôme de la canicule, du réchauffement climatique et de la maladie. On fait le lien entre les maladies de la peau et celles de la planète : la désertification, l’aridité. Notre rapport au soleil est devenu plus hostile, et aussi un peu schizophrénique, quand on voit ce que devient l’autoroute A7 le jour des vacances d’été.
L’autre personnage principal d’Ultra violet, c’est votre mère. Figure épicurienne ayant passé « sa vie à chasser les rayons », régénérée par le soleil qu’elle ne quitte pas des yeux, votre mère fait figure, dans votre livre, de véritable pierre angulaire. En quoi son rapport au bronzage et au soleil est-il si important pour comprendre l’époque à laquelle vous vous intéressez, et peut-être, plus profondément, pour comprendre votre propre rapport au corps et aux rayons ?
Margaux Cassan : On connaît quelqu’un en regardant comment il traite son corps. Je m’étonnais de voir qu’alors que ma mère a eu un cancer de la peau, elle continuait à s’exposer autant, en s’appliquant toutes sortes d’huiles bronzantes. Ma mère m’a permis de comprendre que la peau n’a rien, en soi, d’un motif esthétique. La peau est une conquête, une identité, une revanche. Bien sûr qu’on ne veut pas retrouver sa peau pâle, si sous la peau pâle, vous voyez tout ce que vous avez mis une vie à quitter. Aussi et surtout, parler de la filiation, pour moi, c’est forcément parler du soleil. Le soleil, c’est une protection, un cocon, une autorité dont l’abus est dangereux pour la santé. Comme la mère. Je blague, mais vous voyez l’idée.
“On est passés, en quarante ans, d’une société de vitesse, d’exposition et de consommation à une société de longévité, de protection.”
La peau est un élément essentiel du livre. On l’y trouve dans tous ses états : mordorée, malade, brunie, fripée, étincelante. Par suite, vous semblez prolonger une conception philosophique qui fait de la surface, du derme, le lieu de toutes les profondeurs. « Ce qu’il y a de plus profond chez l’homme, c’est la peau. », écrit par exemple Paul Valéry. Est-ce que vous partagez effectivement cette approche ? Qu’est-ce que notre peau dit de nous ?
Margaux Cassan : J’ai été très frappée pendant mes études de l’absence de philosophes qui prennent au sérieux les questions liées au corps. Je crois que l’observation de la peau dans une société répond plus efficacement que la métaphysique ou la philosophie morale à bien des questions existentielles. Prenez la question philosophique inaugurale : « Qu’est-ce que l’homme ? ». Maintenant, observez la façon dont des personnes blanches se rendent malades pour paraître noires, et l’inverse. Observez comment on se tatoue, on fait des squats, on se fait vomir, on se scarifie, on se met dans des cabines à bronzer. Observez comment on se maquille, on se crème, on fait du yoga du visage. Un philosophe comme Alexandre Lacroix observe de façon passionnante cette « profondeur épidermique ». Le superficiel est ailleurs.
Après Vivre nu et Ultra violet, où vous mèneront vos prochaines aventures littéraires ? À quoi doit-on s’attendre pour la suite ?
Margaux Cassan : Je poursuis mes recherches sur la peau. En ce moment, je m’intéresse aux stigmates, au corps martyr dans l’art et au gore dans le cinéma coréen. On verra !
- Ultra violet, Margaux Cassan, Éditions Grasset, octobre 2024.
- Crédit photo : ©Nicolas Krastev-Mckinnon.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.