Danse avec tes chaînes nous plonge au cœur d’un épisode historique méconnu « Enfants de la Creuse », ces jeunes déplacés de La Réunion vers la métropole pour repeupler des zones rurales. Loin de l’eldorado qu’ils espéraient, ils se retrouvent souvent exploités comme main d’œuvre gratuite et maltraités par leurs familles d’accueil. À travers les trajectoires de Marie-Thérèse et Joseph, l’auteure interroge les notions de déracinement, de mémoire et de reconstruction. L’œuvre dévoile, au fil des pages, les différentes strates du passé et du présent de ces enfants, désormais adultes, confrontés à une réalité où la violence et l’espoir se côtoient sans cesse.
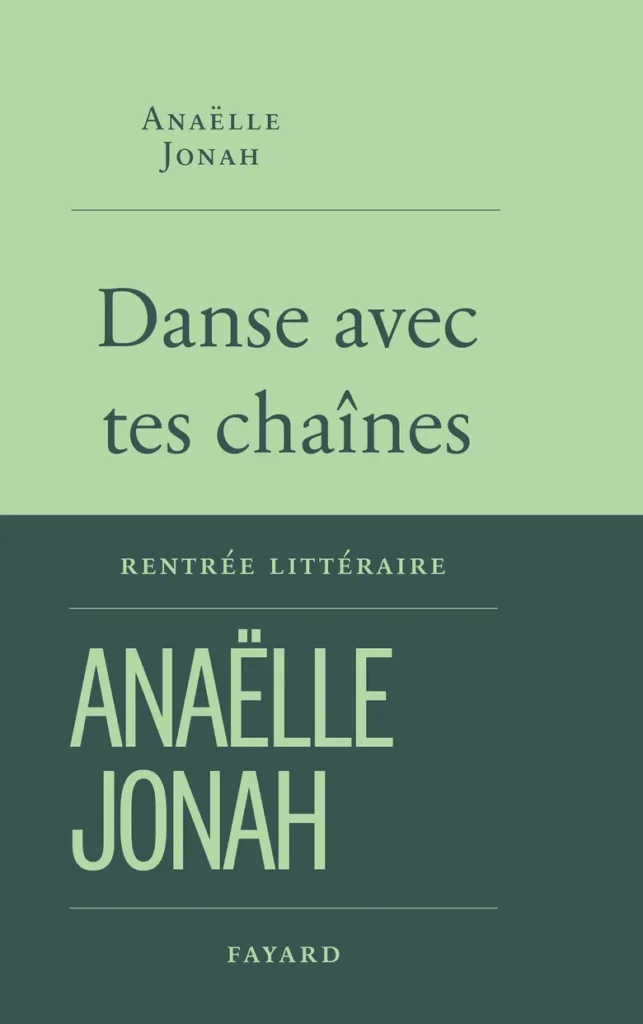
Le thème central de Danse avec tes chaînes repose sur le déracinement, cette séparation forcée avec la terre natale, mais aussi sur les promesses d’un avenir plus lumineux, qui s’avèrera être une illusion déchue. La narratrice montre, à travers sa propre histoire, que l’attente d’un avenir meilleur devient une échappatoire, une bouée de sauvetage dans un océan de souffrance : « Moi aussi, je désirais être pressée. Moi aussi j’espérais être attendue quelque part. Et je l’étais désormais: la métropole me tendait les bras, je n’avais plus qu’à faire mes valises et quitter l’île. »
Quitter La Réunion représente pour ces enfants la promesse d’un avenir meilleur. Lors d’un dernier échange avec Monmon, leur mère dont l’éloignement pèsera tout au long de l’ouvrage, cette question : « Michel, tu ne vas tout de même pas prendre ce ballon crevé avec toi ? ». Ce ballon crevé symbolise cette part de leur passé qui les lie encore à leur terre natale. La question du choix entre ce qu’on emporte et ce qui aurait dû être pris émerge ici comme un conflit intérieur permanent.
La fuite bercée d’illusions
Les enfants arrivent en métropole avec l’espoir d’une vie meilleure, mais ce « tragique optimisme » qui leur permet de tenir est rapidement déçu par la dureté de la réalité. Si Marie tente de rassurer son frère : « Regarde Joseph, c’est là qu’on va. Tu vas voir, ça va être génial. », cette promesse, à répétition, se transforme en déni de la réalité. Les enfants, pleins d’espoir et d’illusions, découvrent rapidement que la métropole n’est pas aussi reluisante qu’ils avaient imaginée. Leurs rêves se heurtent à une réalité crue, faite de pauvreté, de maltraitance et d’exploitation.
La force du lien filial qui unit Marie et Joseph est l’une des rares notes d’espoir de l’ouvrage mais également ce qui leur permet d’affronter cette dure réalité. S’ils seront l’un pour l’autre de vrais alliés, une question essentielle émerge : celle de l’abandon des proches. « J’en voulais à Dieu, et à ma mère. L’un n’allait pas sans l’autre, à mes yeux, ils symbolisaient la même chose : la défection parentale. » La narratrice se confronte à cette déchirure intérieure, ce sentiment d’abandon profond, qu’elle associe à la défaillance de ceux qui devaient la protéger. « Je souffrais de cet abandon du destin. » Ces paroles font écho à un autre moment clé du roman : « Les insultes paraissent toujours plus blessantes lorsqu’elles vous sont murmurées. » Cette souffrance liée à l’abandon est omniprésente, et l’alternance de narration entre Marie enfant et Marie mère souligne la douleur du lien avec la sienne trop vite brisé. Elle tente de réparer une relation qu’elle n’a jamais vraiment connue et qui, dans sa maturité, devient une quête identitaire.
“Danse avec tes chaînes propose une réflexion poignante, celle de la reconstruction possible, malgré tout.”
Le retour à la maison : soulagement ou nouvelle déception ?
L’idée du retour à la maison, ou plutôt la question du foyer, prend une dimension ambivalente dans ce récit. Le voyage de Marie adulte à La Réunion pose la question cruciale de la nécessité pour les déracinés de revenir sur les traces du passé pour avancer. Lorsque l’exil a été si difficile, comment savoir ce qui est plus douloureux dans un retour sur sa terre natale : De ne rien retrouver ou de tout retrouver comme avant ?
Si le retour ne permet ni d’oublier ni de réparer, s’il ravive les blessures du passé, il s’avère également porter une forme de consolation. Marie l’exprime: « J’éprouve un soulagement devant cette vue pourtant désolante. Car si maintes choses ont changé sur l’île, la pauvreté, elle, reste intemporelle. » Si la terre rêvée n’a pas été à la hauteur de ses promesses, ce retour est néanmoins la preuve que le départ était nécessaire.
Lorsque la narratrice décide de visiter la maison où elle a grandi, elle ressent « Une étrange sensation que de retrouver votre maison et constater avec quelle efficacité on a effacé votre présence. » C’est toute la violence d’un retour à la source qui s’exprime. La maison représente la terre natale, qui les a effacés de son histoire, a fermé les yeux sur ses enfants. Finalement, le seul réconfort du retour en Réunion pour Marie réside peut-être dans la certitude qu’elle ne présentait aucun avenir pour elle.
L’écriture comme seul exutoire
Dans ce récit, l’écriture apparaît comme une véritable issue de secours. L’auteur le souligne clairement : « Toute ma peine, je la déversais dans les mots. L’écriture s’imposait à moi comme une nécessité absolue, l’unique voie possible vers la reconstruction. » La douleur, transformée en mots, devient le seul moyen de se reconstruire, de se libérer un peu de ce fardeau « La rancœur est un manteau dont on ne se défait jamais tout à fait. J’ai essayé de le retirer mais ses manches me sont restées aux poignets, comme des menottes desquelles je ne pouvais me libérer. » L’écriture devient un processus cathartique, une tentative de se débarrasser de ce passé qui continue de peser sur les épaules des personnages.
Accepter ses chaînes pour avancer : de la réparation à la mémoire
Le livre interroge la question cruciale de l’acceptation du statut de victime dans le processus de réparation. Alors qu’un souvenir de la Réunion émerge une fois arrivée en France, Marie se met à penser : « Je me demandais si les araignées au plafond étaient les mêmes que celles de la Réunion, s’il était possible qu’elles soient venues jusqu’ici pour se venger. Et si comme René le répétait, je l’avais bien mérité. » En dépit d’une violence inouïe et objective dans leur famille d’accueil, l’absurdité de leur réalité empêche tout raisonnement lucide et place les enfants comme fatalement responsables de leur sort. Pour ces jeunes, le premier pas vers une reconstruction sera donc d’apprendre à accepter qu’il n’y avait aucune raison justifiant leur sort, qu’ils sont véritablement des victimes de l’Histoire.
Les enfants déplacés sont également confrontés à une lourde responsabilité : « Moi, je fis tout le contraire. Je n’oubliai pas. J’avais dépensé tant d’énergie, pendant ma jeunesse, à essayer de retrouver, puis effacer mon passé. Je passai le reste de ma vie à me souvenir, et je décrétai que la France entière en ferait tout autant. » Le devoir de mémoire, ici, devient une arme contre l’oubli et une façon de réparer une injustice. Les chaînes du passé, bien que toujours présentes, sont une partie intégrante de leur identité. En acceptant ce rôle de relais dans la transmission de leur histoire, les personnages trouvent la force de continuer. Pour les coupables, le temps passe sans être juge ni rétablir l’ordre, mais pour les victimes, il n’y a « d’autre choix que de leur faire face. »
Danse avec tes chaînes propose une réflexion poignante, celle de la reconstruction possible, malgré tout. La narration entre Marie enfant et Marie mère résonne profondément, comme un écho à un passé trop souvent effacé. L’écriture, comme seule issue, devient un exutoire, une manière de se débarrasser d’un poids qui ne pourra jamais totalement disparaître. Le roman nous montre que parfois, si les chaînes de peuvent être brisées, il faut pleinement les accepter pour apprendre à danser avec.
- Danse avec tes chaînes, Anaëlle Jonah, Éditions Fayard, août 2024.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.