Le 4 janvier 1960, il y a 61 ans jour pour jour, Albert Camus disparaissait dans un tragique accident de voiture. Afin de rendre hommage au grand homme, nous sommes allés lui rendre visite dans son cimetière de Lourmarin. L’auteur de L’étranger nous a très aimablement reçus. Entretien d’outre-tombe.
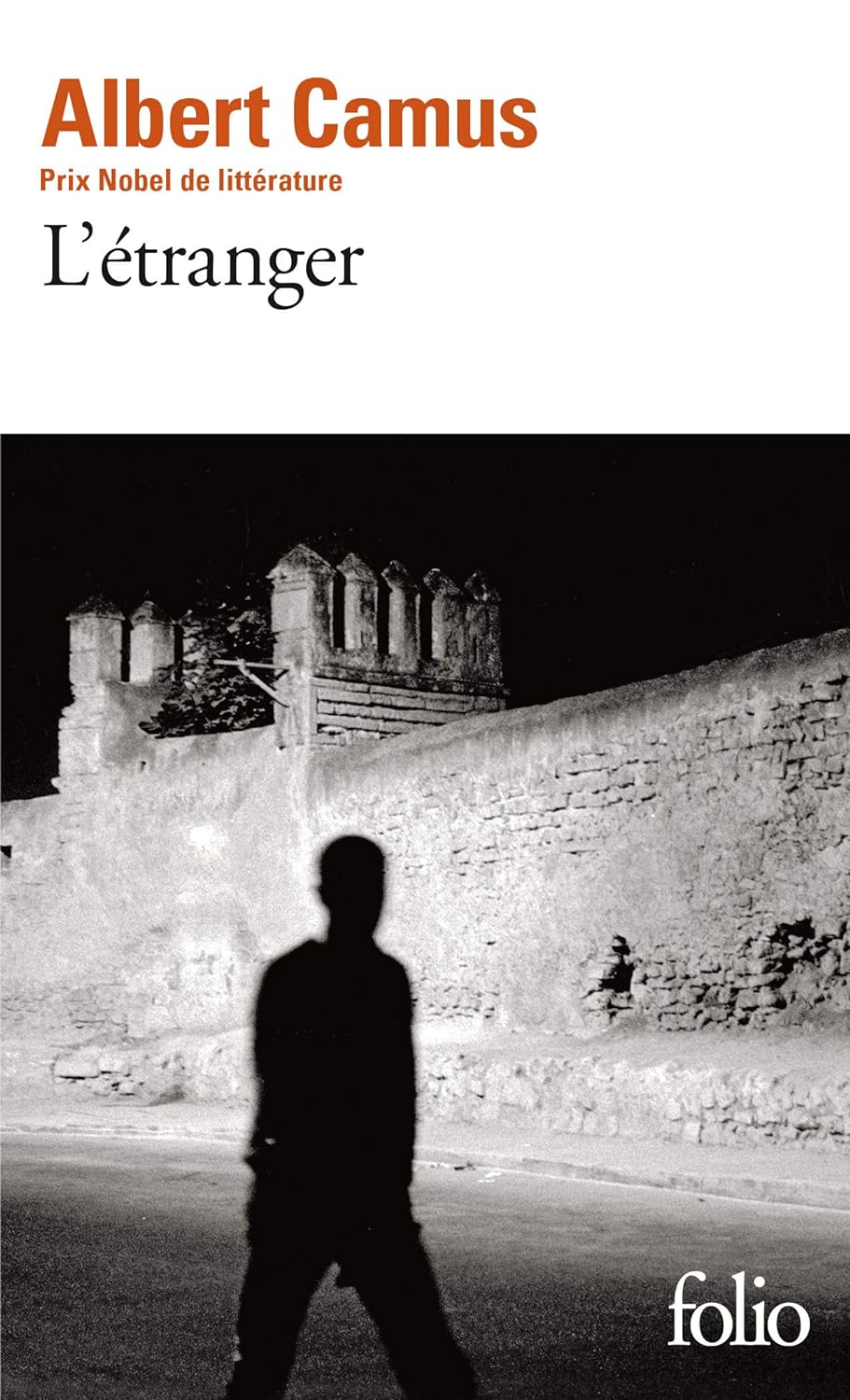
Albert Camus, nous sommes ici sur les terres de René Char, pouvez-vous nous raconter comment est née votre amitié?
C’est une grande question pour commencer. (sourire, ndlr) René Char m’a avoué que son premier contact avec moi se fit dans le maquis en lisant L’Étranger. Les conditions n’étaient, selon lui, pas réunies pour que la “rencontre” à proprement parler ait lieu, le livre ne l’ayant pas marqué outre mesure. C’est après la Seconde Guerre mondiale que nos pensées se sont croisées, lorsque j’ai voulu éditer – dans la collection Espoir de Gallimard – ses Feuillets d’Hypnos et qu’il m’écrivit une lettre touchante sur mon Caligula. À partir de ce moment, nous avons tâché de nous éloigner le moins possible l’un de l’autre, allant jusqu’à habiter dans le même immeuble. (le 4 rue de Chanaleilles à Paris, en 1954)
Que pouvez-vous nous dire sur le poète? Que vous inspire-t-il ?
Je pense que René Char est le plus grand événement de la poésie française depuis Rimbaud. Dans le XXème siècle, c’est le poète qui en France élève le plus haut son chant et qui communique la plus grande richesse humaine. Et quand on parle de poésie, on est près de l’amour, cette grande force que l’on ne peut remplacer par l’argent qui est vil, ni par cette malheureuse chose qu’on appelle la morale…(1)
(Il réfléchit) Et puis… nous partageons, il me semble, ce même sens de l’honneur, cette « dernière richesse du pauvre » comme je le fais dire à Kaliayev dans Les Justes.
C’est-à-dire?
Nous sommes des enfants de la Seconde Guerre Mondiale et des questions essentielles que ce drame a engendré: comment agir et réagir face à la violence? Comment vivre et reconstruire après son déchaînement? (…) Au temps du sabre, l’honneur était de se battre. Quel honneur y a-t-il maintenant à lancer ou recevoir des bombes? L’honneur dans le monde moderne est de se taire et de créer.(2)
Je pense que René Char est le plus grand événement de la poésie française depuis Rimbaud
Vous avez pourtant pris la tête de Combat. Être rédacteur en chef d’un journal, n’est ce pas justement porter sa voix et son opinion sur la place publique? N’est-ce pas parler pour créer peu?
Non je ne crois pas… Il ne faut pas oublier les conditions et les raisons de la création de Combat. La guerre a nécessité la création d’un tel journal et la reconstruction son développement. Combat était une entreprise exigeante.
Elle s’est néanmoins arrêtée en 1974. Pourquoi dès lors un tel échec ?
Combat a été un succès.
Mais vous l’avez quitté, d’autres l’ont dirigé et le journal s’est arrêté !
D’autres, oui, et c’est pourquoi il n’était plus Combat. Je parle de celui dont nous avons, à quelques uns, inventé la formule et à qui nous avons assuré près de 200 000 lecteurs (…) Nous avons fait, pendant deux ans, un journal d’une indépendance absolue et qui n’a jamais rien déshonoré.
Certains journalistes actuels prétendent que leur presse, au contraire de celle qui a suivi la Libération, est faite par de vrais professionnels.
Tant pis pour la profession. Au reste, nous étions – et je suis – journalistes professionnels. La profession de journaliste est une des plus belles que je connaisse, justement parce qu’elle vous force à vous juger vous-même.
Le mal ne vient-il pas de ce que les intellectuels cèdent la place aux fabricants ?
Le mal n’est pas que les intellectuels se refusent au journalisme. C’est qu’il s’y ruent et y écrivent n’importe quoi pour de l’argent ou, ce qui est moins pardonnable, pour la notoriété. Si les écrivains avaient la moindre estime pour leur métier, ils se refuseraient à écrire n’importe où. Mais il faut plaire, paraît-il, et pour plaire, se coucher. Parlons franc.(3)
N’est-ce pas finalement au théâtre que vous trouvez le meilleur moyen de vous exprimez, de faire passer vos idées et de dénoncer?
Si les écrivains avaient la moindre estime pour leur métier, ils se refuseraient à écrire n’importe où
Peut-être… Mais le cycle de l’absurde est composé d’un roman, d’un essai et d’une pièce de théâtre. Le théâtre permet de rendre les thèmes qui me sont chers plus sensibles au public. Il y a une impression plus forte marquée par l’effet visuel. Le théâtre oblige également à la concision. Le théâtre permet de s’adresser à un public plus large selon moi. Mais attention ! La vulgarisation n’est pas la vulgarité. On peut s’adresser à un large public sans cesser d’observer les règles du langage et en faisant même leur part au style et à l’originalité. Le grand public n’est pas méprisable au point qu’il faille lui dire sans cesse, comme aux mourants, que tout est pour le mieux. (4)
Comment considérez-vous les mises en scène contemporaines de vos pièces ?
Je ne peux qu’être fier de voir mes textes se jouer, évidemment. Mais je regrette parfois que la dimension politique de l’œuvre soit davantage mise en avant que celle évoquant la philosophie. Caligula n’est pas une pièce historique sur un empereur. On pourrait plutôt dire que c’est une pièce sur la logique de l’absurde poussée à son extrême limite. De même, une pièce comme Les Justes ne raconte pas l’histoire d’un groupuscule terroriste russe du début du siècle. Elle pose la question de l’engagement face à une situation qui nous révolte et de l’innocence de l’être dans cet engagement. Kaliayev n’est pas juste parce qu’il croit qu’il l’est, que sa cause l’est. Il l’est car il accepte de se sacrifier: « Mourir pour l’idée c’est la seule façon d’être à la hauteur de l’idée » comme il le dit lui-même. Dans ces situations politique et existentielle absurdes, Kaliayev redonne du sens à sa révolte et accepte d’en payer le prix fort.
Les Justes est une réponse aux Mains sales de Sartre, pourquoi avoir senti ce besoin de répondre ?
Sartre et moi avions des idées différentes sur la notion d’engagement. Les Mains sales peuvent se poser comme une interrogation sur la corruption de l’idéal au nom de l’engagement politique.

Mais les positions tenues dans la presse par Sartre à l’époque, et par la suite, me laissent perplexe. Penser qu’une action aveugle violente puisse se justifier m’est intolérable. Il me semble, pour ma part, que chez les hommes, c’est l’innocence qui doit provoquer la réflexion et l’action. Kaliayev refuse de faire un attentat parce qu’il y a des enfants. Il a aussi choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas, il a choisi d’être innocent. Derrière ce que Sartre défendait, je voyais un risque de despotisme qui, s’il s’installait jamais, ferait de gens comme Kaliayev des assassins alors que celui-ci essaie d’être un justicier.(5) Je ne me lasse pas de répéter cette phrase à propos des attentats du FLN en Algérie, aujourd’hui déformée: « Si c’est cela la justice, je préfère ma mère ».
L’opposition que l’on a pu développer entre vous et Sartre a-t-elle été une chance pour le débat philosophique de l’époque ou au contraire une caricature de vos deux pensées ?
L’opposition fût réelle en 1952 lorsque je publie L’Homme révolté et atteint son paroxysme avec nos divergences sur l’URSS et l’Algérie. Pour moi, l’Algérie n’était pas une question, c’était une évidence. Je suis Français et Algérien. Sartre ne pouvait pas comprendre le drame intérieur qu’un tel conflit peut engendrer. La coexistence restait à mes yeux la meilleure des solutions….
(Il réfléchit) Mais c’est très grave de traiter avec tant de légèreté une recherche philosophique aussi sérieuse que l’existentialisme. Ses origines remontent à Saint Augustin et sa principale contribution à la connaissance réside, sans nul doute, dans la richesse impressionnante de sa méthode (…) Les ressemblances que l’on relève généralement entre les travaux de Sartre et les miens viennent, naturellement, du bonheur ou du malheur que nous avons eu de vivre à une même époque et face à des problèmes et des soucis communs. (1)
L’un de vos problèmes et soucis communs était notamment la reconstruction de l’Europe après la Seconde guerre mondiale…
Nous ne voulions pas n’importe quelle Europe. Accepter de bâtir une Europe avec les généraux criminels de l’Allemagne et le général rebelle Franco c’était accepter l’Europe des renégats. Et après tout, si c’était cette Europe-là que voulaient les démocraties de l’Ouest, il leur aurait été facile de l’avoir. Hitler a tenté de la bâtir, y a presque réussi (…) L’Europe n’a jamais été grande que dans la tension qu’elle a su introduire entre ses peuples, ses valeurs, ses doctrines. Elle est cet équilibre, et cette tension, ou elle n’est rien.(6)
L’Union Européenne et l’Europe ne se portent d’ailleurs pas au mieux actuellement…
C’est une terre magnifique faite de peine et d’histoire.
La crise financière, si elle se prolonge, risque en effet de plonger chaque pays d’Europe dans une crise politique digne des années 1930… Mais il m’arrive quelquefois, au détour d’une rue (…) de penser à tous ces lieux d’Europe que je connais bien. C’est une terre magnifique faite de peine et d’histoire. Je recommence ces pèlerinages que j’ai faits avec tous les hommes d’Occident: les roses dans les cloîtres de Florence, les bulbes dorés de Cracovie, le Hradschin et ses palais morts, les statues contorsionnées du pont Charles sur l’Ultava, les jardins délicats de Salzbourg (…) Mon souvenir a fondu ces images superposées pour en faire un seul visage qui est celui de ma plus grande patrie. (7)
Entretien fictif réalisé par François Bétremieux (L’engouement de la puce)
(1) Interview accordée au « Diário » de São Paulo, Oeuvres complètes, Gallimard, tome 3, p. 866-867
(2) Lettre aux japonais, du 9 octobre 1950, Oeuvres complètes, Gallimard, tome 3, p. 869
(3) Questions et réponses in Une des plus belles professions que je connaisse… Oeuvres complètes, Gallimard, tome 3, p879-880
(4) Lettre à « Caliban », Oeuvres complètes, Gallimard, tome 3, p 864.
(5) Les Justes, Acte II
(6) L’Europe de la fidélité, Oeuvres complètes, Gallimard, tome 3, p872-873
(7) Lettres à un ami allemand, Troisième lettre
