En île de Karine Parquet est un roman méditatif où l’espace insulaire, a priori délimité et clos, se fait théâtre d’une introspection sans issue. Parquet nous embarque dans les vies croisées de ses deux personnages, Ida, contremaîtresse dans une conserverie et Erik, un jeune enfermé dans une colonie pénitentiaire, tous deux pris dans les filets de routines aliénantes, de gestes compulsivement répétés et de désirs d’évasion qui se butent aux frontières de l’île.
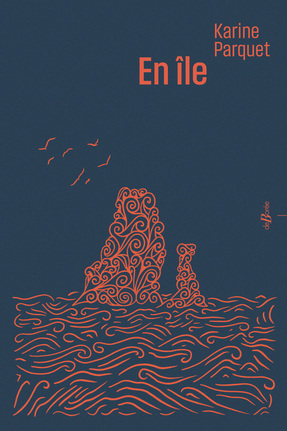
Le roman nous entraîne effectivement sur une île à la fois rugueuse et envoûtante, lieu d’un huis clos qui enserre les destins croisés d’Ida et d’Erik. Ida, contremaîtresse dans une conserverie, est une femme marquée par le poids des responsabilités, les silences conjugaux et l’usure d’une routine immuable. jean, son mari, marin au long cours, incarne la tension d’un couple tiraillé entre absence et reproches. En parallèle, nous découvrons, de l’autre côité de l’île, Erik, jeune détenu dans une colonie pénitentiaire, subit la brutalité des gardiens et la mécanique infernale des punitions. Alors qu’Ida s’épuise à chercher sa place dans une communauté qui la maintient à distance, Erik, lui, résiste en silence, tournant en rond dans une quête désespérée de sens. Tous deux fixent la mer, tantôt comme une promesse, tantôt comme une menace, mais toujours comme un horizon hors d’atteinte. De leurs luttes émerge une sorte de fresque de vies suspendues, où les gestes se font un désir d’évasion, tu par la fatalité.
L’île devient un lieu de résonance intense, un miroir tendu à l’âme humaine enfermée malgré elle dans un espace qui la maîtrise.
Derrières ces décors individuels, l’île devient un lieu de résonance intense, un miroir tendu à l’âme humaine enfermée malgré elle dans un espace qui la maîtrise. Ce roman s’attarde alors sur des thèmes aussi denses que les vagues imperturbables qui battent ses rivages : l’isolement, la fatalité, la mécanique implacable d’un quotidien vidé de sens. Parquet excelle dans l’art de faire de l’île une entité à part entière, où les âmes des personnages s’éprouvent et se décantent, dans un huis clos pesant et incisif. Les personnages d’Ida et d’Erik, broyés par les attentes et les contraintes, deviennent les vecteurs d’une exploration de l’exil intérieur, d’une confrontation âpre avec un univers caillouteux et indifférent, où les élans d’espoir s’épuisent comme l’écume sur les rochers.
L’île dans ce récit est une entité vivante, presque tentaculaire. Plus qu’un cadre, elle devient une structure de réverbération où les affects, les non-dits et les désirs se distillent et se retournent contre ceux qui osent s’y confronter. « Les dernières sardines ont quitté l’huile. Ida sonne la fin de la journée. Il est minuit passé mais elle n’a pas sommeil. » La routine s’impose alors et, avec elle, cette impression d’une vie répétitive, d’un cercle sans échappatoire. La structure de l’île elle-même, avec ses contours et ses limites naturelles, impose à chaque personnage un périmètre fixe, une existence cadrée où les aspirations se heurtent aux murs invisibles du quotidien. Une question nous taraude alors : devraient-ils fuir pour se (re)trouver ?
https://zone-critique.com/critiques/cecile-cayrel
La mer et le mirage de la liberté
Si l’île est une contrainte, la mer, elle, semble effectivement représenter un rêve : l’espoir d’une liberté lointaine, inatteignable. Loin de servir d’horizon lumineux, elle devient une image paradoxale, celle d’un leurre projectif qui tourmente plus qu’il ne libère. Parquet montre à travers ses descriptions maritimes un contraste frappant : « Sur le chemin menant au port, ses narines s’écartent soudain, piquées par l’écume salée qui lui fouette le visage. » Cette « écume », ce fouet salin, est à la fois stimulant et douloureux, rappelant que la mer est un espace d’évasion fantasmée autant qu’un miroir impitoyable pour les âmes en peine. Chaque protagoniste la scrute, non pas pour s’y perdre, mais comme un ultime mirage où se projette l’espoir de quelque chose d’autre, d’un ailleurs où tout pourrait changer, où leur quotidien ne serait plus seulement un enfermement.
Dualités et captivité : entre résignation et rébellion
Les personnages se débattent dans des dualités internes, cherchant leur place sur cette île, entre tentation d’évasion et acceptation morne de leurs existences. En effet, Ida et Erik, en miroir inversé, incarnent chacun une manière d’être face au réel. Ida, cette femme tourmentée, « guette l’arrivée autant qu’elle espérait le départ » de Jean. Ce passage cache une ambivalence immense : l’attachement et la fuite, la nécessité d’un lien et la souffrance qu’il implique, typiques des relations toxiques et de domination. Ida semble incarner cette résignation sociale, cet enfermement involontaire, presque dicté par l’autre qui nous contraint à céder aux attentes que l’on imagine sur soi.
Erik, en revanche, représente un confinement physique, un exil que l’on impose. Son parcours se transforme en une routine circulaire, obsédante, car, dans son enfermement, les mêmes pas sont répétés quotidiennement. « Ils tournent, tournent, tournent », un cycle aliénant qui évoque autant le labeur épuisant que la folie d’un monde sans issue. Ce rythme mécanique symbolise l’écrasement de l’individu sous une discipline implacable, un engrenage où la rébellion se heurte à des murs concrets. Pourtant, Erik, dans sa quête, garde cette étincelle de résistance intérieure, une sorte de « chant muet de la mer » qui le garde en éveil. La dualité entre ces deux personnages permet à Parquet de jouer sur des nuances subtiles, de l’attachement à l’aspiration à la liberté : n’est-on enfermé que physiquement ?
L’espace intérieur et l’exil psychique
Loin des cadres stéréotypiques d’isolement, Parquet met en scène un exil intérieur qui touche ses personnages de manière intime. La vie insulaire devient un monde de renoncements et de silences, une sorte de purgatoire où chacun cohabite avec ses fantômes. « Pour moi seulement, je suis pitoyable. Mais mon désespoir reste mon secret. » À travers ces mots, Parquet révèle une solitude dense, un abandon de soi qui s’épanouit à l’ombre des apparences. Les personnages, même proches, vivent en exil mental, incapables de partager leur peine, de briser le cocon de leur détresse. L’île n’est pas la seule responsable de leur isolement, étant donné qu’ils sont victimes de leur propre incapacité à s’ouvrir, à rompre avec des chaînes invisibles qui les lient à leurs faiblesses – surtout, ils en sont incapables.
La vie insulaire devient un monde de renoncements et de silences, une sorte de purgatoire où chacun cohabite avec ses fantômes.
La force du roman réside dans cette exploration plurielle des mécanismes d’enfermement, où chaque geste dans l’espace carcéral, de la prison ou de la maison, devient un point d’ancrage. Au-delà des murs de la colonie, des espaces de travail répétitifs et des obligations conjugales, elle décrit des êtres humains en proie à des choix intérieurs. Parfois, l’enfermement le plus radical se manifeste dans l’incapacité de bifurquer, de regarder au-delà de soi pour se donner la permission de s’évader. « À la fin, on revient toujours au même point. »
Dans En île, Parquet peint un monde circulaire pour ses personnages. L’œuvre, in fine, renforce l’idée que cette circularité est implacable, capable d’enfermer dans les cercles vicieux. En son cœur, la liberté n’est qu’une illusion, un mirage que les personnages contemplent sans jamais pouvoir l’atteindre. Cette œuvre est moins un drame qu’un testament, une représentation de ceux qui, tournant inlassablement dans un espace réduit, n’aspirent plus qu’à survivre dans les contours figés de leur existence.
- En île, Karine Parquet, Les Éditions De Borée, 2024.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.