Crapalachia, l’excellent roman tragi-comique de l’Américain Scott McClanahan, ressort aux États-Unis cet automne, enrichi d’une préface signée par Nico Walker, l’auteur du bouleversant Cherry (Les Arènes, 2019). L’occasion idéale pour redécouvrir ce court portrait à la fois drôle et touchant d’une famille étasunienne. Nommé pour le Grand prix de littérature américaine lors de sa sortie française en 2018, il a été traduit avec une justesse remarquable par Théophile Sersiron.
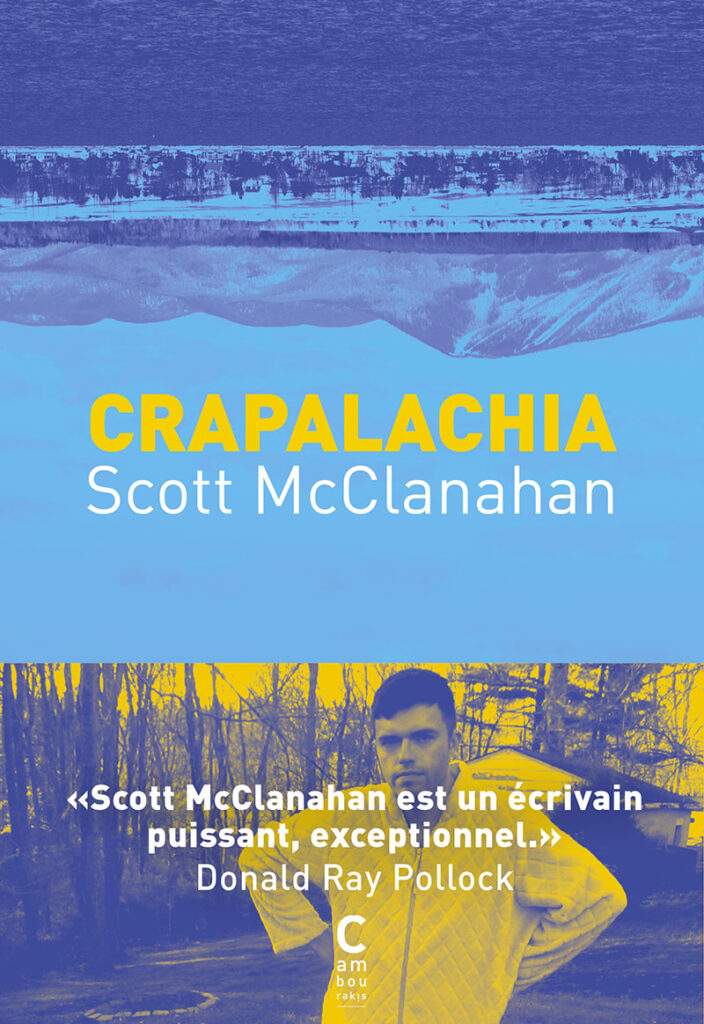
Premier roman de Scott McClanahan, enfant chéri de la scène littéraire indépendante américaine, Crapalachia (une contraction de crap, merde en français, et Appalachia, la région des Appalaches, minière et rurale, où se déroule l’histoire) est paru en 2013, après quatre recueils de nouvelles. Il fait partie des expérimentations autofictionnelles de l’auteur qui culmineront deux ans plus tard avec le très beau Livre de Sarah (également traduit par Théophile Sersiron et publié en France en 2020, aux Éditions de l’Olivier). Le sous-titre de Crapalachia, « Biographie d’un endroit », exprime tout l’attachement de McClanahan et de son alter ego narratif Scott à leur version imaginaire (quoique peut-être pas tant que cela) de cette partie des Appalaches qui traverse la Virginie Occidentale, terre natale de l’auteur.
Histoire(s) de famille
« Ça fait presque dix ans que je pense à Ruby », écrit Nico Walker dans sa préface. Ruby, c’est la grand-mère de Scott, figure centrale du récit. Aussi attachante qu’exaspérante, elle est au coeur de ce roman qui explore les souvenirs de la jeunesse appalachienne de l’auteur : « dans mes rêves je suis à chaque fois de retour chez Ruby, de retour à sa table. » (p. 74) Scott, 14 ans, raconte son adolescence à travers une série de chapitres courts, qui sont autant de fragments d’histoires de famille et d’amitié. Il dresse le portrait sans concession, mais toujours empreint d’une grande tendresse, de ceux qui ont marqué ses années formatrices, pour le meilleur comme pour le pire, avant qu’adulte il quitte la région, puis y revienne, des années plus tard, pour écrire son histoire.
Il y a Ruby, l’aïeule aimante et quelque peu mythomane, véritable institution dans la famille McClanahan. « Une vraie dure à cuire » comme l’appelle Nico Walker. Il y a aussi Nathan, l’oncle cinquantenaire atteint d’infirmité motrice cérébrale, personnage aussi têtu qu’attachant, dont le désespoir après sa rupture avec Rhonda, sa douce infirmière, nous désarme. Les plus belles pages du roman lui sont consacrées. Enfin, il y la famille de cœur : les copains, sa « bande d’enfoirés » (p. 119), ados désœuvrés dont certains tourneront mal, broyés par l’ennui et les désillusions : « j’ai compris que la vie n’était qu’une grosse farce remplie de douleur, où quelqu’un était en train de se foutre de nous. » (p. 107)
https://zone-critique.com/critiques/notules-festival-america-2024
L’Amérique, la vraie, en plein cœur
Au cœur de ce lieu qui n’a d’imaginaire que le nom, ou presque, Ruby incarne une vraie pulsation de vie à elle toute seule. Puits de méchanceté, d’humour et de sagesse, elle épouse toutes les aspérités complexes de l’identité américaine. Véritable incarnation d’une vitalité farouche propre à l’Amérique des villes moyennes, elle reflète ses paradoxes dans un grand mouvement irrésistible vers la vie et, inéluctablement, vers la mort : « J’ai rêvé de Ruby et elle m’a dit qu’une chose arrive et puis une autre. Et puis elle m’a dit que des merdes arrivent et puis d’autres merdes, et puis encore d’autres merdes après ça. Y’a des inondations, des explosions, des catastrophes, des tornades et tout ça n’a aucun sens. C’est rien qu’une grosse blague dont on doit rire. Alors, vous riez ? » (p. 101)
Ce roman se lit d’ailleurs comme un recueil de nouvelles, une galerie de portraits (de personnages et de lieux) qui sont autant de clés pour comprendre Scott
Il y a quelque chose de doux-amer dans les romans de Scott McClanahan, qui tient à son écriture qui mélange les registres et les genres. Crapalachia démontre déjà l’extraordinaire capacité de son auteur à susciter des émotions intenses et complexes en quelques mots, un privilège en général réservé à la forme courte. Ce roman se lit d’ailleurs comme un recueil de nouvelles, une galerie de portraits (de personnages et de lieux) qui sont autant de clés pour comprendre Scott : l’adolescent, l’adulte, l’écrivain.
À la fois observateur et moteur affectif du récit, Scott relate les épisodes marquants de son apprentissage, rendant à cette Amérique parfois délaissée par la littérature ce qu’il lui doit. Ce qui fait la beauté et la générosité de Crapalachia, c’est que ce roman d’initiation est aussi celui de la naissance d’un écrivain, au moment où la vie le contraint à sortir de l’enfance. Du haut de ses 14 ans, il s’adresse à nous comme à un confident, un ami, parfois même un double. Nous partageons à travers son regard les tragédies de la famille McClanahan et, comme lui, nous en sortons grandis, le sourire aux lèvres, grâce à ce mélange de résilience et de fortitude que nous lui empruntons.
Tout au long de Crapalachia, l’image du cœur battant, prêt à s’arrêter à tout moment sous le coup d’un accident, d’une tentative de suicide ou d’une peine de cœur, revient avec insistance. Celui des hommes et des femmes d’une certaine Amérique, parfois idéalisée, que Scott McClanahan nous présente sans pathos malgré les tragédies qui s’y jouent. Ici, comme dans la vraie vie, les histoires d’amour finissent, et pas toujours bien. Le fantasme pastoral de la petite ville quant à lui s’effondre sous le poids de la pauvreté, mais aussi des mines et des chantiers qui avalent les habitants de la région. Scott, narrateur futé aux confins de l’enfance qui a quelque chose du Huck Finn de Twain, évoque les drames des Cacappalaches (un traduction astucieuse de Théophile Sersiron, qui retranscrit parfaitement l’esprit du titre de Scott McClanahan) avec toute l’intransigeance et la candeur de l’enfance : « Moi je m’asseyais en classe et j’apprenais que tout change même dans les Cacappalaches. J’apprenais que les mineurs devenaient des machines, et que les bûcherons devenaient des machines, et que les toutes petites routes devenaient des autoroutes, et que les villes devenaient des drive-in de fast-foods et des stations essence, et que les gens devenaient des gens bons qu’à servir les touristes et à laisser ces touristes rire de leurs accents. » (p. 161)
Je laisse à Nico Walker le mot de la fin, tiré de sa préface : « Quand on lit un livre de Scott McClanahan, on sait d’avance qu’il va être super drôle et super triste et super beau. » Rien n’est plus vrai.
- Crapalachia, Scott McClanahan, Cambourakis pour l’édition française, 2018.
- Crédit photo : DR

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.