Dans L’Épaisseur de l’aube, Nicolas Garma-Berman nous plonge dans l’intimité d’une famille, au cœur de ses silences : ceux qui se créent à la perte soudaine d’un proche, que l’on camoufle sous d’autres sons, d’autres musiques mais qui finissent par nous ronger. Roy et Ness, deux frères, sont forcés par une succession d’événements tragiques à renouer le dialogue. Le récit alterne leur point de vue, nous emmenant dans un voyage à travers la forêt suisse, jusqu’à une maison familiale perchée dans la montagne. Entre leurs angoisses partagées et leur opportunité de se retrouver, le lecteur s’immerge dans une quête de vérité poignante.
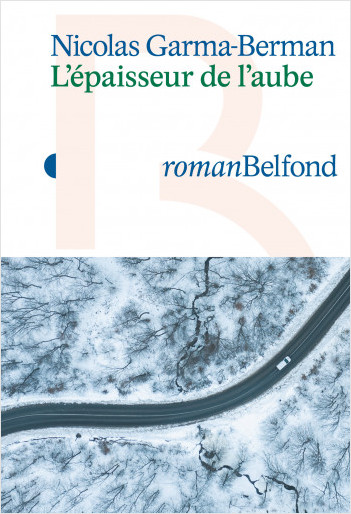
La relation complexe entre Roy et Ness constitue le pivot émotionnel du roman. Précipités dans une dynamique tragique, les deux frères s’affrontent et se soutiennent. Ils vont entreprendre ensemble un voyage réel vers un lieu symbolique à la recherche de la vérité mais également un voyage émotionnel leur permettant progressivement de se décharger du poids du passé. Si cette excursion va parfois être synonyme de déroute, elle va offrir aux deux frères une nouvelle page pour reconstruire leur fraternité.
Le bruit comme langage : une histoire de sons et de musiques
Dès les premiers chapitres, la musique imprègne le récit. De Bob Dylan à Leonard Cohen, en passant par Pink Floyd et les Beatles, chaque introduction de chapitre convoque un extrait de chanson mythique qui confère une bande-son à cette fresque familiale. Ce fil musical incarne une dimension clé de l’histoire : le bruit, omniprésent mais absent à la fois, devient un moyen de communication pour les deux frères.
« Aussi loin que j’étais capable de suivre le fil de ma mémoire, même quand les images s’obscurcissaient et les visages disparaissaient, il restait la voix de mon frère » se remémore Ness. Ce passage illustre à quel point la musique et les sons transcendent les silences familiaux. Parfois salvateurs, parfois lourds de souvenirs, ces bruits offrent un espace pour guérir, comme le note Ness : « Nous n’avions pas vraiment parlé, mais nous avions écouté de la musique ensemble, ce qui pour Roy revenait au même. »
Le rôle du son évolue au gré des moments de vie. L’auteur le propose comme moyen de survie dans des espaces de silence oppressants. « J’avais besoin de bruit. Je ne suis pas à l’aise dans la nature, dans ces endroits sauvages, mais quand il y a du bruit, je peux m’y confronter. […] Mais cette nuit-là, le silence était total. » Ness lui, expose clairement cette place paradoxale et changeante : « Cette voix qui m’avait fait naître, grandir, qui m’avait fait oublier d’où je viens et m’avait habitué à un autre chez moi. Qui m’avait donné un nom, qui m’avait rassuré, et terrorisé. Cette voix qui, à mon oreille, avait fait mourir ma mère. Cette voix à présent ressuscitait son enfant. »
Le bruit est oppressant, voire menaçant, lorsqu’il est saturé de non-dits mais c’est aussi la clé unique d’une libération complète:
« Tu peux t’échapper, Birdie. Mais pas comme ça […]
— Il faudra aussi…. Il faudra que je me bouche les oreilles.
— Mais non. Tu devras juste choisir la bonne musique. »
Ainsi, le fredonnement d’une chanson, pourtant un geste anodin, devient un refuge : « Cette nuit-là, le silence était total […] Alors j’ai fait une chose que je n’avais pas faite depuis des années : je me suis mis à fredonner une chanson à voix basse. » La musique, bien plus qu’un bruit, est désormais la passerelle entre passé et présent.
https://zone-critique.com/critiques/sally-rooney-intermezzo
Fantômes et mémoire : les ombres du passé
Les fantômes traversent ce récit comme un leitmotiv, incarnant les secrets et les silences qui hantent les vivants. L’existence de ces spectres, d’abord un jeu d’enfant entre les deux frères, devient une métaphore puissante. « Craint-on moins les monstres quand on en est un soi-même ? » Cette question confronte personnages et lecteurs à leurs propres failles.
Ce livre est aussi l’histoire d’un tournant, du moment où l’on décide de cesser de vivre pour les morts et d’apprendre à exister pour les vivants. Cette prise de conscience se révèle notamment dans ce passage et l’injonction d’aller de l’avant : « Ceux que tu cherches sont des créatures de chair et d’os. Ce n’est pas dans ces ténèbres que tu les trouveras. Lève-toi. Sors de là. » Reste à chacun de saisir ce point de bascule où l’on choisit d’affronter les vivants plutôt que de poursuivre l’insaisissable, où l’on réalise que la voie du temps est à sens unique et qu’il faut parfois s’astreindre à l’emprunter avec ceux qui sont encore présents.
Pourtant, les fantômes restent omniprésents : « Mon frère, les fantômes ne sont rien à côté des vivants qui rôdent sans nous regarder. Les fantômes ne viennent que si on les appelle, alors que les vivants nous quittent et disparaissent et à tout moment ils peuvent ressurgir et nous blesser. » L’idée de s’échapper des souvenirs, bien qu’attrayante, est elle-même un leurre : « C’était une fuite, mais ce n’était pas la bonne. Les souvenirs me suivaient. »
L’ombre de Camus plane à certains moments du récit. Les paroles de Ness, « Nous sommes tous des fantômes et la nuit nous transperce », résonnent avec L’Étranger : « Nous étions tous des privilégiés. » Les deux auteurs ont en commun des personnages pris entre deux mondes : celui des vivants et celui des disparus, où chaque silence devient un poids insurmontable car jamais comblé.
La nature, alliée ou ennemie au coeur du déracinement
Dans L’Épaisseur de l’aube, la nature est omniprésente et possède un rôle ambivalent. Refuge et menace à la fois, elle reste indifférente aux souffrances humaines tout en étant un espace où les personnages cherchent à se reconstruire. La famille est contrainte de quitter son Écosse natale pour la Suisse, une fuite qui ne parviendra pas à effacer les fantômes. La nature nouvelle est alors le miroir de ce traumatisme : « Papa faisait partie de ces exilés qui n’ont connu ni guerre ni famine, ni tyrannie ni persécution, qui ont simplement fui une absence pour en trouver une autre à l’endroit où ils ont trouvé refuge. »
Dans L’Épaisseur de l’aube, la nature est omniprésente et possède un rôle ambivalent.
Genève, trop étroite pour contenir leurs souvenirs, devient à son tour un piège : « Année après année, j’y avais entreposé mes souvenirs comme on stocke des affaires dans le grenier d’une maison familiale. […] Les souvenirs se tapissaient à chaque coin de rue, dans tous ces logements visités, sur chaque banc, entre les branches des châtaigniers. À trop y vivre, je la faisais presque déborder » déclare Ness.
Et dans leur ascension vers le bothy, ce haut lieu perché dans la montagne, les frères espèrent trouver une vérité que la nature n’est pas prête à leur dévoiler. Face à cet environnement glacial, figé malgré les drames successifs de leur famille, ils sont confrontés à une forme d’immuabilité. L’immensité de la nature et son absence de compassion font écho aux inquiétudes de leur père : « Mon père est resté silencieux. C’était trop grand pour lui, ce paysage. Il en cherchait les limites mais ne les trouvait pas. Il aimait imaginer la mer sans y naviguer, il préférait regarder les montagnes de loin, penser aux hautes plaines sans jamais y poser le pied. »
La nature est ici un personnage à part entière, inébranlable, indifférente, mais aussi impitoyable : elle reflète le silence et les secrets qui étouffent les deux frères. Leur quête de réconciliation, bien que concrète dans ce décor montagneux, se heurte à l’insensibilité de cet environnement. Désormais, ils n’ont plus aucun décor complice et doivent accepter une plus grande mise à nu.
Mais cette escapade apporte en plus de son lot d’imprévus un basculement majeur, un moment où Ness prend le rôle du protecteur : « J’étais soudain le grand frère veillant sur son cadet, celui qui restait debout quand l’autre se perdait dans des débris de rêves brumeux, celui qui devait agir, combler les fissures, porter le funambule sur son fil jusqu’à ce qu’il rejoigne la terre ferme […] j’étais enfin celui dont on avait besoin. »
Leur voyage devient un moment de vérité où ils décident ensemble de laisser partir les morts pour enfin devenir profondément vivants.
Cet ouvrage donne la possibilité d’une pause, d’un souffle de nature qui permet de mieux saisir notre rôle à jouer. Si cette nature échappe parfois à notre compréhension et reste un témoin insensible des drames de la vie, il nous reste le pouvoir de choisir les bruits qui nous entourent, les mots pour rompre les silences. Ils offrent la possibilité d’entendre une nouvelle mélodie, celle qui construit et répare.
L’auteur nous rappelle que les mots, comme la musique, possèdent un véritable pouvoir de guérison, là où les années seules échouent à apaiser les blessures. Cet ouvrage, malgré ses passages sombres et son poids d’ombres, nous donne envie d’y croire : avec l’espoir, l’aube finit toujours par renaître.
- L’Épaisseur de l’aube, Nicolas Garma-Berman, Belfond, 2024.
- Crédits photo : © Chloé Vollmer-Lo

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.