Dans cet essai riche en idées et en références, Vincent Gerber puise dans la littérature de science-fiction pour en faire jaillir la partie la plus inspirante et contestataire.

Les éditions du Passager Clandestin, connues avant tout pour des essais de critique sociale, ont, depuis leurs débuts, traduit des textes inédits de science-fiction dans leur collection Dyschroniques. On pense notamment à A voté d’Isaac Asimov, où un électeur unique est désigné par un super-ordinateur en vue des prochaines élections, à Continent Perdu de Norman Spinrad où un guide touristique montre un New York en ruines au XXIIe siècle à des dignitaires africains, ou à Retour à la vie de Michael Bishop, qui met en scène des déplacements forcés et aléatoires de populations entières d’un bout à l’autre de la planète. Et il n’est donc pas étonnant de les voir publier cet essai tout à fait bienvenu sur ce genre et sur ses potentialités, notamment politiques.
Vincent Gerber est “historien de formation et libertaire de coeur”, particulièrement connaisseur de la pensée de Murray Bookchin, qui a laissé son empreinte dans l’écologie politique, chez les Kurdes autonomes au Rojava, et même chez certains Gilets Jaunes séduits par le municipalisme libertaire. La thèse principale du livre est assez limpide, et ne surprendra que ceux qui ne connaissent finalement que superficiellement la SF : le genre porte en lui une charge politique, une puissance potentielle qui ne demande qu’à péter joyeusement. Cela vient de sa capacité à amener le lecteur à se projeter dans d’autres mondes, à vivre des expériences éloignées de la sienne, à déplacer son regard par des effets miroir ou grossissants, le changer et ainsi mieux questionner la société dans laquelle il vit, et pourquoi pas ainsi la transformer pour le mieux. Pour ce faire, après un regard balayant la science-fiction (globalement littéraire, mais la BD et le cinéma ne sont pas évacués de la réflexion), il tente de repenser la notion d’utopie, avant de s’arrêter plus précisément sur certaines oeuvres comme celles d’Ursula K. Le Guin ou de Iain Banks.
https://zone-critique.com/critiques/ursula-le-guin
Into the Unknown
En y allant très superficiellement, en pensant à la SF, on voit surgir devant soi des mégalopoles démesurées, des vaisseaux spatiaux longs comme la carrière politique de Michel Barnier, des machines de bâtards, on entend des bruitages “piou piouuuu” et des explosions géantes aux confins de la galaxie (alors que dans l’espace le son ne peut pas se répandre, on le sait tous), on voit débouler des aliens aux apparences improbables. Mais alors la révolution, dans tout ça ? Le lecteur impatient veut du sang et des chemises arrachées.
D’emblée, l’introduction attire la sympathie, en rappelant à nos bons souvenirs la fameuse planche de Gotlib dans la Rubrique-à-Brac (1968-1972) “Incorrigibles rêveurs”, sur ces adultes chauves aigris, cyniques, bien rationnels et sans imagination rétorquant à chaque proposition en avance sur son époque à travers les siècles “Alors là, vous naviguez en pleine science-fiction !” faisant transpirer de honte ces rêveurs. Alors que pour concevoir puis mettre en place quelque chose, une ville, des façons de vivre ensemble, une façon de s’aimer, tout un chacun admettra qu’il a bien fallu que quelqu’un l’imagine.
Et pourtant, on arrive ensuite à un regard assez global sur les rapports conflictuels entre le genre et la politique, sur la façon dont les auteurs se positionnent ou non, sur comment le politique s’inspire de la science-fiction. Et on est tout aussi surpris de croiser le menton botoxé des frères Bogdanoff, et l’auteur se servir de leur essai L’effet science-fiction (Robert Laffont, 1979) pour structurer les trois principes par lesquels passe cette charge politique du genre. Ainsi, ils y distinguent dans leur analyse « l’apport à la compréhension du présent (action de miroir), un effet de mise en garde (action d’extrapolation) et une capacité à remettre en question l’immuable (action de proposition) ».
Car à moins de vivre seul sur un astéroïde à des millions d’années-lumière de la Terre, difficile de ne pas avoir eu vent d’oeuvres aussi fortes que 1984 de George Orwell, V pour Vendetta écrit par Alan Moore, dessiné par David Lloyd et très maladroitement adapté par les soeurs Wachowski pour le film réalisé par James McTeigue, et de ne pas avoir croisé à tort et à travers le mot “novlangue”, ou le masque de Guy Fawques dans une vidéo des Anonymous. Ces sociétés dystopiques mettent en garde le lecteur contre ce qui est déjà prégnant ici et maintenant, il faudrait seulement atteindre le niveau de bêtise et de déconnexion d’Elon Musk pour ne pas le voir. A l’inverse, dans l’action de proposition, l’exemple le plus évident est celui de Star Trek, où les races coexistent pacifiquement au sein de la Fédération ; cette série montrera l’un des premiers baisers interraciaux à la télévision.
Gerber nous plonge ensuite dans les controverses liées à l’avènement d’une nouvelle génération d’auteurs comme Brian Aldiss, Ursula K. Le Guin, James G. Ballard ou Michael Moorcock, assumant davantage l’innovation tant dans le style que dans la façon de porter les questionnements contemporains. Il cite des piques violentes contre les générations d’auteurs précédentes, comme celle de Moorcock (Starship Stormtroopers) à leur technosolutionnisme, leur impérialisme déguisé et leur “xénophobes, suffisants et confiants que le système capitaliste allait fleurir au travers de l’univers […] L’individualisme sauvage était le concept politique le plus évolué qu’ils pouvaient gérer – dans la tradition des pulps, le Code de l’Ouest devient le Code de l’Espace, et on attend d’un capitaine de vaisseau spatial qu’il fasse ce que son devoir lui dicte…”. Il aborde enfin la diversification croissante des regards des auteurs, l’avènement du solarpunk, d’auteurs comme Kim Stanley Robinson, Liu Cixin, le succès de Dan Simmons ou d’un Alain Damasio dans nos contrées.
Same as it ever was
Toute la partie centrale de l’essai porte sur la question de l’utopie, et c’est probablement la plus intéressante. Gerber avance que les grands utopistes tels que Etienne Cabet (Voyage en Icarie), ou Thomas More (L’utopie) décrivaient et animaient des mondes clos sur eux-mêmes, où le bonheur n’est qu’une habitude, un paramètre planifié en avance, ne demandant aucun effort, sans aucun enjeu. La morale y est certes sauve, mais en gros, on s’y fait un peu chier. L’utopie est certes un outil majeur pour dessiner des futurs désirables, mais il démontre qu’elle peut être mobilisée d’autres façons, plus fines. Il va alors frotter ces mondes sous cloches à des exemples comme le roman Les Dépossédés d’Ursula K. Le Guin puis le Cycle de la Culture de Iain Banks. Les Dépossédés montre comment une utopie communiste libertaire va se figer dans un consensus poli, un degré zéro de la remise en question, un conformisme ennuyeux pour les héros, qui par ce constat vont s’aliéner à l’ensemble de leur communauté. Iain Banks, lui, met en scène une dystopie extrêmement sophistiquée, la Culture, où tous les besoins humains, mais aussi toute la vie politique sont planifiés par un complexe d’intelligence artificielles, les Mentaux. Ce qui vit en dehors, ou qui doute du bien fondé de ce système a vocation à le rejoindre, ou à être éliminé.
Vincent Gerber plaide pour des utopies incomplètes, toujours à améliorer, jamais closes.
Vincent Gerber plaide évidemment pour l’utopie dans la science-fiction, comme force de proposition et de stimulation des imaginaires, mais pour des utopies incomplètes, toujours à améliorer, jamais closes. On s’étonne par ailleurs que dans son attirail intellectuel, on ne trouve pas Cornelius Castoriadis (1922-1997), qui pourtant théorise avec son concept d’autonomie cette démocratie qui ne vit que par la participation politique complète pensée, voulue et renouvelée à chaque instant du peuple. C’est là pour nous un complément essentiel à la pensée libertaire, mais on s’éloigne du sujet.
Parlons enfin de ce qui gêne à la lecture : le style. Vincent Gerber écrit comme un universitaire, et ce qu’on gagne comme précision, on le perd en énergie, en souffle, et en plaisir. Le contraste est d’ailleurs flagrant quand on enchaîne avec la postface de Corinne Morel-Darleux (auteure entre autres de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce), habitée, inquiète et portant tout autant d’espoir que l’auteur en la fiction, la puissance de cette confrontation avec l’autre et soi-même. Certes, l’auteur maîtrise parfaitement le sujet, le propos, donne de très nombreuses références, mais peine à saisir aux tripes, à partager son enthousiasme ou même un peu de l’énergie qu’il reçoit d’une littérature pourtant si inspirante, et qui amène si souvent à l’émerveillement.
A l’époque actuelle où les artistes sont pensés par le monde militant, au mieux comme un réservoir d’images et de mots qui doivent accompagner la Cause avec abnégation, il est salutaire de rappeler comme Gerber que quelque chose se joue dans le roman qui n’est pas compressible à un tract, un thread sur Twitter ou à un slogan de manif : l’incarnation, le pouvoir d’empathie. On doit aussi faire se frotter à l’altérité, à l’inachèvement et l’indissolubilité des situations présentées, la séduction et la répulsion, mais aussi le rêve. Le mystère, la beauté sont indispensables pour pouvoir faire passer même les idées les plus séduisantes. Ce qui ne veut pas dire que le but premier du roman de SF doit être de faire “passer la pilule”, et nous allons dans son sens, un romancier doit écrire des romans. Cependant, c’est un fait, les livres changent le monde, et le regard des gens, l’auteur l’explique très bien. « Imaginer et contester “ce qui est” sera-t-il pour autant suffisant pour engendrer un changement ? Certainement pas. Mais ne pas le faire, ne pas chercher à concevoir un futur enviable, ou le penser comme possible, nous condamne à coup sûr. »
- L’imaginaire au Pouvoir – Science-Fiction politique et Utopies (postface de Corinne Morel-Darleux), Le Passager Clandestin 2024.
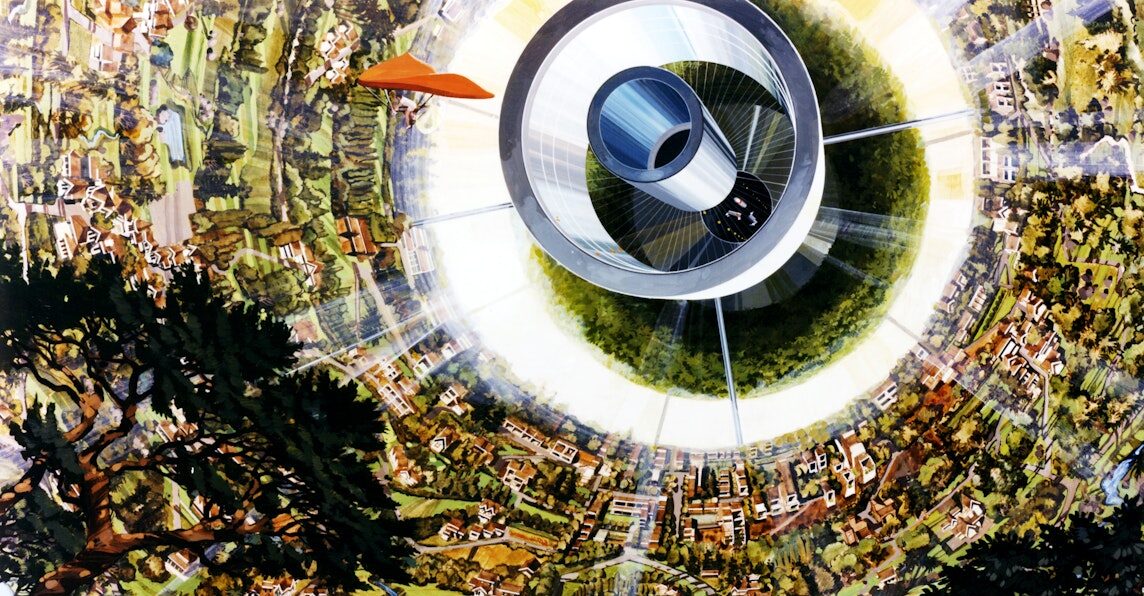
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.