François Bégaudeau est écrivain. Auteur d’ouvrages sensibles et empreints de vitalisme, ce dernier cultive une individualité libertaire loin des sentiers battus. Son dernier récit, Comme une mule (Stock, 2024), cherche à rétablir les faits concernant le procès lui ayant été intenté par l’historienne Ludivine Bantigny. Avec le mordant que nous lui connaissons, l’essayiste part de cet événement et se livre à des analyses pointues concernant de nombreux sujets actuels dont le rapport entre l’art et la politique. Un ouvrage décapant.
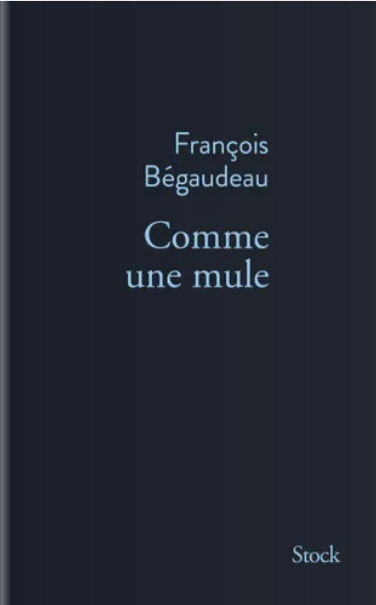
D’emblée, l’écrivain tente de relater les faits dont on l’accuse, il s’agit pour lui de se méfier d’une certaine tendance contemporaine à tout ramener à de pures émotions : l’accusatrice, une certaine historienne de gauche radicale nommée sobrement LB, est outrée par ce qui n’était qu’au départ une blague potache. Or, cette dernière a fait tâche : d’aucuns se sont délectés de la diffuser tout en la dénonçant en meutes. De nombreux auteurs et journalistes s’y sont donnés à cœur joie.
Loin de déplorer l’effondrement d’un ordre patriarcal suranné, loisir de réactionnaires en chambre, François Bégaudeau s’échine à rester précis en toutes circonstances, y compris lorsque le sujet semble sensible.
La plaisanterie vache, défiant le « bon goût » et la bienséance bourgeoise, abordait sur un ton ironique la tendance supposée de cette historienne à collectionner les partenaires sexuels. En nietzschéen alerte, François Bégaudeau comprend qu’il ne s’agit pas tant pour celle qui porte plainte de comprendre sa vanne que d’agir selon les décrets de l’affect : en effet, le fait de s’indigner d’une situation conforte le scandalisé, voyant ainsi sa morale raffermie. Ce n’est d’ailleurs pas l’apanage de « l’humanité progressiste » : lorsqu’un homme d’origine extra-européenne agresse une femme occidentale, l’identitaire jubile ; l’anticapitaliste jouit de son indignation déclenchée par l’implantation d’un chantier Total dévastateur au sein d’un pays africain pauvre et dictatorial. En effet, il est plaisant de voir le réel intégrer nos petites cases préfabriquées, on le simplifie, on l’expurge de son caractère irrémédiablement tragique, ce que théorise le joyeux Clément Rosset dont l’auteur est un fervent lecteur.
En creux des analyses de l’auteur sourd une tendance vitaliste : sain est le féminisme qui souhaite multiplier les forces, funeste est celui qui soustrait les puissances.
Ce « tronquage » permanent des faits demeure pour François Bégaudeau ce dont il faudrait faire litière afin de faire progresser la gauche radicale : un certain pan de ce mouvement politique se veut plus royaliste que le roi. Cette surenchère dans la pureté, loin d’être un moteur sain du progressisme, est bien plutôt un repoussoir. Or, l’essayiste l’écrit : « Je veux avoir raison d’avoir raison ». Si un dîner arrosé est l’occasion d’aborder le sujet de la fraude sociale, le communiste a raison de mettre en avant la note bien plus salée que va devoir payer l’État, imputable à la fraude fiscale : le goût des faits est toujours plus pertinent que le goût pour la moraline, dont nous savons qu’elle est, au moins depuis Rimbaud, la « faiblesse de la cervelle »…
https://zone-critique.com/critiques/francois-begaudeau-comme-une-mule-desranges
Également, l’auteur pose la question du procès : qu’est-ce qui fait que cela s’est enclenché de cette façon ? Bégaudeau parle d’un « continuum », terme affectionné par nos contemporains : sa blague est d’abord un « symbole » pour certaines personnes enragées, celui d’un auteur phallocrate que nous nous devons de punir par le biais légal afin de donner le bon exemple. La condamnation en question fait aussi « symptôme » : la blague serait le signe d’un homme favorable à la domination patriarcale, la blague est-elle cause ou conséquence de cet attrait pour la domination ? Personne ne peut y répondre. Enfin, le troisième élément réside dans le pouvoir causal de la plaisanterie : le fait de titiller un imaginaire vicié, celui de la femme facile qui s’envoie en l’air avec tout ce qui passe, aurait le pouvoir d’activer des comportements toxiques chez certains prédateurs, au détriment d’un féminisme radical. Or, le « tout est dans tout » a les défauts de ses qualités : évidemment, penser les phénomènes sociaux et sociétaux d’une manière conséquente implique de convoquer la critique systémique. Cependant, est-ce qu’un mot, drôle ou non, c’est la même chose qu’un soufflet ? Oui et non, cela est compliqué. La confusion règne, et cela se fait au détriment de la pensée et de la vie dans son caractère inexplicable. En somme, la maison progressiste perd par son apologie des affects : raisonner ainsi peut mener à avaliser le bon gaulois qui pense avoir raison de frissonner devant le supposé « grand remplacement ». Briser les carcans de la domination, c’est avant tout brandir des faits dont nous savons qu’ils sont têtus « comme des mules ». Dans cet ordre d’idées, il s’agit d’éviter le piège du féminisme bourgeois faisant fureur au sein d’une certaine doxa.
À l’encontre de la vulgate aristotélicienne concernant l’art cathartique, l’écrivain établit que la création artistique recueille le mal et la maladie, et ne cherche pas à les évacuer.
Féministe bourgeoise, féministe fille à papa
Au goût porté aux faits, Bégaudeau souhaite ajouter la critique du légalisme dont a pu faire preuve l’historienne indignée : prononcer une peine pour le juge, lors d’un procès, revient avant tout à maintenir l’ordre social en place qui reste tout sauf neutre : « Son éventuelle volonté de juger en connaissance de cause est en excès par rapport à ce que la société qui le rémunère lui demande ». La partialité escomptée est toujours biaisée par le conflit des versions différentes du délit ; en dernière instance, ceux qui souffrent le plus sont les faits. Plus que cela, le procès pose un problème d’ordre philosophique : il accrédite la fable du libre-arbitre. En effet, la « justice », à entendre comme institution, ne cherche pas tant à savoir, à connaître les causes qui ont pu présider à un acte délictueux, mais plutôt à condamner l’être peccamineux dans le but de pérenniser le statu quo social ou sociétal. Lorsqu’une femme est violentée par son conjoint, moult séries sentimentalistes vont s’emparer du sujet, non par probité intellectuelle, mais par goût de l’admonestation moraliste : les faits seront occultés au profit du « c’est pas bien », ce qui n’aura aucune incidence, ni à l’encontre la structure patriarcale brisant les dominées, ni à l’encontre de la structure sociale poussant certains hommes désespérés à commettre des crimes au sein de leur ménage.
Lorsque nous cautionnons la logique du procès, nous tombons tête la première dans le féminisme bourgeois : la sécurité est largement attribuable à l’affect trouillard du rentier frileux dont la peur de perdre ses biens frise le ridicule. Sanctionner légalement celui qui contrevient au droit sacré de la propriété revient à légitimer l’ordre capitaliste : de la même façon, réagir de façon purement répressive au problème des violences commises à l’encontre des femmes, c’est encore utiliser le traitement policier d’un tel fait de société. Contre une action structurelle contre les féminicides, le féminisme policier préconise un arsenal de lois, une création de services spéciaux, une multiplication des caméras de surveillance, des bracelets électroniques. Si dans certains pays européens, ce genre de dispositifs ont pu avoir leur efficace, cela se fait systématiquement au détriment d’une critique structurelle de la société patriarcale.
https://zone-critique.com/critiques/francois-beagaudeau-critique
De plus, ce « féminisme bourgeois » dont parle l’auteur n’a en réalité rien de subversif pour l’ordre brutal régi par des mâles dominants : c’est leur fond de commerce. En effet, le patron d’une multinationale a tout intérêt à mettre en valeur les « femmes puissantes ». Briguant des postes prestigieux, des fonctions de dominantes, intéressées par les carnets d’adresses de leurs semblables masculins, les femmes « empuissantées » ont la force d’un Rocky Balboa. Serrant les dents dans le but de grimper la hiérarchie de l’entreprise, énarques, ces dernières sont ravies d’épouser un banquier et de placer leurs progénitures à Stan. Si elles quittent la maison, ces femmes n’obéissent pas moins à un père dont les injonctions visent à faire fructifier son capital financier : âpre au gain, bosseuse, réalisant deux journées en une, la féministe libérale bourgeoise voit dans son aliénation une réussite sociale qui réjouit ses ancêtres nantis.
En somme, l’auteur est parti de son procès afin de souligner les limites de l’argumentaire énoncé par LB : celle-ci n’a pas le goût de la précision et affectionne le légalisme qui sert l’ordre bourgeois dont elle se fait paradoxalement la contemptrice en chef. En individualisant la peine, le légalisme épargne la structure : Roland Barthes nommait ce procédé la « vaccine » (Mythologies). Accréditant le mythe de la responsabilité, le procès appauvrit le réel en refusant de considérer les déterminismes puissants à l’œuvre dans les corps et les esprits. Contre ce triomphe de la morale facile, il s’agit pour Bégaudeau de faire avant tout droit à la vie : en bon vitaliste, l’auteur affectionne le rire et l’art. A contrario, ce dernier refuse les simplifications, progressistes ou non, qui amputent l’existence de son chaos initial.
Apprécier la dérision à propos de sujets polémiques, c’est reconnaître que tout dans notre psychisme n’est pas soluble dans le « commerce socio-moral ».
Le sentiment que la puissance grandit
En creux des analyses de l’auteur sourd une tendance vitaliste : sain est le féminisme qui souhaite multiplier les forces, funeste est celui qui soustrait les puissances. Dans le sillage de la tradition libertaire favorable à la puissance d’exister, François Bégaudeau se méfie des critiques morales dont le but est d’éteindre toute vie. Cette critique du féminisme policier et bourgeois s’étend à ceux dont le but est d’émousser le tranchant de l’humour noir et de l’Art. En effet, l’auteur est un habitué des sketchs de Coluche : la blague potache sied aussi à son amour pour le courant musical punk, jamais avare quand il s’agit de vannes douteuses. Partant des corps, Bégaudeau remarque que ceux-ci cachent tous une « petite vie organique, cachée, que la morale, superficielle, basse du front, ignare de la matière, ne saurait percevoir ».
Il existe, personne ne saurait le nier, une « drôlerie des blagues ignobles », mais aussi une « puissance des blagues injustes » : l’humour noir choque, bouscule, déstabilise ceux qui l’écoutent. Un vivier d’horreurs habite nos esprits, que nous le voulions ou non ; le comédien sait le cultiver et jouer sur ces ressorts abjects que nous nous évertuons à cacher. Il arrive parfois que de nobles âmes parient sur l’humour « avec » les autres, et non « contre » eux : très vite, nous nous ennuyons. Amoral, monstrueux, limite, l’humoriste s’attaque à des cibles qui ne l’ont pas mérité : il n’est pas de nature méritocrate. Apprécier la dérision à propos de sujets polémiques, c’est reconnaître que tout dans notre psychisme n’est pas soluble dans le « commerce socio-moral ».
Quant à l’Art, il est de notoriété publique qu’il subit l’assaut des nouveaux Messieurs Prudhomme : celui-ci devrait aussi se plier aux canons établis par les ligues puritaines. Loin de critiquer cette tendance d’un point de vue réactionnaire, Bégaudeau ne chante pas les louanges d’artistes masculins qui pouvaient jadis se livrer à leurs désirs les plus vils. Prenant partie pour la vie intransitive, ce dernier pointe que l’Art a toujours à voir avec l’irrécupérable, ce moment où tous les projets d’amélioration sociale butent : il est le ténébreux, le veuf, l’inconsolé. À l’encontre de la vulgate aristotélicienne concernant l’art cathartique, l’écrivain établit que la création artistique recueille le mal et la maladie, et ne cherche pas à les évacuer. Contrairement au croyant, François Bégaudeau voit dans toute vie une vie pour rien : l’Art rend compte de cette chose étrange à laquelle nous participons tous et sur laquelle nous achoppons sans cesse. Là où la logique rend raison, l’écrivain montre le tragique, l’irrémédiable, dont nous pensons, à tort, qu’il est toujours à même d’être dépassé, soit par la politique, la morale ou la religion.
Audacieux et foisonnant, Comme une mule part d’une situation particulière, celle du procès de François Bégaudeau, sous-tendu par un ensemble de problématiques contemporaines. Adepte rigoureux de la distinction, l’écrivain amène de la complexité dans un microcosme intellectuel qui tend à en perdre : éperdument vitaliste, ce dernier érige le déploiement de la puissance vitale en valeur suprême contre une morale contraignante et bornée. Au moment où la confusion règne, lire cet ouvrage est salvateur.
- Comme une mule, François Bégaudeau, Stock, 2024.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.