Joseph Ponthus, auteur du poignant À la ligne, a laissé une empreinte indélébile dans la littérature contemporaine avant de nous quitter tragiquement en 2021, emporté par un cancer. À la ligne est une œuvre sur la vie, ou sur ce qu’il en reste quand on est confronté à la barbarie industrielle. Et c’est surtout un témoignage vibrant de cette lutte quotidienne pour préserver son humanité, un combat mené à coups de mots, de vers, de pensées partagées en silence sur la ligne de production.
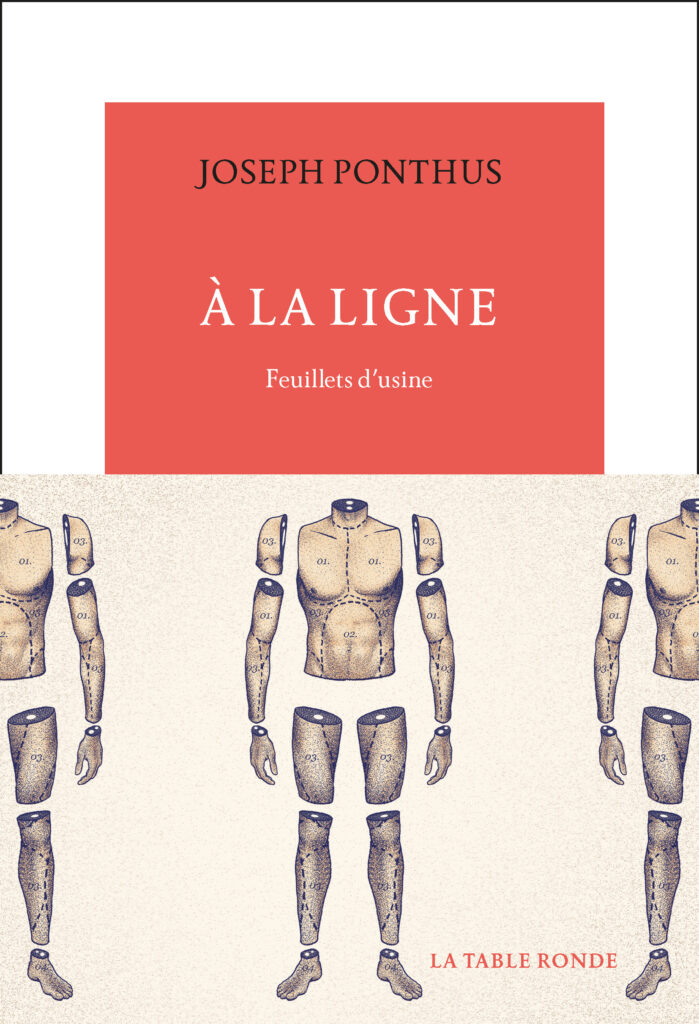
Joseph Ponthus nous offre bien plus qu’un simple récit de la vie à l’usine ; il propose une véritable performance littéraire, où la forme du texte devient un miroir fidèle de l’expérience ouvrière. « J’écris comme je travaille / À la chaîne / À la ligne » : dès les premières pages, la fragmentation du récit s’impose comme une métaphore du morcellement de l’individu soumis à la répétition mécanique du travail. Chaque phrase, chaque paragraphe isolé traduit cette cadence brisée qui marque le quotidien du travailleur à la chaîne, emprisonné dans un univers où le temps semble se décomposer en tâches monotones.
Et c’est ainsi que par ce morcellement, Ponthus nous révèle la violence, plus ou moins subtile, que l’usine inflige à ceux qui y travaillent. On plonge ainsi dans une sorte de flux de conscience haché, où l’écriture semble elle-même soumise à la dureté du travail physique : « Vider des caisses de vingt-cinq kilos de poissons pour remplir d’autres caisses de vingt-cinq kilos / Certes on dirait les Shadoks / Mais c’est l’usine / Et ça fait les muscles ». Malgré la tentative d’introduire une ironie amère, la répétition même des mots martèle cette absence de finalité autre que celle d’un effort physique brutal et épuisant. Dans le même esprit, au 12ᵉ chapitre, le refrain « j’égoutte du tofu » revient comme une litanie, un mantra dérisoire qui souligne la monotonie et l’absurdité du travail. « J’égoutte du tofu / Encore trois heures à tirer / Plus que trois heures à tirer / Il faut continuer / J’égoutte du tofu ».
La fragmentation du texte ne sert pas seulement à illustrer l’aliénation ; elle est aussi un moyen pour l’auteur d’y résister. En éclatant son récit, Ponthus refuse de se soumettre à une narration linéaire qui pourrait rendre le travail ouvrier tolérable ou héroïque. Au contraire, chaque fragment est un éclat de réalité brute, un éclat de conscience qui refuse d’être poli ou intégré dans une histoire cohérente. Ainsi, ce langage devient un acte de rébellion contre la tentative de l’usine de tout homogénéiser ou, pire, la tentative de l’écrivain de tout romantiser. Il permet à Ponthus de capturer l’instabilité de sa condition d’intérimaire, toujours en suspens, jamais sûr de l’avenir. Les phrases courtes, souvent nominales, coupent net les pensées avant qu’elles ne se développent, reflétant l’incertitude de l’auteur quant à son emploi et à sa place dans le monde. « J’espère l’embauche / J’attends la débauche / J’attends l’embauche / J’espère. » : le quotidien de l’ouvrier est marqué par l’attente et l’espoir, mais aussi par l’angoisse d’une existence toujours précaire, dont le futur est constamment remis en question.
C’est dans cette retranscription du monde brut de l’usine par le langage que réside la force de À la ligne, une œuvre où la littérature se bat, ligne après ligne, contre l’aliénation.
C’est dans cette retranscription du monde brut de l’usine par le langage que réside la force de À la ligne, une œuvre où la littérature se bat, ligne après ligne, contre l’aliénation.
L’usine : un territoire de résistances éphémères
Dans ce monde de métal et de froid, Ponthus tente désespérément de trouver des éclats de poésie. Mais l’usine, par sa brutalité, le ramène sans cesse à la réalité. Sa quête de sens, bien que sincère, est sans cesse mise en échec par la monotonie du travail ouvrier.
Dès les premières pages, Ponthus se confronte à la réalité de l’usine : « En entrant à l’usine / Bien sûr j’imaginais / L’odeur / Le froid / Le transport de charges lourdes… » Le décor est planté. Pourtant, au milieu de ce chaos, l’auteur s’efforce de voir au-delà de l’évidence, de trouver un semblant de beauté dans l’absurde. « Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres », écrit-il, comme pour se convaincre que ce travail répétitif a un sens, qu’il construit quelque chose de plus grand, de plus noble. Mais cette illusion ne dure jamais longtemps. L’usine, avec sa logique implacable, sape peu à peu cette tentative de sublimer le quotidien.
Ce qui frappe dans le texte de Ponthus, c’est sa lucidité. Il sait que ses élans poétiques sont fragiles, que chaque moment d’évasion est précarisé par le retour à la routine. Certaines considérations philosophiques en deviennent même ridicules, comme lorsqu’il cherche à citer une maxime de La Bruyère pour justifier sa haine contre l’un de ses collègues, avant d’en revenir à une réalité bien plus immédiate : « Il n’empêche qu’aujourd’hui / Il a encore gratté des clopes ». Ces contrastes sont omniprésents dans l’œuvre et éclairent la tension permanente entre l’espoir de trouver du sens et la dureté de la réalité qui s’impose. L’usine, par sa nature, résiste à toute tentative de sublimer l’expérience quotidienne ; elle réduit les moments de grâce à des éclats fugaces, vite effacés par la reprise du travail.
Même les pauses, rares instants de répit, sont empreintes de cette dualité. Pour Ponthus, sortir, respirer l’air frais, voir la lumière du jour, c’est plus qu’un simple moment de repos ; c’est une tentative de se reconnecter à une réalité plus vaste, de rappeler à soi-même qu’il existe un monde au-delà des murs de l’usine. « C’est toujours s’étonner qu’il fasse jour à l’heure de la pause », note-t-il. Mais ces moments sont éphémères, rapidement engloutis par la nécessité de retourner à la chaîne, à cette mécanique implacable qui ne laisse place à aucune rébellion durable. En nous livrant ce récit, Ponthus ne cherche pas à embellir la condition ouvrière en la théorisant ; il nous montre, au contraire, à quel point il est difficile de maintenir une part d’humanité dans un environnement qui semble tout faire pour l’éteindre.
/https://zone-critique.com/enquetes/le-capital-de-marx/
La culture comme rempart contre la barbarie industrielle ?
Ancien étudiant en classe préparatoire littéraire, Joseph Pontus mobilise la culture pour survivre à l’expérience de l’usine. Pourtant, ce recours à la culture n’est pas simplement une échappatoire ou un remède miracle. Au contraire, il s’agit d’un rapport complexe et parfois ambivalent, qui reflète autant la grandeur que les limites de l’art face à la brutalité du monde industriel.
Ponthus ne cache pas son passé de lettré. Il a lu les grands classiques, et ces références l’accompagnent, que ce soit dans les frigos glacials de l’usine, où il découpe du poisson et décortique des crevettes, ou dans les abattoirs qu’il nettoie. Loin de se complaire dans une érudition distante, il intègre ces réminiscences littéraires dans son quotidien, comme un moyen de lutter contre la déshumanisation à laquelle il est confronté. Ce n’est pas la culture en tant que savoir froid et théorique qui le sauve, mais plutôt la manière dont il l’anime, la rend vivante dans un contexte qui semble vouloir l’étouffer.
C’est dans cet esprit que l’on retrouve des allusions récurrentes à Charles Trenet, dont les chansons joyeuses et légères deviennent un leitmotiv dans son travail. Il lui dédicace d’ailleurs l’ouvrage, en précisant : « A Charles Trenet, sans les chansons duquel je n’aurais pas tenu ». Cette dédicace révèle, avant même le début du récit, une tension sous-jacente. La culture populaire, loin d’être un luxe, devient un soutien moral essentiel, et le texte regorge de ces moments où elle se frotte à la réalité brutale de l’usine, avec des résultats variés. Quand Ponthus cite Apollinaire, c’est autant pour se consoler que pour constater l’échec de la culture à le protéger entièrement. Apollinaire, qui écrivait depuis les tranchées, devient une figure tutélaire, mais aussi un miroir déformant : le poète a pu transformer sa souffrance en art, mais Ponthus, lui, est condamné à retourner à l’usine après chaque élan littéraire. L’art ne suffit pas à changer sa condition ; il ne fait que l’embellir temporairement. Cette lucidité transparaît aussi dans ses références à Marx et à la pensée révolutionnaire. Il évoque l’usine comme un lieu choisi par les prolétaires, mais sans illusion : l’usine n’est pas le lieu de la révolution, c’est celui de la soumission.
Il est intéressant de noter que Ponthus ne s’érige jamais en héros intellectuel. Il se met en scène avec une humilité désarmante, conscient que sa formation littéraire ne le rend ni meilleur ni plus fort face à la barbarie industrielle. Il ne dédaigne pas ses collègues moins lettrés ; au contraire, il partage avec eux le silence et la fatigue, cette « sympathie machinale » qui naît dans les entrailles de l’usine. Surtout, il ne cherche pas à prétendre que la culture est une échappatoire universelle, mais insiste sur le fait que la culture, pour être un rempart, nécessite un accès, une éducation, un contexte, et que tous n’en bénéficient pas de la même manière, que ceux qui souffrent le plus de ce travail à la chaîne restent les plus précaires. Cette conscience aiguë de l’inégalité des classes face à l’expérience de l’usine rend le texte profondément humain, empreint d’une lucidité douloureuse.
Ainsi, À la ligne n’est pas seulement un récit sur la vie ouvrière, mais aussi une réflexion ambivalente sur les limites du langage face à cette expérience. C’est un hommage à la force de l’écriture, mais aussi une reconnaissance de ses failles. En fin de compte, Ponthus nous montre que si la littérature ne peut pas toujours vaincre l’usine, il peut au moins continuer à se battre, ligne après ligne, refusant de se laisser totalement écraser par la mécanique industrielle. Et dans cette lutte incessante, même lorsqu’elle semble perdue d’avance, subsiste une forme de victoire.
- A la ligne, Joseph Ponthus, La Table Ronde, 2019
- Photo de Joseph Ponthus : ©Philippe Matsas/Opale/Éditions La Table Ronde
