BOOMER de Frédéric Perrot succède à Soleil Cou Coupé au sein de notre collection « Vrilles ». Cette nouvelle met en scène une femme qui réagit de façon radicale suite à une énième déclaration sexiste de la part d’un personnage public. Estelle Derouen a rencontré Frédéric Perrot pour évoquer les enjeux de ce texte : féminisme, radicalisation des modes d’action, impact des réseaux sociaux…
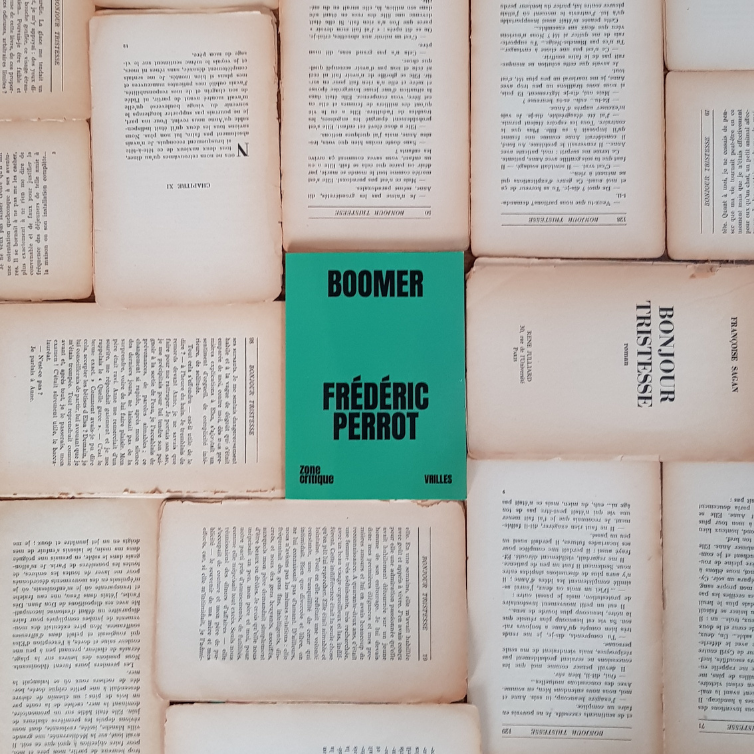
Estelle Derouen : Dans votre nouvelle intitulée BOOMER, il est question d’un personnage principal qui est une professeure des écoles naturellement attachée au dialogue, et qui va brusquement tirer un trait sur celui-ci pour passer à l’action. Est-ce que le dialogue et le débat ont perdu leur utilité aujourd’hui ? Le temps des phrases est-il vraiment révolu ?
Frédéric Perrot : Je ne crois pas, mais j’ai l’impression qu’il y a comme une obligation de se radicaliser face à certains propos machistes. Qu’il devient parfois nécessaire d’en passer par une forme de déraison pour pouvoir revenir à la raison.
Comme elle, je me suis souvent retrouvé face à certains propos d’hommes sur les femmes, ou de femmes sur les femmes aussi d’ailleurs, qui ont suscité chez moi une colère qui m’obligeait à radicaliser mes propos. Mais les débats sont souvent vains. Avec ce texte, j’avais envie d’affirmer que l’action a parfois plus d’impact que les mots.
ED : Nous aurions de plus en plus de mal à communiquer à l’heure des différents réseaux sociaux ?
FP : Sur certains sujets, on est dans une telle urgence qu’il est parfois utile d’en passer par un autre biais que les mots. On le voit avec les Femen par exemple, ou ces mouvements écologistes qui aspergent le contenu de boîtes de conserve sur des tableaux de maître : c’est choquant, déraisonnable peut-être, mais ça impose de façon très efficace, et aux yeux de tous, des vérités qu’on se refuse à voir.
ED : Le geste de l’héroïne peut effectivement faire penser à ces mouvements activistes qui créent une image forte pour faire passer un message et, pourquoi pas, être imité. Êtes-vous convaincu de l’efficacité de ce nouveau mode de communication ?
FP : Oui, parce que c’est toujours fait avec beaucoup de malice et d’intelligence, c’est une violence non violente, c’est ça qui est génial. C’est presque artistique. Ça permet de mettre efficacement la lumière sur un problème, quand certains débats n’y parviennent jamais vraiment.
ED : Il est fait référence à différents médias, que vous avez la délicatesse de renommer, mais que pensez-vous du paysage médiatique français actuel ? Est-il sain et équilibré ?
FP : J’allais dire oui, mais en fait, pas tant que ça. Justement parce que ces paroles plus vindicatives et engagées sont moins audibles aux heures de grande écoute. Elles sont donc forcées de trouver d’autres moyens d’expression, à travers ces happening forts par exemple. C’est toujours intéressant je trouve quand la colère est mise en scène. Elle devient plus palpable, plus accessible. C’est le cas du geste de l’héroïne de ma nouvelle : malgré sa virulence, sa colère est tellement incarnée qu’elle va délivrer un message intelligible.
ED : C’est en effet à la fois un acte impulsif et réfléchi, la nouvelle développe le détail de sa réflexion jusqu’aux secondes qui précèdent l’acte.
FP : Oui, je décris les 24h qui précèdent son geste, mais les décennies précédentes sont induites. Tout est dit dans la première phrase : « Il a fallu une seconde pour que l’idée naisse. Trente-trois ans pour qu’elle prenne racine. » Sa colère a fait son nid depuis toujours, les dernières heures ne sont que les petites marches qui lui manquaient pour justifier l’action.
ED : Vous montrez aussi notre rapport à l’actualité, notre façon de lire en diagonale les articles depuis notre téléphone tout en marchant. Outre l’impact sur l’immédiateté et l’immixtion dans notre vie, est-ce que les nouveaux médias connectent davantage au monde, ou bien est-ce qu’au contraire, ils créent un rapport superficiel à une information dépourvue de réflexion ?
FP : Je penche plutôt pour la seconde option. On est tellement sollicités que ça nous anesthésie, on en vient à ne plus trouver choquant ce qui devrait l’être. Ces micro-violences vécues par l’héroïne sont banalisées par des propos qu’elle reçoit en permanence sur son téléphone. Les propos de Pierrick, par exemple, vont la heurter sur le moment, mais ils vont immédiatement être engloutis dans le quotidien et son flux continu d’informations. Son geste final sera une manière de mettre un stop radical à cette dilution de la violence dans sa vie, elle souhaite marquer la frontière d’un avant et d’un après. Même si son geste va finir par rentrer, lui aussi, dans ce flux continu d’informations. C’est toute la perversité de l’époque.
ED : J’ai beaucoup aimé la phrase suivante : « Internet est un trésor de portes dérobées pour échapper à mes contradictions. » Je voulais savoir si elle vous concernait.
FP : Oui, et je pense qu’elle nous concerne tous.
L’effet pervers d’internet, c’est la dilution.
On est abreuvé de milles avis et débats qui nous polluent plus qu’autre chose. Il me semble plus intéressant de puiser ses propres convictions dans le quotidien, dans ce qui nous entoure, nos proches, nos vies, comme l’héroïne le fait pendant ces vingt-quatre heures que je raconte.
ED : Les règles arrivent peu à peu dans la littérature, dans la précédente nouvelle de la collection « Vrilles » écrite par Clémentine Haenel, il en était d’ailleurs question en filigrane. Pourquoi les menstruations, qui concernent pourtant toutes les femmes, gênent-elles tant d’après vous ?
FP : C’est difficile à dire. Ce qui est évident, c’est que notre société patriarcale en a fait un tabou. Les publicités où le sang menstruel figure en bleu en est un bon exemple. Ça en dit long sur ce que l’on veut passer sous silence. Ça gêne parce qu’on a bien voulu que ça gêne. J’ai l’impression que ça change un peu, même si ça reste trop timide.
Jean-Michel Maulpoix : une histoire de bleu(s)
ED : Rentreriez-vous dans un débat sur le sujet avec ceux qui trouvent cela déplacé, voire dégoûtant, comme le personnage de Pierrick ?
FP : Je ne pense pas. Imaginer qu’un débat est systématiquement possible est à mon avis une fausse idée. Alors que les actions, elles, ont une chance de marquer les esprits. La littérature, d’ailleurs, constitue une action, et pas des moindres, elle est capable de faire évoluer les mentalités de façon considérable. Écrire permet d’instaurer un débat plus en profondeur, qui s’inscrit dans le temps long.
ED : En tant qu’homme, vous vous êtes même penché sur le ressenti des femmes durant leurs règles.
FP : S’est posé la question de la légitimité, mais à vrai dire je m’en fous un peu. Je dis ça par provocation bien sûr, mais pour moi le seul mouvement moral important c’est l’intelligence avec laquelle on s’empare d’un sujet, avec quelle pertinence on se fond dans un personnage, comment on fait en sorte de rendre les situations et les personnages plausibles. C’est à mon sens ça qui donne ou non de la légitimité.
ED : Il y a cette scène où le personnage féminin est excédé par la façon dont les hommes considèrent les femmes durant leurs règles, pourquoi ce choix ?
FP : J’ai fait ce choix pour poser l’idée que les femmes ont le droit d’en faire un argument, parce qu’il s’agit de leurs corps, mais pas les hommes.
ED : Pensez-vous vraiment que « Les algorithmes sont le tombeau de la défiance » ?
FP : Mais oui, c’est même fascinant de constater à quel point les algorithmes parviennent à façonner autour de nous une bulle douillette dans laquelle on est conforté par nos propres idées, par tout ce qu’on aime, les médias qui vont dans notre sens, etc. Ça crée une forme d’anesthésie, on est moins confronté aux avis divergents, alors que cette contradiction est primordiale. Vraiment j’en suis convaincu, les algorithmes ont été créés pour nous ramollir le cerveau. (rire)
ED : Le personnage de Pierrick incarne les théories masculinistes, mais ne croyez-vous pas qu’une remise en question des comportements masculins puisse être déstabilisante pour ces « boomers » qui ont reçu une autre éducation, et qui ont pris leurs habitudes dans un monde qui ne les remettaient pas en cause ?
FP : Ça fait des décennies qu’ils évoluent dans ce modèle-là, donc évidemment ça les heurte. Ne serait-ce que le terme de « boomer » suffit à en vexer certains. Mais c’est bien, ça provoque chez eux comme un réveil – un réveil de mauvaise humeur – face à cette ré-égalisation nécessaire des choses. Bien sûr que ça les agace, mais leur agacement me met chaque fois en joie (rire).
ED : Sans dévoiler la chute, l’héroïne, dont on voit la colère monter, explose. Il s’agit là d’un acte né de la charge mentale de cette femme, qui jongle entre enfant, mari, activité professionnelle, vie d’écrivaine, belle-famille plutôt très rétrograde, et qui se retrouve confrontée à tout ce qu’elle ne supporte plus, incarné par ce boomer. Qu’est-ce qui vous a inspiré ?
FP : La réalité.
J’ai vécu tout ce qui se passe dans la nouvelle.
Tout sauf la fin (rire). Comme mon héroïne, je suis tombé sur les déclarations d’un présentateur télé qui m’ont presque amusé tant elles étaient choquantes. Le lendemain, j’allais présenter mon roman dans un salon littéraire. Dans le train, j’ai discuté avec des autrices et auteurs qui avaient également entendu ses propos et on a réalisé que c’était lui le parrain du salon où nous nous rendions. Tous nos romans étaient placés sous l’égide de cet homme… La situation était improbable. On avait envie d’aller lui parler, de tenter d’instaurer un débat avec lui et en même temps, on se rendait bien compte que c’était perdu d’avance. Ces hommes-là sont habitués à botter en touche, ça fait partie de leur quotidien, ça les impressionne peu. J’ai donc décidé de me servir de la fiction pour lui répondre.
ED : Ces boomers constituent-ils un matériau inspirant pour écrire des fictions ?
FP : Ce boomer-là en particulier, assurément. Je l’ai regardé évoluer, vraiment ça m’a fasciné. Le lendemain de ses déclarations sur les règles, des centaines de femmes s’agglutinaient devant son stand avec un grand sourire. Ce qui m’a frappé, c’est son sentiment d’impunité. Comme si les mots qu’il avait prononcés n’avaient aucune valeur. Je pense qu’il commence à comprendre que quelque chose a bougé mais je ne crois pas qu’il trouvera les ressources pour appliquer un changement à son quotidien. Dans cette interview dont je parle dans le texte, mais qui existe en vrai, il préfère remettre en question le monde entier plutôt que lui-même.
La question du débat face à ce type d’individus est évidemment vaine.
D’ailleurs, il ne se reconnaîtrait probablement pas s’il lisait la nouvelle, tant le décalage est grand entre ce qu’il pense être et ce qu’il est.
ED : Que répondre à ceux qui trouveraient le texte trop « woke » ?
FP : Je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne fais que raconter vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Rien de ce qui lui arrive ne me semble exagéré, c’est même le minimum de ce qui arrive à une femme au quotidien, ces espèces de microviolences, de micro-injonctions, de microremarques… C’est juste un constat. Il n’y a aucune radicalité dans le texte, paradoxalement – excepté son geste final. Tout ce qu’elle pense avant me semble être totalement justifié par rapport à ce qu’elle vit.
Gérald Bronner : «Les activistes ne sont pas nombreux mais parlent très fort»
ED : À un moment, vous écrivez « je hais les pères autoritaires autant que les mères soumises », les deux sont-ils autant responsables des rapports femmes-hommes selon vous ?
FP : Oui, j’en suis persuadé. On a souvent tendance à focaliser l’attention sur la figure du père autoritaire, mais souvent les mères se servent de cet épouvantail, le fameux « je vais le dire à ton père ». Rentrer dans ce jeu-là, c’est s’en rendre responsable. Certaines femmes sont rentrées dans ce mécanisme d’abord parce qu’elles y étaient forcées, ensuite elles s’y sont habituées, et il est désormais temps de faire exploser ces schémas pour en sortir. Il m’arrive d’en débattre avec des femmes auxquelles j’oppose un discours fermement féministe. Il y a un moment où il faut sortir de ce conditionnement dans lequel nous sommes empêtrés.
ED : Dans ce texte, vous critiquez tout de même beaucoup internet et les réseaux sociaux, est-ce que vous n’êtes pas un peu boomer ?
FP : Peut-être, écrire m’aide aussi à déconstruire. Dans ce texte, je parle aussi de moi, de choses que j’ai apprises et comprises. Alors oui, peut-être que je suis un peu des deux côtés dans cette histoire. (rire)
ED : À la fin, son mari en veut à l’héroïne, mais finit par lui donner raison. La manière dont vous l’écrivez est touchante. Pourquoi cette subtilité ?
FP : C’est intéressant que vous le notiez, parce que ce petit bout de phrase qui rallie le mari à la cause de sa femme, j’ai hésité à le faire apparaître dans le texte. Et finalement, ça m’a semblé absolument nécessaire de rallier les hommes à ce combat. L’idée est de montrer qu’un front commun est possible, particulièrement dans le couple, c’est quand même l’endroit où les opinions et les idéaux politiques peuvent le plus bouger sans qu’il y ait véritablement de débat. Ça se forge au jour le jour, dans le temps long. Vous l’aurez compris, je crois peu au débat mais davantage aux relations.
- Frédéric Perrot, Boomer, Collection Vrilles, 2024

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.