Avec La Faille, l’autrice s’initie avec brio au récit littéraire, empruntant des chemins parallèles à ceux de Maggie Nelson ou de Leslie Jamison. Elle nous offre un livre doux-amer, foisonnant et exigeant, qui ravira les désaxés, les indécis, les fébriles et les révoltés.
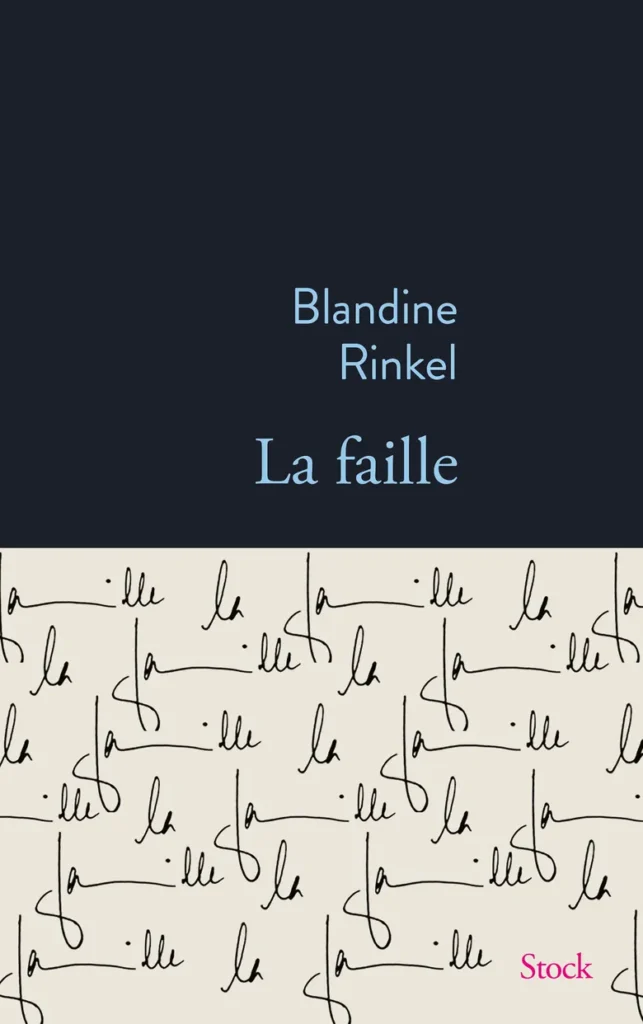
À l’origine du texte il y a une fêlure calligraphique et intime : la disparition de la lettre M dans le mot « famille » lorsque Blandine Rinkel se risque à l’écrire sur un papier. On lit, « la faille ».
Cette faille, c’est aussi celle vécue par l’autrice dans son rapport à sa famille. Le sentiment d’avoir, depuis l’enfance, vécu en sursis, dans l’attente d’une fuite vers l’extérieur, d’un départ du foyer familial, d’une évasion vers l’ailleurs, quand bien même elle n’en était nullement empêchée : « J’ai eu cette chance : mes parents ne m’ont pas empêchée de quitter les lieux, peut-être m’y ont-ils encouragée. Pourtant, ce n’était pas assez. Ce n’était jamais assez. Parce que c’était de la famille, au fond, que je voulais m’évader. »
De cette famille elle dit l’omniprésence de la mort comme une ombre sur la vie quotidienne, la conscience d’une obsolescence à venir : « nous le pressentions, mes parents et moi : notre famille ne tiendrait plus longtemps », son rebut pour les atmosphères de dimanches soir et son incapacité à se penser comme eux. Une mère dévouée aux autres mais effacée, et un père à la fois flamboyant et difficile, dont la présence effleurée rappelle celle du personnage de Gérard dans Vers la violence, son troisième roman. La fêlure réside là : ils sont sa famille, et c’est d’eux qu’elle veut s’affranchir.
https://zone-critique.com/creations/tiphaine-mora-sa-soeur
C’est donc aussi d’eux que naît la brèche : ne pas vouloir jouer le jeu social, et ne pas vouloir culpabiliser pour ça, mais au contraire, se permettre de nouveaux possibles. Depuis cette blessure originelle, l’autrice tire le fil et vient pointer du doigt l’un des tabous les plus importants de l’époque contemporaine. Elle interroge ces liens tout à la fois choisis et contraints : « Là où certains voient un refuge, d’autres se figurent une prison. Ceux-ci préfèrent la fuite à l’ancrage. »
Ode aux désaxés
De ce constat premier découle ainsi une réflexion dense sur les vécus de « Celles qui se sentent fauves, désaxées, intimement exilées. » Comprenons toutes celles et ceux qui se refusent à une existence qui devrait uniquement être menée selon les normes sociétales et politiques que sont les liens du sang, la parentalité, le foyer, mais aussi le militantisme ou encore le salariat.
Parmi ces désaxés : Blandine Rinkel elle-même, et celui qu’elle nomme pudiquement « Toi », compagnon aux problématiques différentes des siennes qu’elle met pourtant en miroir au travers d’incursions plus personnelles dans le texte, entre la lettre d’amour et l’ode à la liberté. Et la beauté du récit réside précisément dans ces formes d’appels d’air et de consolation, ces fenêtres ouvertes sur le désir et la possibilité d’autres modes de relation.
La beauté du récit réside précisément dans ces fenêtres ouvertes sur le désir et la possibilité d’autres modes de relation.
Car dans les familles, choisies ou non, « Ce qui nous menace si souvent, c’est l’assèchement de nos désirs profonds. La cadavérisation d’une personne par le groupe auquel il appartient, la norme et son autorité. Le danger, c’est le gel de soi. »
Apprendre à être soi, indépendamment des autres
Comment, donc, échapper à la norme, au gel de soi, aux identités que l’on nous assigne et aux vies que l’on choisit à notre place ? Comment se défaire des autres sans s’abîmer soi-même ?
Difficile question que la rupture, qu’elle soit franche ou non, avec les modèles établis. D’abord, parce qu’elle induit de toutes les façons une solitude à laquelle il faudra s’habituer et que le modèle traditionnel nous permettait d’éviter « Car bien sûr, dans le fantasme qu’on en a, les familles – de toutes sortes, celles de sang et celles de cœur, les militantes et les artistiques, les proches et les élargies – servent aussi, surtout peut-être, à cela : à nous protéger du temps qui passe, de la perte et de la solitude » ; mais aussi parce que, sans rupture, arrivera nécessairement un jour ou l’autre une forme d’oubli de nous-mêmes au profit de nos proches. À lire Blandine Rinkel, on comprend en effet que « Par peur de blesser l’autre, il arrive qu’on s’attaque soi-même. C’est une technique de défense paradoxale : se faire du mal pour ne pas en causer aux siens. »
Cette réflexion permet de mettre en lumière l’absence de choix qui peut parfois s’imposer dans l’acte de quitter sa famille, son groupe, et aussi une part de son identité : « Car tout ne relève pas de la volonté, tout ne relève pas du fait de prendre sur soi, tout ne peut pas être accepté. Parfois au risque de n’être plus compris ou de s’isoler, parfois au risque de souffrir ou de le regretter, parfois, c’est comme ça, c’est rompre ou périr. »
Rompre, c’est aussi mettre à jour les mécanismes des violences intrinsèques aux fonctionnements du groupe, qu’elles soient tues ou assumées, idéologiques ou inconscientes, il arrive que l’éviction soit volontaire et inévitable pour assurer notre propre survie. Là, l’acte de la rupture est souvent total, en ce qu’« Indifférente voire hostile, la famille peut le devenir à l’égard de ceux qui en ont été éjectés. (…) La solution de facilité pour faire disparaître un problème, c’est ça : exclure celui qui le nomme. »
https://zone-critique.com/critiques/a-holy-family
Dès lors, l’autrice s’attèle à glorifier celles et ceux qui prennent les chemins de traverse, renoncent aux faux-semblants, interrogent leurs liens à leurs entreprises, pointent du doigt les limites de leur militantisme, abandonnent le confort du foyer pour aller interroger d’autres possibles, ou simplement pour se retrouver plus proches de leurs désirs et se remettre à rêver grand.
La fa(m)ille artistique : inventer d’autres modèles
Comme toujours chez Blandine Rinkel, la lecture se fait fluide et pourtant complexe, mettant à nu des thèmes que l’on préfèrerait passer sous silence, venant titiller les plus profondes de nos contradictions, dévoilant les doutes que l’on aurait aimés taire. Cette complexité stylistique, rare dans le paysage littéraire contemporain, est difficilement résumable et se vit comme une expérience de lecture à part entière.
Outre ses questionnements autour du groupe et des liens de sang, le texte fourmille de références littéraires, cinématographiques, intimes, politiques, de Kafka à Call me by your name en passant par Sarah Schulman et Maggie Nelson, révélant que le sujet du groupe, de la famille, du modèle est par essence une question artistique qu’il convient de remodeler selon nos propres désirs. Il convient de s’infiltrer dans les failles, les fêlures et les blessures qui nous composent pour redéfinir nos identités à nos guises. Combler les trous ou au contraire élargir les espaces.
Car s’il est une chose que nous apprennent les familles, c’est bien la capacité à être pluriels : à cacher des parts de nous, à en révéler d’autres
Car s’il est une chose que nous apprennent les familles, c’est bien la capacité à être pluriels : à cacher des parts de nous, à en révéler d’autres, à s’adapter, se tordre, se fondre dans ou s’échapper de la masse. Or, cette multiplicité qui nous compose dès la naissance et définit nos liens, nous pouvons choisir de l’investir autrement, par exemple, dans l’écriture mais aussi dans l’investissement de nouvelles formes relationnelles, d’affinités délivrées de tout ordre social et régies seulement par nos envies : « Puisque n’importent pas seulement, dans une vie, la descendance, le sang ou le patrimoine, mais bien certains regards, certains désirs ou tons, qu’on partage avec d’autres sans toujours les instituer et qui, pourtant, bouleversent. »
Cette volonté artistique et intime de redéfinir les cadres d’un modèle trop normatif prend d’ailleurs corps dans l’objet même du livre. Celui-ci ne se contente pas d’être un récit mais fait aussi figure d’outil, donnant à réfléchir, à penser, à interroger, alimentant les petites voix contradictoires qui nous composent, notamment à travers ses annexes merveilleuses (« Cinquante livres où habiter » et « Trente choses notées le jour de mes trente ans »), qui constituent autant de mondes à explorer pour perpétuer l’exercice intellectuel initié avec La Faille, et tenter de mieux comprendre « la déchirure secrète qu’on sent parfois entre le monde et soi, entre le groupe et soi ».
L’autrice appelle d’ailleurs cette mise en pratique de ses vœux : « Quand, pour une raison ou l’autre, le modèle dominant nous asphyxie, on devrait pouvoir ne pas y souscrire, lui préférer d’autres récits – des histoires de meutes, de murmures, de fiertés, des récits de regroupements qui n’ont pas encore de noms, de famille aussi, bien sûr, qui surprennent et vivifient […] Des chemins qui nous laissent intranquilles […], vivants et troublés, vivant avec le trouble. »
Ainsi, aussi douloureux et difficile puisse être le constat initial de La Faille, il faut lire absolument ce texte aux allures de talisman qui procure un ravissement difficilement résumable. L’écriture de Blandine Rinkel, ciselée et précise réconforte et ravive, nous enjoignant à embrasser nos fêlures pour aller vers un monde plus riche de questionnements, d’expériences et d’incertitudes.
Puisqu’à travers les failles se faufilera, toujours, la lumière.
- La Faille, Blandine Rinkel, Éditions Stock, janvier 2025.
- Crédit photo : @Pauline Darley, Le Crime.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.