En 2020, la pandémie du Covid-19 semblait avoir ouvert une brèche pour le concept de décroissance. Les avions étaient cloués au sol et les autoroutes étaient désertes. L’air était devenu respirable et l’on redécouvrait les plaisirs simples d’une vie contemplative. Pour beaucoup, l’idée de revoir notre modèle économique commençait à faire partie de l’ordre des possibles. Pourtant, en coulisses, le monde des affaires et de la politique rêvait à un autre destin, un monde où la croissance ne serait pas incompatible avec la préservation de l’environnement. Depuis 2020, ce rêve est devenu une quasi-réalité grâce aux propriétés miraculeuses de la molécule hydrogène, capable de faire avancer une voiture ou d’éclairer une maison sans aucune émission de CO2. Dans son tout premier essai, Hydrogène mania, enquête sur le totem de la croissance verte, la journaliste Aline Nippert mène l’enquête sur cette molécule providentielle, veau d’or des industriels, mouton noir des écologistes.
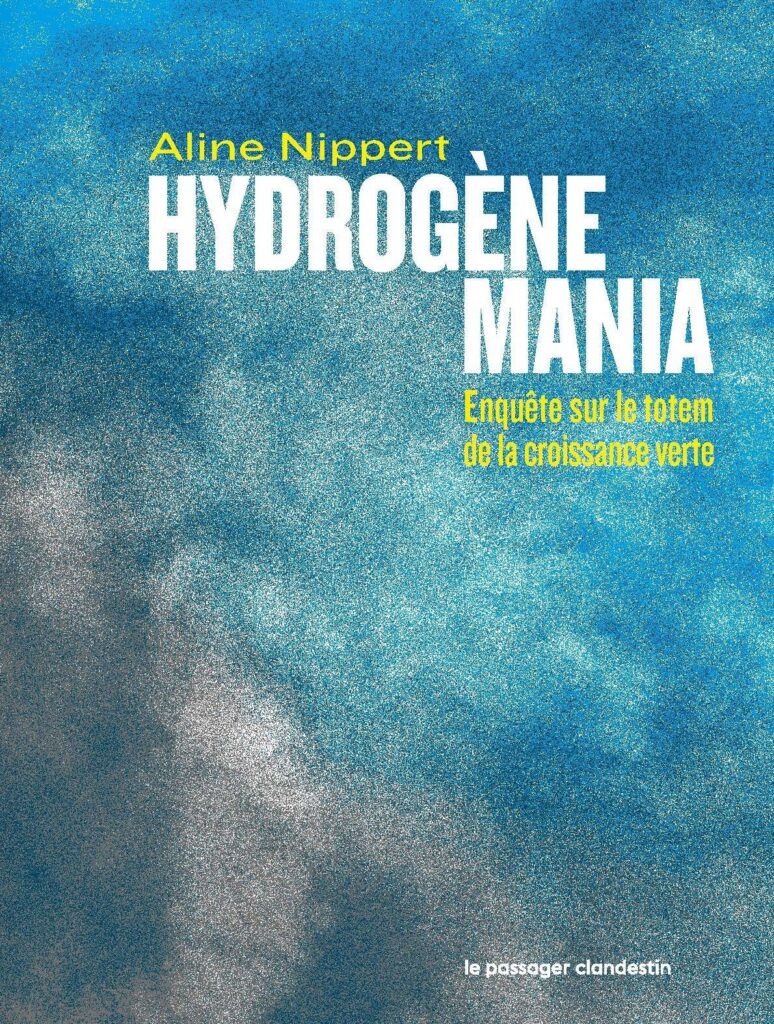
Une histoire de découplage
Depuis de nombreuses années, la molécule hydrogène intéresse les scientifiques et les industriels car elle n’émet que de l’eau quand on la brûle. Plusieurs constructeurs automobiles ont d’ailleurs fait de cette caractéristique leur argument de vente principal en mettant en avant les moteurs propres des véhicules hydrogène, parfois non sans maladresse. En 2014, le fabricant Hyundai, dans un spot publicitaire, met en scène un employé au bout du rouleau qui tente de se suicider dans sa voiture en inhalant les gaz d’échappement. L’opération échoue puisque le pot d’échappement ne sert qu’à évacuer de la vapeur d’eau. La publicité a finalement été retirée, mais elle illustrait, malgré elle, le cynisme associé à la notion de découplage.
Aline Nippert en propose la définition suivante : « Le découplage désigne une situation où l’augmentation du produit intérieur brut (PIB), c’est-à-dire l’expansion quantitative des volumes de production dans un pays, rompt avec la hausse des destructions écologiques engendrées par les activités humaines ». Le découplage est dit absolu lorsque le PIB augmente et que les « dommages environnementaux » se réduisent. Il est dit relatif lorsque l’augmentation du PIB continue à générer des « effets délétères sur les écosystèmes », mais à un rythme moins élevé. Dans ce contexte, l’hydrogène a très tôt été envisagé comme le candidat idéal pour prouver la possibilité d’un découplage absolu. Cette source d’énergie qui ne rejette que de l’eau permettrait de conserver toutes les activités en place, sans plus jamais porter atteinte à l’environnement.
L’enquête d’Aline Nippert cherche donc à évaluer la promesse de découplage absolu portée par la molécule hydrogène. Elle se place du côté des industriels et des responsables politiques qui cherchent une alternative « verte » aux énergies polluantes, pour ne pas dire au pétrole tout court. La journaliste part ainsi à la rencontre des acteurs les plus en vue du petit monde de l’hydrogène, à commencer par le président du lobby Hydrogen Europe, Jorgo Chatzimarkakis, ou le fondateur de Lyfhe, Matthieu Guesné, une entreprise de production et de vente d’hydrogène. À travers ses différentes rencontres, Aline Nippert nous donne à sentir l’atmosphère d’un milieu galvanisé par les innovations et les projections futuristes. On y découvre des esprits enthousiastes, dirigeants, scientifiques ou politiques, toujours à la limite de l’illumination.
À partir du constat des limites de la promesse « hydrogène », on découvre une fonction totémique qui agit dans nos sociétés, pourtant rationalistes, comme une croyance magique.
« Le totem de la croissance verte » ou la croyance magique
Après un bref historique de la molécule, la journaliste montre de façon convaincante et pédagogique que l’hydrogène n’est pas une énergie parfaitement verte. Chiffres à l’appui, on apprend que la production d’hydrogène repose en grande partie sur des énergies fossiles et qu’on envisage surtout de l’utiliser pour décarboner les industries polluantes, notamment le pétrole. Dès 1953, la Commission de l’énergie atomique des États-Unis prônait un mix énergétique nucléaire-hydrogène, le premier pour produire de l’électricité, le second pour faire avancer les voitures, auxquelles on peut difficilement rattacher un réacteur nucléaire. Aujourd’hui, la plupart des entreprises projettent de fabriquer de l’hydrogène en récupérant le surplus d’électricité produit par les centrales nucléaires. D’autres projets, dans une logique de décarbonation des énergies dites « noires », envisagent de capter les molécules d’hydrogène présentes dans les vapeurs de méthane, un des principaux gaz à effet de serre rejeté par l’industrie de la chimie lourde.
Plusieurs de ces infrastructures ont déjà été mises en place, notamment par Lyfhe ou Air Liquide en France. En nous rapportant ses tournées sur le terrain, Aline Nippert révèle le gigantisme de ces projets industriels très couteux et encore peu rentables pour les entreprises, car le marché de l’hydrogène n’existe pas vraiment… Sans compter que le transport de l’hydrogène est rendu très compliqué par son extrême volatilité et inflammabilité.
https://zone-critique.com/critiques/juliette-rousseau-pequenaude/
À partir du constat des limites de la promesse « hydrogène » tant sur le plan environnemental qu’économique, la journaliste conclut que l’hydrogène recouvre une fonction totémique, c’est-à-dire qu’elle agit dans nos sociétés pourtant rationalistes comme une croyance magique. Elle en donne pour preuve, dès le début de son enquête, la façon dont l’hydrogène a été utilisé comme solution miracle pour sauver le Green Deal européen, signé en 2020 et tombé aux oubliettes au moment de la crise sanitaire. On comprend que l’hydrogène a alors reçu les faveurs de la Commission européenne dans la mesure où il permettait à l’Europe de rester compétitive sur le plan industriel et de renforcer sa souveraineté énergétique, notamment vis-à-vis de la Russie.
L’hydrogène mondial
Dans la dernière partie de son enquête, Aline Nippert révèle la dimension peut-être la plus inattendue de l’hydrogène, son intérêt géopolitique. Plusieurs pays européens, avec l’Allemagne en tête, ont lancé des programmes internationaux pour produire de l’hydrogène, en particulier dans les pays africains, et l’exporter en Europe via d’interminables pipelines. Il s’agit par exemple du projet allemand Desertec 3.0 qui ambitionne de fabriquer de l’électricité et de l’hydrogène dans le désert du Sahara grâce à l’énergie solaire.
Aline Nippert réussit à nous faire comprendre avec clarté et efficacité les multiples enjeux d’une énergie peu connue du grand public, souvent cantonnée au monde académique.
Selon les travaux du chercheur Hamza Hamouchene, cette situation aurait pour conséquence de perpétuer la dynamique centre-périphérie entre le Sud global et les pays du Nord, avec des pays fournisseurs et des pays consommateurs, d’autant plus que la répartition des compétences techniques entre ces pays est inégale. Autrement dit, les ingénieurs capables de piloter des infrastructures comme celles du projet Desertec 3.0 ne se trouvent pas majoritairement au sein des populations locales.
Par ailleurs, pour le spécialiste des pays du Golfe, Christian Henderson, l’hydrogène représente un enjeu en termes de diplomatie et de concurrence énergétique. Les profits considérables générés par l’industrie pétrolière leur permettent de flécher des investissements significatifs vers des pays comme l’Égypte, notamment pour des projets de développement des énergies. Ils installent ainsi leur influence financière dans cette région du globe et créent une sous-dynamique centre-périphérie au niveau local. Les pétromonarchies du Golfe investissent également dans la construction d’usines à hydrogène sur leur propre sol, en partie pour décarboner l’industrie pétrolière, et ainsi verdir leur image, mais aussi pour se positionner comme des acteurs incontournables dans les énergies du futur.
Aline Nippert montre ainsi comment l’hydrogène sert à la fois à maintenir des modes de production carbonés et à reproduire des dynamiques géopolitiques assimilables à un « colonialisme vert » pour reprendre l’expression de Hamza Hamouchene.
Avec Hydrogène Mania, la journaliste Aline Nippert réussit donc à nous faire comprendre avec clarté et efficacité les multiples enjeux d’une énergie peu connue du grand public et à nous sensibiliser à des concepts écologiques souvent cantonnés au monde académique. Le format de l’enquête, s’il sert d’abord un objectif journalistique, rend le sujet, pourtant sérieux et technique, particulièrement agréable et digeste. Nul doute que cette enquête restera un ouvrage de référence sur la question de l’hydrogène !
- Hydrogène Mania, Aline Nippert, Éditions Le Passager clandestin, 2024.

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.